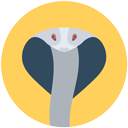Nicolas Boileau, dit Boileau-Despréaux, est un homme de lettres français du Grand Siècle, né le 1er novembre 1636 à Paris et mort dans la même ville le 13 mars 1711. Poète, traducteur, polémiste et théoricien de la littérature, il fut considéré en son temps et par la postérité comme le législateur ou le « Régent du Parnasse1 » pour son « intransigeance passionnée ». Molière, Furetière, La Fontaine et Racine étaient de ses amis. Deux de ses frères aînés Gilles Boileau et Jacques Boileau, se sont fait un nom dans l'histoire des lettres. Biographie Quinzième enfant de Gilles Boileau, représentant typique de la petite bourgeoisie parlementaire, greffier de la Grand' Chambre du Parlement de Paris, Nicolas Boileau est, dès son plus jeune âge, destiné au droit. Nicolas Boileau est d'abord un enfant de constitution fragile qui doit se faire opérer de la taille à l'âge de onze ans. Il commence ses études au collège d'Harcourt. Ce n'est qu'en troisième, après avoir rejoint le collège de Beauvais pour étudier le droit, qu'il se fait remarquer par sa passion pour les grands poètes de l'Antiquité. Boileau, aidé de sa famille, a probablement forgé de toutes pièces une généalogie qui lui accordait un titre de noblesse et qu'il faisait remonter jusqu'au xive siècle, à Jean Boileau, un notaire royal anobli par Charles V. Nicolas Boileau revendiquait un blason dont les armes étaient « de gueules à un chevron d'argent accompagné de trois molettes d'or ». Cependant, rien dans la condition de Boileau ne laisse à penser qu'il ait pu avoir de véritables titres nobiliaires. Œuvres * Les Satires (1666–1716). Réédition : 2002. * Épîtres (1670-1698). Réédition : 1937. * Arrêt burlesque15 (1671) (en collaboration) * Poésies diverses avec Amitié Fidéle (1674) * Le Lutrin (Poème héroï-comique) (1674-1683) * L’Art poétique (1674) * Longin, Traité du sublime, trad. par Nicolas Boileau, Paris, 1674 (en ligne [archive] ; transcr. [archive]) : avec introduction et notes par Francis Goyet, Paris, 1995 (ISBN 2-253-90713-8). * Dialogue sur les héros de roman (1688). (Une analyse de cet ouvrage se trouve dans l'article Réflexions sur le roman au XVIIIe siècle.) * Réflexions critiques sur Longin (1694-1710) * Lettres à Charles Perrault (1700) * Œuvres de Boileau (1740), édition Pierre et Berthe Bricage 1961, 5 tomes, illustrations par Rémy Lejeune (Ladoré) * Correspondance avec Brossette (1858) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Boileau


Paul-Jean Toulet, né à Pau (Basses-Pyrénées) le 5 juin 1867 et mort à Guéthary (Basses-Pyrénées) le 6 septembre 1920, est un écrivain et poète français, célèbre par ses Contrerimes, une forme poétique qu’il avait créée. Biographie Paul-Jean Toulet perd sa mère à sa naissance. Tandis que son père regagne l’île Maurice, il est confié à un oncle de Bilhères, dans la vallée d’Ossau. Il séjourne trois ans à l’île Maurice (1885-1888) puis un an à Alger (1888-1889), où il publie ses premiers articles. Il arrive à Paris en 1898. C’est là qu’il se forme véritablement, sous la tutelle de Willy, dont il est l’un des nombreux nègres, notamment pour Maugis en ménage. Colocataire du futur Prince des Gastronomes Curnonsky, il fréquente les salons mondains et les boudoirs demi-mondains qu’il évoque dans Mon amie Nane. Il travaille beaucoup et se livre à divers excès, dont l’alcool et l’opium. Il collabore à de nombreuses revues, dont la Revue critique des idées et des livres de Jean Rivain et Eugène Marsan. De novembre 1902 à mai 1903, il effectue un voyage qui le mène jusqu’en Indochine. Il quitte définitivement Paris en 1912 pour s’installer chez sa sœur, à Saint-Loubès, au château de la Rafette où leur tante maternelle vit avec son mari Aristide Chaline qui a racheté le château. Paul-Jean est un familier des lieux qui auront l’honneur de plusieurs Contrerimes. Puis à Guéthary, où il se marie. Ses dernières années sont assombries par la maladie. Pendant ce temps, un groupe de jeunes poètes, dont Francis Carco et Tristan Derème, prenant son œuvre en modèle, s’intitulent « poètes fantaisistes ». Les fameuses Contrerimes parurent à partir de la fin des années 1900 dans des revues et dans le corps des romans de Toulet. Un premier projet de les réunir en volume fut avorté par la guerre de 1914. Le livre ne parut finalement que quelques mois après la mort de l’auteur. Il contient outre des contrerimes des poèmes d’autres formes, dont ce dixain: Dans le domaine théâtral, Paul-Jean Toulet composa avec des amis (Martin et Cotoni) un à-propos en vers: La Servante de Molière dont nous n’avons pas le texte, mais qui fut représenté au Théâtre des Nouveautés d’Alger (alors que le poète y résidait), et qu’il s’amusa à éreinter lui-même dans Le Moniteur. Il fit également représenter une comédie en prose: Madame Josephe Prudhomme dont il était l’unique auteur. Enfin, Le Souper interrompu qui fut joué pour la première fois le 27 mai 1944 au théâtre du Vieux-Colombier, au même programme qu’une autre création, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Paul-Jean Toulet avait eu, dès 1902, un projet avec Claude Debussy autour de Comme il vous plaira (As you like it) de William Shakespeare. Debussy était désireux d’y revenir en 1917, mais la maladie du compositeur n’en a pas permis la réalisation. Georges Bernanos évoque son souvenir dans les premiers mots de son premier roman Sous le soleil de Satan (« Voici l’heure du soir, qu’aima P.J Toulet... »). De manière un peu inattendue, Frédéric Beigbeder place deux œuvres de Paul-Jean Toulet (Mon amie Nane et Les Contrerimes) dans le "top-100" de ses livres préférés que constitue Premier bilan après l’Apocalypse. Le groupe français Alcest a repris le texte de son poème Sur l’océan couleur de fer sur le titre homonyme paru sur l’album Écailles de Lune (2010). Œuvres * Publications posthumes * TraductionLe Grand Dieu Pan, d’Arthur Machen (parution française, 1901)Correspondance * Publications en revues * Rééditions modernes Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Jean_Toulet


Pierre Corneille, aussi appelé « le Grand Corneille » ou « Corneille l'aîné », né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 1684 à Paris (paroisse Saint-Roch), est un dramaturge et poète français du xviie siècle. Issu d’une famille de la bourgeoisie de robe, Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices d’avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature, comme bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d’abord des comédies comme Mélite, La Place royale, L’Illusion comique, et des tragi-comédies Clitandre (vers 1630) et en 1637, Le Cid, qui fut un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. Il avait aussi donné dès 1634-35 une tragédie mythologique (Médée), mais ce n’est qu’en 1640 qu’il se lança dans la voie de la tragédie historique—il fut le dernier des poètes dramatiques de sa génération à le faire—, donnant ainsi ce que la postérité considéra comme ses chefs-d’œuvre: Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et Nicomède. Déçu par l’accueil rencontré par Pertharite (1652, pendant les troubles de la Fronde), au moment où le début de sa traduction de L’Imitation de Jésus-Christ connaissait un extraordinaire succès de librairie, il décida de renoncer à l’écriture théâtrale et acheva progressivement la traduction de L’Imitation. Plusieurs de ses confrères, constatant à leur tour que la Fronde avait occasionné un rejet de la tragédie historique et politique, renoncèrent de même à écrire des tragédies ou se concentrèrent sur le genre de la comédie. Tenté dès 1656 de revenir au théâtre par le biais d’une tragédie à grand spectacle que lui avait commandée un noble normand (La Conquête de la Toison d’or, créée à Paris six ans plus tard fut l’un des plus grands succès du siècle), occupé les années suivantes à corriger tout son théâtre pour en publier une nouvelle édition accompagnée de discours critiques et théoriques, il céda facilement en 1658 à l’invitation du surintendant Nicolas Fouquet et revint au théâtre au début de 1659 en proposant une réécriture du sujet-phare de la tragédie, Œdipe. Cette pièce fut très bien accueillie et Corneille enchaîna ensuite les succès durant quelques années, mais la faveur grandissante des tragédies où dominait l’expression du sentiment amoureux (de Quinault, de son propre frère Thomas, et enfin de Jean Racine) relégua ses créations au second plan. Il cessa d’écrire après le succès mitigé de Suréna en 1674. La tradition biographique des XVIIIe et XIXe siècles a imaginé un Corneille confronté à des difficultés matérielles durant ses dernières années, mais tous les travaux de la deuxième moitié du XXe siècle révèlent qu’il n’en a rien été et que Corneille a achevé sa vie dans une confortable aisance. Son œuvre, 32 pièces au total, est variée: à côté de comédies proches de l’esthétique baroque, pleines d’invention théâtrale comme L’Illusion comique, Pierre Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne, apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Aux prises avec la mise en place des règles classiques, il a marqué de son empreinte le genre par les hautes figures qu’il a créées: des âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux (le fameux «dilemme cornélien») comme Rodrigue qui doit choisir entre amour et honneur familial, Auguste qui préfère la clémence à la vengeance ou Polyeucte placé entre l’amour humain et l’amour de Dieu. Si les figures des jeunes hommes pleins de fougue (Rodrigue, le jeune Horace) s’associent à des figures de pères nobles (Don Diègue ou le vieil Horace), les figures masculines ne doivent pas faire oublier les personnages féminins vibrant de sentiments comme Chimène dans Le Cid, Camille dans Horace ou Cléopâtre, reine de Syrie, dans Rodogune. L’œuvre de Pierre Corneille est aussi marquée par la puissance d’un alexandrin rythmé qui donne de célèbres morceaux de bravoure (monologue de Don Diègue dans Le Cid, imprécations de Camille dans Horace) et la force de maximes à certaines paroles («À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», Le Cid, II, 2– «Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi», dernier vers du Cid– «Je suis maître de moi comme de l’univers», Cinna, V, 3– «Dieu ne veut point d’un cœur où le monde domine» Polyeucte, I, 1). Le théâtre de Pierre Corneille fait ainsi écho aux tournures du Grand Siècle dont il reflète aussi les valeurs comme l’honneur et les grandes interrogations, sur le pouvoir par exemple (contexte de la mort de Richelieu et de Louis XIII), la question de la guerre civile dans La Mort de Pompée (1643), ou la lutte pour le trône dans Nicomède (1651, dans le contexte de la Fronde). Biographie Une famille de récente bourgeoisie Le berceau de la famille Corneille est situé à Conches-en-Ouche où les Corneille sont agriculteurs et marchands tanneurs. Le plus lointain ancêtre retrouvé est Robert Corneille, arrière-grand-père du dramaturge, qui possède un atelier de tannerie établi en 1541. Son fils aîné, Pierre se marie en 1570 avec Barbe Houel, nièce d’un greffier criminel du Parlement de Rouen; il devient commis greffier de son oncle par alliance. Il achète ensuite de modestes charges d’officier («maître particulier des eaux et forêts de la vicomté de Rouen» et conseiller référendaire à la Chancellerie), ce qui lui permet d’obtenir une licence en droit, de devenir avocat en 1575 et d’acheter en 1584 deux maisons rue de la Pie, où naîtra le futur dramaturge. La famille Corneille accède ainsi à la petite bourgeoisie de robe. L’aîné de ses enfants, lui aussi nommé Pierre, devient en 1599 «Maître enquêteur des Eaux et Forêts du bailliage de Rouen». En 1602, il épouse Marthe Le Pesant, fille d’avocat, sœur d’un notaire. En 1619, il vend sa charge pour vivre de ses rentes. Pierre, avocat du roi, et Marthe Corneille ont huit enfants, dont deux morts prématurément; le futur dramaturge est l’aîné des six frères et sœurs restants, le plus jeune ayant vingt-trois ans de moins que lui. Une formation de juriste Il fait de brillantes études secondaires au collège de Bourbon (aujourd’hui lycée Corneille) dirigé par les jésuites. Il remporte plusieurs prix et se découvre une passion pour l’éloquence des stoïciens latins et pour la pratique théâtrale que les jésuites ont introduite dans leur collèges dans une perspective pédagogique. Puis, comme tous les aînés Corneille, il fait des études de droit. Il prête serment comme avocat le 18 juin 1624 au Parlement de Rouen. En 1628 son père lui achète pour 11 600 livres deux offices d’avocat du roi, au siège des Eaux et Forêts et à l’amirauté de France à la Table de marbre de Rouen. Il prend ses fonctions le 16 février 1629. Timide et peu éloquent, il renonce à plaider. Tout en continuant son métier d’avocat, qui lui apporte les ressources financières nécessaires pour nourrir sa famille de six enfants, il se tourne alors vers l’écriture et le théâtre dont ses personnages lui permettent de retrouver la vocation d’orateur qui lui faisait défaut comme plaideur. Des débuts comme auteur de comédies (1629-1636) En 1625, il connut un échec sentimental avec Catherine Hue, qui préfèra épouser un plus beau parti, Thomas du Pont, conseiller-maître à la cour des comptes de Normandie. Ces premières amours le conduisirent à écrire ses premiers vers, à la suite de quoi il passa naturellement à ce qu’on appelait à l’époque «la poésie dramatique», phénomène fréquent à cette époque chez les jeunes diplômés en droit qui tâtaient de la poésie. Tandis que les autres jeunes poètes de sa génération n’écrivaient que des tragi-comédies et des pastorales (la tragédie et la comédie connaissaient une certaine désaffection depuis quelques années), il eut l’idée de transposer dans un cadre «comique» (l’action se passe dans une ville et les jeunes héros sont des citadins) un modèle d’intrigue issu de la pastorale. Ainsi apparut Mélite, qu’il qualifia dans la première édition de «pièce comique» et non pas de comédie, forme nouvelle de «comédie sentimentale» fondée sur les déchirements du cœur et une conception nouvelle du dialogue de théâtre qu’il qualifiera lui-même trente ans plus tard de «conversation des honnêtes gens», loin des formes comiques alors connues qu’étaient la farce et la comédie bouffonne à l’italienne. Le jeune avocat-poète proposa sa pièce à l’une des nombreuses «troupes de campagne» qui venaient régulièrement jouer quelques semaines à Rouen, mais il sut choisir l’une des deux meilleures, la troupe du prince d’Orange, dirigée par Montdory et Le Noir, qui la donna avec succès à Paris quelques semaines après son passage à Rouen (1629). La troupe la joua avec succès sur la scène de l’hôtel de Bourgogne juste avant que l’autre troupe importante, celle des Comédiens du Roi, dirigée par Bellerose, ne loue cette salle pour une durée indéterminée, offrant enfin à Paris sa première troupe installée de façon permanente. Il semble que Montdory ait voulu profiter du succès de Mélite pour s’implanter à son tour à Paris et c’est ainsi que la «troupe du prince d’Orange», après avoir joué dans divers jeux de paume, finit par s’installer à demeure dans l’un d’entre eux, le jeu de paume du Marais en 1634 et devint dès lors la troupe du théâtre du Marais. Tel est le sens des mots de Corneille, trente ans plus tard: «Le succès [de Mélite] en fut surprenant. Il établit une nouvelle troupe de Comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui était en possession de s’y voir l’unique». Après la parenthèse de Clitandre, tragi-comédie échevelée qui résulta sans doute d’une commande de Montdory (la mode était alors à ce type de théâtre romanesque), Corneille revint à la veine comique qu’il avait lui-même ouverte en donnant successivement pour la même troupe La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante et La Place Royale, dont le dénouement (cette pièce est l’une des seules comédies du XVIIe siècle, avec Le Misanthrope de Molière trente ans plus tard, qui ne se termine pas par le mariage des jeunes amoureux) semble marquer un adieu à cette veine comique. Ce que confirme L’Illusion comique, la comédie qu’il écrira deux ans plus tard—après l’expérience de la tragédie Médée (sur cette tragédie voir plus bas)—, génial pot-pourri dans lequel s’emboîtent un commencement de pastorale (avec sa grotte et son magicien), une comédie à l’italienne (avec son capitan fanfaron Matamore), une tragi-comédie et pour finir une tragédie (créée sans doute en 1636, elle fut publiée en 1639). En 1633, sur l’invitation de l’archevêque de Rouen François Harlay de Champvallon, il écrit une pièce de vers latins, Excusatio, en l’honneur de Louis XIII, de la reine et de Richelieu alors en cure près de Rouen à Forges-les-Eaux. Il devient dès lors l’un des protégés du cardinal, féru de théâtre, qui lui verse, comme à plusieurs autres dramaturges, une pension de 1 500 livres. Mais cette faveur a une contrepartie: Richelieu, qui n’a pas le temps d’écrire pour le théâtre, rêve d’un groupe d’auteurs qui écriraient des pièces à partir de ses idées de sujet. C’est ainsi qu’en 1635, Richelieu réunit une société dite «des Cinq Auteurs» et constituée de François Le Métel de Boisrobert, Claude de L’Estoile, Jean Rotrou et Guillaume Colletet. Ainsi vit le jour une première pièce, La Comédie des Tuileries, dont le canevas avait été rédigé par Jean Chapelain, le grand critique et théoricien dramatique de la période, sur une idée de Richelieu; les cinq auteurs pour leur part s’étaient partagés la versification d’un acte chacun (et les avis divergent encore aujourd’hui pour savoir quel est l’acte qu’a versifié Corneille. La légende veut que, peu satisfait par cette expérience, Corneille se soit vite retiré du groupe en prétextant ses devoirs familiaux et professionnels à Rouen. Mais s’il est vrai qu’en 1638 la préface de L’Aveugle de Smyrne (joué au Palais-Cardinal l’année précédente) donne à croire que l’un des cinq auteurs se serait abstenu, aucun document d’époque ne permet de penser qu’il se soit agi de Corneille et que les relations entre Corneille et Richelieu en auraient été refroidies. Au cours de l’année 1634, sans doute incité par le succès de la Sophonisbe de Jean Mairet et de Hercule mourant de Jean Rotrou qui marquent le retour de la tragédie régulière sur les scènes parisiennes après un effacement de plusieurs années, il écrit sa première tragédie, Médée, qui semble avoir été très bien accueillie, contrairement à une légende apparue au XVIIIe siècle (comme toujours): Corneille critiquera sa grande irrégularité vingt ans plus tard dans l’«Examen» de la pièce, tout en rappelant que c’était l’usage à ce moment-là, sans laisser entendre que la pièce n’avait pas eu de succès; en outre, le fait qu’il ne l’ait publiée qu’en 1639 pour en laisser l’exclusivité à la troupe du Marais qui l’avait créée quatre ans plus tôt, donne à penser que la pièce fut fréquemment reprise au théâtre, jusqu’à ce que l’apparition des nouvelles tragédies cornéliennes à partir de 1640 ne la démode. La consécration comme auteur de tragédies (1637-1651) Le Cid et la querelle du Cid (1637-1640) Créé en janvier 1637 sur la scène du théâtre du Marais, Le Cid a été ressenti par les spectateurs contemporains comme une véritable révolution et produisit un choc de même nature que trente ans plus tard Andromaque de Jean Racine (1667), et dans le genre comique L’École des femmes de Molière (1662-1663). Cette révolution provoqua un véritable scandale chez les rivaux de Corneille et chez certains lettrés, ce qui déclencha la querelle du Cid et déboucha sur la condamnation de la pièce par la toute récente Académie française dans un texte intitulé Les Sentiments de l’Académie sur la tragi-comédie du Cid qui parut en décembre 1637. Corneille, ébranlé, se plongea dans les ouvrages de théorie dramatique (d’Aristote à ses commentateurs italiens de la Renaissance) et n’écrivit plus pour le théâtre jusqu’à la fin de 1639, époque vers laquelle il se lança dans sa première tragédie romaine Horace. Si Le Cid a bouleversé le paysage dramatique de l’époque, c’est qu’il s’agissait certes d’une tragi-comédie (le genre à la mode en ces années-là)—et l’on retrouve dans le cadre d’un obstacle venu séparer deux amoureux qui se marient à la fin, des duels, des batailles, un enjeu politique superficiel—mais d’une tragi-comédie d’un type nouveau: action physique rejetée dans les coulisses et traduite par les mots, personnages historiques, affrontement passionnel inouï jusqu’alors et surtout une conception nouvelle de l’obstacle tragi-comique. Alors que le principe de la tragi-comédie reposait sur une séparation des amoureux par un obstacle susceptible de se résoudre à la fin pour permettre leur mariage, Corneille choisit d’adapter Las Mocedades del Cid de Guilhem de Castro qui racontait l’histoire d’un héros légendaire espagnol qui avait épousé la fille de l’homme qu’il avait tué: c’est-à-dire un sujet fondé sur un obstacle qu’il est impossible de résoudre à la fin. En effet, Rodrigue et Chimène se marient à la fin (c’est pourquoi la pièce est bien une tragi-comédie), mais le père de Chimène est bel et bien mort. C’est la présence de ce mort à l’arrière-plan qui crée les si beaux affrontements passionnels entre Chimène et Rodrigue, qui ravirent le public de l’époque; mais c’est aussi ce qui fut la source du scandale déclenché chez les lettrés. Car en racontant ainsi l’histoire d’une fille qui épouse le meurtrier de son père, Corneille avait enfreint la principale des règles de la dramaturgie classique en cours d’élaboration, la vraisemblance: sur le plan de l’intrigue, il était jugé invraisemblable qu’une fille épouse le meurtrier de son père (le fait peut être vrai, mais il est contraire au comportement attendu d’un être humain, donc invraisemblable), et sur le plan du caractère du personnage de Chimène, il était jugé invraisemblable qu’une fille présentée comme vertueuse ose avouer au meurtrier de son père qu’elle continue à l’aimer. Condamné par les «doctes» et par leur organe institutionnel qu’était l’Académie, Le Cid n’en continua pas moins sa carrière triomphale sur la scène du Marais et bientôt sur toutes les scènes de France par l’intermédiaire des nombreuses «troupes de campagne» qui sillonnaient le pays et même une partie de l’Europe. Ce succès public confirma Corneille dans l’idée que les meilleurs sujets de théâtre sont ceux qui transportent le public par le spectacle d’événements inouïs. C’est pourquoi, loin de faire amende honorable, et de corriger le dénouement du Cid (on lui avait proposé de faire découvrir à Chimène que son père mort n’était pas son vrai père, ou bien que son père laissé pour mort sur le lieu du combat paraissait pouvoir être sauvé), il choisit un nouveau sujet qui supposait le même type d’événement extraordinaire: Horace raconte en effet comment un héros qui revient triomphant d’un combat dans lequel il a sauvé sa patrie est conduit à tuer sa propre sœur. Un sujet qui sera jugé tout aussi inacceptable par les doctes (même s’il arrive qu’un homme puisse tuer sa sœur, c’est un acte invraisemblable au regard du comportement attendu des êtres humains). D’Horace à La Mort de Pompée: les chefs-d’œuvre «romains» de Corneille (1639-1643) Au début de janvier 1639, Jean Chapelain, homme fort de l’Académie française et principal rédacteur des Sentiments de l’Académie qui avaient condamné Le Cid, écrivait à un de ses amis: «Corneille est ici depuis trois jours, et d’abord m’est venu faire un éclaircissement sur le livre de l’Académie pour ou plutôt contre Le Cid, m’accusant et non sans raison d’en être le principal auteur. Il ne fait plus rien, et Scudéry a du moins gagné cela, en le querellant, qu’il l’a rebuté du métier et lui a tari sa veine. Je l’ai autant que j’ai pu réchauffé et encouragé à se venger et de Scudéry et de sa protectrice [l’Académie] en faisant quelque nouveau Cid qui attire encore les suffrages de tout le monde et qui montre que l’art n’est pas ce qui fait la beauté; mais il n’y a pas moyen de l’y résoudre: et il ne parle plus que de règles et que de choses qu’il eût pu répondre aux académiciens, s’il n’eût point craint de choquer les puissances, mettant au reste Aristote entre les auteurs apocryphes, lorsqu’il ne s’accommode pas à ses imaginations.» Au début de 1639, Corneille était donc encore plongé dans une intense réflexion théorique, et il n’avait pas encore trouvé un nouveau sujet de pièce. Sa réflexion dut être encore retardée par les conséquences de la mort de son père, survenue le 12 février de la même année, qui le laissa à 33 ans chef de famille (avec sa mère) et tuteur de deux enfants mineurs, une sœur de 16 ans (Marthe, future mère de Fontenelle) et un frère de 14 ans (Thomas, futur auteur dramatique). C’est donc au cours du second semestre de 1639 qu’il trouva son sujet et se lança dans la rédaction. On sait par une autre lettre de Chapelain que le 9 mars 1640 Horace a déjà été joué en privé devant le cardinal de Richelieu (ainsi qu’un comité de «doctes» qui ont suggéré des remaniements, refusés par Corneille) et qu’on attend sa création sur la scène du théâtre du Marais. Horace, première tragédie historique et romaine de Corneille, ouvre ainsi la deuxième partie de sa carrière, et sera suivi de trois autres tragédies romaines Cinna (hiver 1641-1642), Polyeucte (hiver 1642-1643), La Mort de Pompée (hiver 1643-1644). Sujet puisé dans l’histoire antique, stricte régularité de l’action, du temps et du lieu, Corneille a en partie répondu aux vœux des doctes, tout en conservant le principe des sujets à la limite de la vraisemblance, la violence des passions et la construction de héros qui forcent l’admiration. En même temps il a rejoint et sublimé la thématique développée dès la décennie précédente dans les tragédies historiques de ses confrères: confrontation de l’héroïsme et de l’État doublant la confrontation de l’héroïsme et de l’amour, inscrite dans un devenir historique et dans une réflexion sur la portée des actes individuels. S’il a désormais tourné le dos à la tragi-comédie (il rebaptisera bientôt Le Cid «tragédie»), il a l’idée de transposer sa caractéristique principale (le dénouement nuptial) dans le genre tragique, à l’occasion de Cinna, créant ainsi la formule de la tragédie à fin heureuse, appelée à une belle carrière. Le succès de cette veine fut tel qu’il hissa définitivement Corneille au-dessus de tous ses rivaux et qu’il commença à être considéré par les Français comme le plus grand dramaturge moderne, Guez de Balzac n’hésitant pas à le qualifier de Sophocle dans une lettre qu’il lui adressa au début de 1643, au lendemain de la publication de Cinna. Mariage (1641) En 1641, il épouse grâce à l’intervention de Richelieu une jeune aristocrate, Marie de Lampérière, fille de Matthieu de Lampérière, lieutenant-général des Andelys. De ce mariage naîtront huit[réf. souhaitée] enfants: deux filles et six[réf. souhaitée] garçons, dont deux morts prématurément. Son jeune frère Thomas épousera plus tard la seconde fille du lieutenant-général, Marguerite. Cette intervention de Richelieu en sa faveur, cinq ans après que le même Richelieu avait exigé de l’Académie française qu’elle donne son avis sur la conformité du Cid aux règles dramatiques, explique les sentiments mitigés de Corneille au lendemain de la mort du cardinal-ministre, exprimés dans un quatrain resté célèbre (1643): Début du règne de Louis XIV et période de la Fronde (1643-1651) Avec Rodogune (hiver 1644-45), Corneille abandonna la tragédie romaine pour explorer les confins du monde méditerranéen antique, ce qui lui offrit l’occasion de dramatiser les jeux politiques liés à la succession dynastique, s’orientant vers ce qu’il qualifia lui-même dans ses textes théoriques de «tragédie implexe», fondée sur la complexité de l’intrigue. Il approfondit cette dramaturgie «implexe» et cette thématique dynastique deux ans plus tard avec Héraclius, qui, reposant sur une double substitution d’enfants, est sans doute la première tragédie moderne de l’identité (la première tragédie antique de l’identité étant Œdipe), Corneille ayant établi une liaison étroite entre la quête de l’identité du héros et les questions de légitimité politique et d’amour princier. Cette problématique, qui s’esquisse même dans la grande et triomphale tragédie à machines Andromède (prévues pour le carnaval 1648, mais montée seulement en janvier 1650 à cause des troubles de la Fronde), se retrouve dans Don Sanche d’Aragon (comédie héroïque, 1649) et dans Pertharite (1652). Pour autant, Corneille ne renonce pas tout à fait à la comédie, profitant de la mode de la comédie à l’espagnole sur les deux théâtres parisiens pour lancer Le Menteur (premier trimestre 1644), dont le succès fut tel qu’il l’incita à lui donner une suite, qui fut un échec (La Suite du Menteur, premier trimestre 1645) et le détourna définitivement de la comédie. On a longtemps pensé que de 1643 à 1652, c’est-à-dire de la mort de Richelieu (décembre 1642) puis de Louis XIII (mai 1643) à la fin de la Fronde, Corneille avait cherché à prendre en compte la crise que traversait la France: en fait, les tragédies de complot, de succession dynastique et de guerre civile sont apparues dès le XVIe siècle avec la naissance de la tragédie moderne; mais tandis que toutes les œuvres de ses confrères étaient oubliées, Corneille en portant ce type de pièce à la perfection a donné l’impression de l’avoir inventé et d’avoir été le seul à «dialoguer» avec la réalité historique et politique de son temps. Malgré son peu de goût pour le mécénat, Mazarin fit mine de reprendre sur ce plan la politique de Richelieu et offrit à Corneille une pension de 1 000 livres. Cela n’empêcha pas le poète de subir deux échecs à l’Académie française; la raison invoquée étant que, habitant en province, il ne pourrait assister aux réunions. Mais il fut finalement élu le 22 janvier 1647 au fauteuil 14, qui sera occupé par son frère Thomas après sa mort. Compte tenu de sa fidélité à l’autorité royale durant la Fronde, Mazarin lui offrit un emploi officiel inattendu: il destitua le procureur général des états de Normandie (un fidèle du duc de Longueville qui avait tenté de soulever la Normandie) et nomma Corneille à sa place le 12 février 1650. Du coup, pour assumer ses nouvelles fonctions, Corneille dut vendre ses deux charges d’avocat à la Table de Marbre du Palais (18 mars 1650), mais un an plus tard, à la faveur de la rentrée en grâce des princes et de l’exil en Allemagne de Mazarin, l’ancien titulaire fut rétabli dans sa charge de procureur, et Corneille fut remercié. Il se retrouva sans fonctions officielles et sans sa pension, puisque Mazarin était exilé. On voit que le succès de la tragédie Nicomède en janvier 1651 que nombre de contemporains ont lu comme un éloge à peine voilé du Grand Condé, meneur de la Fronde alors emprisonné, n’a été pour rien dans les soubresauts de la carrière officielle de Corneille: c’est au moment même où Nicomède triomphait que Condé est sorti de prison et que Mazarin s’est exilé, et c’est justement la victoire (provisoire) du héros qui a fait perdre à Corneille sa belle position de procureur général. Il fut en somme l’une des nombreuses victimes de cette immense partie de dupes que constitua la Fronde. Les années 1650 Abandon de l’écriture dramatique (1652-1658) En novembre 1651 sont achevés d’imprimer presque en même temps sa tragédie de Nicomède et un volume regroupant les vingt premiers chapitres de sa traduction de l’Imitation de Jésus Christ qui va se révéler un extraordinaire succès de librairie avec 2 300 éditions et près de 2.4 millions d’exemplaires en circulation à la fin du XVIIIe siècle, ce qui en fait à cette époque le livre le plus souvent imprimé après la Bible. Et c’est probablement le mois suivant qu’est créé Pertharite (décembre 1651 ou janvier 1652), une puissante tragédie qui chute brutalement sans qu’on en connaisse la raison exacte; l’absence à peu près totale de créations de nouvelles tragédies dans les deux théâtres parisiens au cours des quatre années suivantes incite à penser que les spectateurs, lassés par les complexes enjeux politiques de la Fronde, se sont détournés de la tragédie du fait de son cadre historique et de sa thématique politique (l’action de Pertharite se déroule en pleine guerre civile). En somme, Pertharite serait la première tragédie qui aurait fait les frais de cette lassitude du public, sans que le talent créateur de Corneille soit en cause. Il en profite cependant pour annoncer sa retraite du théâtre—il peut se le permettre puisqu’il est au comble d’une gloire qui court d’un bout à l’autre de l’Europe—et pour se consacrer entièrement à la très pieuse et très lucrative entreprise de traduction de l’Imitation de Jésus-Christ. La fin du livre I et le début du livre II paraissent à la fin d’octobre 1652; en juin 1653, les deux premiers livres complets paraissent, augmentés de gravures au commencement de chaque chapitre. Suit le livre III en 1654 et le livre IV (et dernier) en 1656 qui donnera l’occasion d’une édition, cette fois complète, de l’ensemble, avec une dédicace au pape Alexandre VII. Durant l’été de 1654, pour des raisons que nous ignorons, Corneille et sa femme firent un séjour aux eaux de Bourbon (la plus courue des stations thermales au XVIIe siècle); on ne sait si le séjour avait été recommandé pour lui ou pour sa femme, mais l’on observe que quelques mois plus tard, en 1655, celle-ci accouche de Madeleine, leur sixième enfant et troisième fille; suivra en 1656 Thomas, leur dernier enfant. L’aboutissement du chantier de l’Imitation de Jésus-Christ a manifestement réveillé chez Corneille l’envie d’écrire à nouveau pour le théâtre. D’autant qu’à ses côtés son jeune frère Thomas après avoir enchaîné les succès avec une longue série de comédies, vient de se lancer dans l’écriture d’une tragédie romanesque (Timocrate) qui, créée au théâtre du Marais en décembre de cette même année 1656, se révélera l’un des plus grands succès du siècle. On sait ainsi, par le témoignage d’une connaissance rouennaise de Pierre Corneille, qu’en juillet 1656 il est déjà occupé à écrire «la tragédie de La Toison d’or». Commandée par le marquis de Sourdéac, un original passionné de machineries théâtrales (et qui fera construire treize ans plus tard la première salle d’opéra de Paris rue Guénégaud), cette pièce à grand spectacle ne sera créée que cinq ans plus tard au théâtre du Marais, où elle connaîtra un extraordinaire succès. On comprend pourquoi, après avoir achevé cette pièce et en attendant sa création, il a pu se lancer d’abord dans une grande entreprise de révision de toutes ses pièces de théâtre (l’édition, accompagnée d’examens critiques de chaque pièce et de trois «Discours» théoriques sur le théâtre en tête de chacun des trois volumes paraîtra en 1660) et ensuite dans l’écriture d’une nouvelle tragédie: il accepte avec enthousiasme à l’automne de 1658 la proposition du grand mécène de cette période, le surintendant Fouquet, de faire sa grande rentrée au théâtre en reprenant le sujet le plus célèbre de la tradition tragique, l’histoire d’Œdipe. La tragédie d’Œdipe fut ainsi créée sur la scène du théâtre de l’hôtel de Bourgogne le 24 janvier 1659: le succès fut tel que Corneille se trouva relancé pour quinze ans. Le rendez-vous manqué de Corneille et de Molière (1658-1659)? À la mi-mai 1658 Thomas Corneille écrit à un de leurs amis parisiens, le galant abbé de Pure (auteur d’un vaste roman intitulé La Précieuse): «Nous attendons ici les deux beautés que vous croyez pouvoir disputer cet hiver d’éclat avec la sienne [la beauté de Mlle Baron, actrice parisienne]. Au moins ai-je remarqué en Mlle Béjart grande envie de jouer à Paris, et je ne doute point qu’au sortir d’ici, cette troupe n’y aille passer le reste de l’année. Je voudrais qu’elle voulût faire alliance avec le Marais, cela en pourrait changer la destinée. Je ne sais si le temps pourra faire ce miracle.» L’abbé de Pure sait donc déjà que Molière et sa troupe ont annoncé leur intention de tenter de prendre pied à Paris durant l’hiver 1658-1659, et Thomas Corneille le lui confirme après en avoir parlé avec Madeleine Béjart, arrivée à Rouen avant le reste de la troupe («les deux beautés», Catherine de Brie et Marquise Du Parc étaient restées en arrière parce que Marquise venait d’accoucher à Lyon). Beaucoup d’historiens du théâtre et de biographes de Molière se sont interrogés sur ce séjour de Molière à Rouen et certains ont même imaginé qu’il était venu rencontrer Corneille. Le rédacteur de la vie de Molière qui a paru dans la grande édition posthume des Œuvres de Molière en 1682 donnait pourtant une raison plus prosaïque, qui est corroborée par les termes de la lettre de Thomas Corneille à l’abbé de Pure: «En 1658, ses amis lui conseillèrent de s’approcher de Paris, en faisant venir sa Troupe dans une Ville voisine: c’était le moyen de profiter du crédit que son mérite lui avait acquis auprès de plusieurs personnes de considération, qui s’intéressant à sa gloire, lui avaient promis de l’introduire à la Cour. Il avait passé le carnaval à Grenoble, d’où il partit après Pâques, et vint s’établir à Rouen. Il y séjourna pendant l’Été, et après quelques voyages qu’il fit à Paris secrètement, il eut l’avantage de faire agréer ses services et ceux de ses camarades à MONSIEUR, Frère Unique de Sa Majesté, qui lui ayant accordé sa protection, et le titre de sa Troupe, le présenta en cette qualité au Roi et à la Reine Mère.» Autrement dit, pour pouvoir prendre pied à Paris, il fallait à Molière et à sa troupe un protecteur le plus haut placé possible, ainsi qu’un théâtre: s’installer dans une ville assez proche de Paris pour pouvoir y faire de nombreux allers-retours pour avancer dans les négociations et rencontrer les «personnes de considération» qui appuyaient ces démarches était donc un choix stratégique. Ce choix de se rapprocher de Paris en séjournant à Rouen était d’autant plus logique que Rouen était alors constamment visitée par des troupes de comédiens qui y faisaient des séjours de plusieurs semaines, et pas seulement des troupes de campagne comme celle de Molière; en 1674, Samuel Chappuzeau rapporte dans son ouvrage intitulé Le Théâtre françois que même la troupe du théâtre du Marais y faisait de fréquents séjours: «Cette Troupe allait quelquefois passer l’Été à Rouen, étant bien aise de donner cette satisfaction à une des premières Villes du Royaume. De retour à Paris de cette petite course dans le voisinage, à la première affiche le Monde y courait, et elle se voyait visitée comme de coutume.» Et l’on sait par ailleurs que Molière et les Béjart avaient déjà séjourné quelques semaines à Rouen avec leur première troupe («L’Illustre théâtre») pendant qu’on aménageait leur théâtre à Paris (automne de 1643), quelques mois avant la troupe du Marais dont la salle brûla en janvier 1644 et qui vint jouer à Rouen pendant qu’on reconstruisait le bâtiment. En dehors de cette lettre de Thomas Corneille, les seules relations avérées entre les frères Corneille et la troupe de Molière tiennent à quelques poésies galantes adressées par les deux frères à la belle Marquise (Mademoiselle Du Parc), épouse de l’acteur Du Parc, dit «Gros-René»; en particulier les célèbres stances «À Marquise», l’une des plus jolies poésies de Pierre Corneille. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux amateurs de romanesque en ont déduit que le pauvre Corneille vieillissant aurait été un amoureux transi de la belle comédienne. Mais le fait que les deux frères se soient ainsi livrés à une aimable joute poétique, le fait que Pierre ait repris le thème de la belle indifférente à la beauté passagère face au vieux poète dont les vers assurent l’immortalité (c’était déjà le thème du «Quand vous serez bien vieille…» de Ronsard, un siècle plus tôt) et enfin le fait que Pierre ait écrit d’autres poèmes de même tonalité à d’autres femmes tout aussi inaccessibles que Marquise durant la même période, tout cela montre que les frères Corneille se sont laissés griser à cette période de leur vie par une vie mondaine rouennaise plus intense que par le passé et calquée sur la vie mondaine parisienne: deux ans plus tard, toutes leurs petites poésies galantes (18 en tout) paraîtront à Paris dans la cinquième livraison du «recueil Sercy» aux côtés des poèmes de même acabit composés par les poètes et les beaux esprits parisiens. En dehors de cette occasion de jeu mondain, Pierre Corneille semble avoir été peu sensible à la présence de la troupe de Molière dans sa ville: ce n’était qu’une troupe de campagne de plus, parmi toutes celles qui occupaient régulièrement l’un des deux jeux de paume dans lesquels la municipalité autorisait les représentations théâtrales. On en a la preuve dans une lettre qu’il écrit lui-même le 9 juillet 1658 à l’abbé de Pure: «Mon frère vous salue, et travaille avec assez de chagrin. Il ne donnera qu’une pièce cette année. Pour moi, la paresse me semble un métier bien doux, et les petits efforts que je fais pour m’en réveiller s’arrêtent à la correction de mes ouvrages. C’en sera fait dans deux mois, si quelque nouveau dessein ne l’interrompt. J’en voudrais avoir un. Je suis de tout cœur votre très humble et très obligé serviteur Corneille.» Ainsi la troupe de Molière joue à Rouen depuis plusieurs semaines et cela n’a donné aucune envie pressante à Corneille de se lancer de nouveau dans l’écriture théâtrale: il lui faudra attendre trois mois plus tard d’être présenté à Fouquet à l’occasion d’un voyage à Paris pour se laisser tenter par l’un des sujets de tragédie proposés par le surintendant. Ce sera Œdipe. Mais sur ce point encore on observe que les liens entre Corneille et Molière étaient si peu étroits que, loin de proposer sa nouvelle pièce à la troupe de Molière qui venait à peine de s’installer à Paris (elle commença à jouer devant le public au début de novembre 1658) et qui aurait pu profiter de cette formidable publicité constituée par le retour de Corneille au théâtre, c’est à la plus célèbre troupe parisienne, celle de l’Hôtel de Bourgogne, que le grand poète s’est empressé de confier sa tragédie. Depuis qu’au XIXe siècle la publication du Registre de La Grange (un extrait des registres de compte effectué par le comédien La Grange, bras droit de Molière puis l’un des hommes forts des débuts de la Comédie-Française) a fait découvrir le répertoire de la troupe de Molière depuis Pâques 1659, on a pu constater qu’elle avait joué deux fois plus de tragédies de Corneille que de tragédies de Tristan l’Hermite, de Rotrou, de Magnon etc. et que de comédies de Scarron, de Boisrobert et de Thomas Corneille, comme si malgré tout des liens privilégiés s’étaient établis entre les deux hommes. En fait, l’examen du Mémoire de Mahelot—un aide-mémoire destiné aux décorateurs de l’Hôtel de Bourgogne qui recense les pièces au répertoire de ce théâtre—montre les mêmes proportions: pour tous les théâtres à cette époque, lorsqu’il fallait vivre de reprises entre deux créations de pièces nouvelles, c’est le plus souvent vers Corneille qu’on se tournait (en attendant que Racine le rejoigne). Et depuis longtemps tous les historiens du théâtre ont remarqué que trois ans plus tard, dans sa préface des Fâcheux (publié en février 1662), Molière devait ironiser sur la posture de «grand auteur» adoptée par Corneille lorsqu’il publia les trois volumes de son Théâtre (1660) accompagnés de Discours et d’Examens. Le rendez-vous entre les deux hommes avait donc bel et bien été manqué: s’ils s’étaient évidemment rencontrés à cette occasion, cela n’avait pas eu de conséquence sur leurs carrières respectives; il allait falloir attendre la montée en puissance de l’ambitieux et brillant Jean Racine et sa brouille avec Molière (survenue en décembre 1665 après la création de Alexandre le Grand) pour que s’opère un rapprochement entre Corneille et Molière qui débouchera sur la création d’Attila. Les années 1659-1674 Une nouvelle manière d’écrire des tragédies? Tandis que La Conquête de la Toison d’or mise en chantier dès 1656 et créée en 1661 reprend le même type de sujet mythologique et la même dramaturgie «à machines» que Andromède, c’est véritablement avec Œdipe que Corneille a entamé la dernière partie de sa carrière. On parle volontiers de période de la vieillesse, du fait d’une sorte de corrélation entre l’âge de Corneille, la mise sur la scène de héros vieillissants (Sertorius, 1662, ou Pulchérie, 1672) ou apparemment dépourvus de vertus héroïques actives (Othon, 1664), et l’issue de la dernière tragédie, l’une de ses plus belles, où le héros s’abandonne à la mort (Suréna, 1674). Pourtant les six ans de «retraite» n’ont pas marqué de rupture dans sa conception théâtrale, comme le révèle tout ce qui rapproche Héraclius et Œdipe, deux tragédies de l’identité, et comme le confirment les Examens de ses pièces et les Discours théoriques qu’il publie dans la grande édition de son Théâtre de 1660. Ce qui paraît nouveau, c’est que l’accession au pouvoir du héros ne passe plus par la reconnaissance de son identité ou simplement de son héroïsme, mais par une combinaison de mariages; en fait, l’expression de tragédies matrimoniales qu’on applique à ces œuvres ne doit pas masquer que la nature même de la tragédie cornélienne n’a pas changé et que Corneille a simplement substitué à une dramaturgie de l’affirmation de l’héroïsme une dramaturgie de l’effacement volontaire de l’héroïsme: conscience de sa vieillesse dans Sertorius, nécessité de dissimuler ses qualités en présence d’une cour corrompue dans Othon ou d’un tyran violent et raffiné (Attila, 1667), ravalement au plus profond de soi de l’héroïsme et des sentiments pour garder sa liberté face à un pouvoir jaloux dans Suréna, dans tous les cas l’héroïsme réside dans la contrainte sur soi, ce qui explique qu’il débouche si facilement sur la mort (en particulier dans Sertorius et Suréna). Corneille reconnaît également, ainsi qu’il l’écrit à Charles de Saint-Evremond en 1666, avoir «avancé touchant la part que l’amour doit avoir dans les belles tragédies.» De fait, il a toujours pensé que l’amour était une passion trop chargée de foiblesse pour être la dominante», précisant: «J’aime qu’elle y serve d’ornement, et non pas de corps.» De là, vient «[s]on foible» pour Sophonisbe, qui lui semble illustrer parfaitement ses principes, contraires à ceux de «nos doucereux et nos enjoués.» Paris, Molière et Racine En octobre 1662, les deux familles de Pierre et de Thomas Corneille quittent la maison natale de la rue de la Pie à Rouen pour s’installer à Paris à l’invitation du duc Henri II de Guise. Protecteur du théâtre du Marais, le duc était depuis longtemps un admirateur des frères Corneille et c’est à lui que Thomas avait dédié sa tragédie de Timocrate lorsqu’elle fut publiée cinq ans plus tôt. Les deux familles sont logées gracieusement dans l’hôtel du duc au cœur du Marais et elles y resteront au moins deux ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à la mort du duc en juin 1664. Les raisons de ce déménagement sont aisées à comprendre: dès les années 1640, Corneille avait été pressé de venir s’installer à Paris, et son refus avait été la raison de ses échecs à l’Académie française: il avait alors charge de famille et il était même encore tuteur de son jeune frère Thomas. En 1662, tout a changé: il n’a plus que trois jeunes enfants au foyer et Thomas de son côté (qui a épousé la jeune sœur de la femme de Corneille) est devenu depuis le milieu des années 1650 l’auteur de théâtre à la mode, volant de succès en succès. Depuis le retour de Corneille au théâtre et l’excellent accueil d’Œdipe, lui aussi a renoué avec le succès, confirmé par la création de Sertorius au Marais en février 1662: venir vivre à Paris, c’est venir cueillir les fleurs de sa gloire. Les deux frères tentent alors d’exercer une sorte de magistère sur le théâtre, encourageant l’engagement d’une comédienne par ci, fomentant une cabale contre L’École des femmes de Molière par là, un Molière qui, il est vrai, poursuivait le grand homme de ses sarcasmes depuis la préface des Fâcheux et qui s’était moqué du titre de noblesse de Thomas (Thomas Corneille de L’Île) dans la première scène de L’École des femmes… Mais la faveur croissante de Molière, qui triomphe aussi bien à la Ville (sur son théâtre du Palais-Royal) qu’à la Cour où à partir de 1664 il semble être devenu aussi indispensable au roi Louis XIV que le musicien Lully, les très grands succès de certains de ses jeunes confrères (son propre frère Thomas et Philippe Quinault), et l’apparition d’un nouvel auteur qui obtient un triomphe dès sa deuxième tragédie (Racine, Alexandre le Grand, décembre 1665) mais se brouille avec la troupe de Molière au profit de la troupe rivale de l’hôtel de Bourgogne, tout cela change la donne. Tandis que l’hôtel de Bourgogne a de moins en moins besoin du «grand Corneille» dont la dernière pièce Agésilas n’a pas été un succès (février 1666), Molière et sa troupe, toujours en quête d’auteurs de tragédies pour diversifier la programmation du Palais-Royal, offrent à Corneille la forte somme de 2 000 livres d’avance pour sa nouvelle tragédie, Attila, qui est créée au Palais-Royal le 4 mars 1667. Mais la pièce ne connaît qu’un succès honorable alors que, huit mois plus tard, Andromaque de Racine sera un triomphe et marquera l’émergence d’une nouvelle conception de la tragédie. Déjà engagé dans une nouvelle traduction d’une œuvre de piété, l’Office de la Vierge, énorme travail qui paraîtra à la fin de 1669, Corneille prend son temps pour proposer une nouvelle pièce de théâtre. Il a l’idée de reprendre l’histoire de la séparation de Titus et de Bérénice pour en faire une «comédie héroïque» et semble avoir sondé les différents théâtres afin de vendre sa pièce au plus offrant: la troupe du Palais-Royal l’emporte en proposant une nouvelle fois 2 000 livres d’avance, tandis que l’hôtel de Bourgogne propose à son auteur favori, Racine, qui enchaîne les succès (Les Plaideurs en 1668, Britannicus en 1669) de composer une tragédie sur le même sujet. Ainsi les deux pièces seront créées à une semaine d’intervalle sur les deux théâtres concurrents (c’est pourquoi une légende apparue au XVIIIe siècle prétendra que la princesse Henriette d’Angleterre avait lancé un concours entre les deux auteurs): la Bérénice de Racine le 21 novembre 1670 à l’hôtel de Bourgogne, la Bérénice de Corneille (qui sera ensuite publiée sous le titre Tite et Bérénice) au Palais-Royal le 28 novembre. Si la tragédie de Racine se signala immédiatement comme un très grand succès, la comédie héroïque de Corneille poursuivit plusieurs mois durant une très honnête carrière, la troupe de Molière ayant décidé de la représenter en alternance avec Le Bourgeois gentilhomme. Les excellentes relations professionnelles de Corneille et de Molière à ce moment-là expliquent qu’au mois de décembre de la même année, pressé par le temps pour achever la composition de la grande «tragédie-ballet» à machines de Psyché, qui devait absolument être créée avant la fin du carnaval 1671 dans la grande salle des machines des Tuileries, Molière ait fait appel à Corneille pour achever la versification des quatre cinquièmes de la pièce. Précisons bien qu’il ne s’est pas agi pour Corneille de collaborer à la composition de la pièce comme on l’écrit le plus souvent depuis le XIXe siècle: l’avertissement de l’édition originale est très clair: Molière a dressé le plan et le détail de la pièce (c’est-à-dire qu’il l’a entièrement rédigée en prose, comme c’était l’usage) et il a en outre versifié la totalité du premier acte et les premières scènes de l’acte II et de l’acte III. Collaboration fructueuse, puisqu’on ne distingue pas les vers de Molière et les vers de Corneille, tant l’un et l’autre se sont surpassés pour produire une expression poétique particulièrement gracieuse, mais qui explique que Corneille n’ait jamais fait figurer les parties de Psyché qu’il avait versifiées dans les éditions de ses propres œuvres. Pourtant la collaboration n’eut pas de suite. Il semble que Corneille ait conçu le rôle principal de sa tragédie suivante, Pulchérie, pour Armande Béjart («Mlle Molière»), mais cette fois l’affaire ne fut pas conclue, et c’est le théâtre du Marais, désormais plutôt spécialisé dans les grands spectacles à machines que dans les tragédies, qui créa la pièce en novembre 1672. Un an et demi plus tard (Molière était mort entretemps), c’est le théâtre de l’hôtel de Bourgogne qui créa son ultime tragédie, Suréna, qui rencontra un demi-succès en succédant (décembre 1674) sur la même scène à Iphigénie de Racine qui venait de triompher durant plusieurs semaines. Les dernières années (1674-1684) Au lendemain de Suréna, sa dernière tragédie (publiée en 1675), Corneille n’annonça pas qu’il mettait fin à son activité de dramaturge et rien n’indique qu’il avait l’intention d’y mettre fin; d’autant que, autour de lui, plusieurs auteurs de tragédies (en particulier Claude Boyer et son propre frère Thomas Corneille qui se consacre désormais aux comédies et aux grands spectacles à machines) ont renoncé eux aussi pendant quelques années, en attendant manifestement que passe l’engouement du public pour les tragédies de Racine d’un côté, pour les opéras de Philippe Quinault et Lully de l’autre. Quatre ans plus tard, au lendemain de l’annonce par Racine de son retrait du théâtre, Thomas Corneille et Boyer recommencèrent à écrire des tragédies, et c’est alors qu’il apparut que le grand Corneille avait définitivement renoncé. Depuis 1663, Pierre Corneille était inscrit sur la liste des gratifications royales aux gens de lettres pour la somme de 2 000 livres (une somme très importante que Racine, d’augmentation en augmentation, mit quinze ans à atteindre). Mais l’ample liste des premières années se réduisit progressivement (Thomas Corneille disparut ainsi de la liste dès 1667) et les gratifications se mirent dès la fin des années 1660 à être versées irrégulièrement: le budget était pris sur les «Bâtiments du Roi», alors que le Louvre, Saint-Germain et Versailles étaient en travaux, et il fallait payer les ouvriers des chantiers. Le début des guerres européennes n’arrangea rien et à partir de 1673, seul un petit nombre d’écrivains, liés à la Cour de Louis XIV ou dépendant de Colbert, continuèrent à recevoir leur gratification. Corneille, éloigné de la Cour et sans lien avec Colbert, découvrit en juin 1675 (date du versement des gratifications de 1674) qu’il avait été oublié. Il réagit aussi bien directement (lettre à Colbert en 1678) qu’indirectement en composant régulièrement des Épîtres au Roi sur divers sujets (ses pièces qu’on faisait jouer à la Cour en 1676, les victoires du Roi en 1677, la Paix de Nimègue en 1678, le mariage du Grand Dauphin en 1680), et probablement aussi en faisant jouer ses appuis (la légende a imaginé au XVIIIe siècle une intervention directe de Boileau auprès de Louis XIV). Et il finit par avoir gain de cause: sa gratification de 2 000 livres lui est de nouveau versée à partir de 1682. Selon une légende tenace, apparue au XVIIIe siècle, Corneille aurait connu des difficultés financières dans les dernières années de sa vie et serait mort, si ce n’est dans la misère, du moins pauvre. Tous les travaux des chercheurs du XXe siècle qui se sont penchés sur les textes du XVIIe siècle et les actes authentiques concernant Corneille et sa famille prouvent le contraire. Son fils aîné qui poursuivait sa carrière d’officier du Roi passe pour avoir lourdement grevé le budget de son père (et, pour faire bonne mesure, les légendes ajoutent le second fils qui, en réalité, avait été tué à la guerre en 1674). En fait, son fils aîné, Pierre, qui avait effectivement coûté beaucoup d’argent à son père dans les années 1670, avait épousé en 1679 la veuve d’un fournisseur des armées, qui lui avait apporté une dot de 30 000 livres, une somme absolument considérable; or le contrat de mariage spécifie que Pierre apportait de son côté une espérance de succession évaluée à 20 000 livres! Bien plus, Thomas, le dernier fils de Corneille, se voit pourvu en 1680 d’un bénéfice ecclésiastique très confortable (une abbaye dotée d’un revenu annuel de 3 000 livres). Quant à la vente de la maison natale de la rue de la Pie à Rouen (4 novembre 1683), loin d’être le signe de quelque difficulté financière, elle représente en fait un arrangement financier en vue de sa succession: sur les 4 300 livres de la vente, 3 000 livres sont immédiatement affectées au rachat de la pension qu’il versait depuis 1668 aux dominicaines de Rouen pour sa fille Marguerite (pension qui, justement, avait été gagée sur cet immeuble); de la sorte, à sa mort, ses héritiers se sont trouvés dégagés du versement de cette pension et Marguerite a pu finir ses jours comme prieure de sa communauté religieuse en 1718. Enfin, on ignore les raisons pour lesquelles Corneille a quitté en 1682 l’appartement de la rue de Cléry où il résidait depuis 1674 pour s’installer dans une maison au 6 rue d’Argenteuil que, pour la première fois de sa vie, il ne partage plus avec son frère, qui s’installe tout près, rue Clos-Georgeot, dans le même périmètre de la paroisse Saint-Roch. «Le mérite de la rue d’Argenteuil», écrit A. Le Gall, «tient dans sa proximité avec le Louvre où siège l’Académie. Or l’Académie est un des lieux auxquels Corneille reste le plus longtemps fidèle.» C’est là qu’il meurt le 1er octobre 1684. Depuis longtemps malade, il n’avait plus paru aux séances de l’Académie française depuis le 21 août 1683. Quelques semaines plus tard, son frère Thomas fut élu à son fauteuil, et c’est Racine qui, le 2 janvier 1685, prononça le discours de réception qui fut consacré pour l’essentiel à un vibrant éloge de Pierre Corneille. L’œuvre étendue et riche de Corneille a donné naissance à l’adjectif «cornélien» qui dans l’expression «un dilemme cornélien» signifie une opposition irréductible entre deux points de vue, par exemple une option affective ou amoureuse contre une option morale ou religieuse. Œuvres Théâtre * Mélite (1629, première œuvre, comédie) * Clitandre ou l’Innocence persécutée (1631) * La Veuve (1632) * La Galerie du Palais (1633) * La Suivante (1634) * La Place royale (1634) * Médée (1635) * L’Illusion comique (1636) * Le Cid (1637) * Horace (1640) * Cinna ou la Clémence d’Auguste (1641) * Polyeucte (1642) * Le Menteur (1644) * La Mort de Pompée (1643) * Rodogune (1644) * La Suite du Menteur (1645) * Théodore (1646) * Héraclius (1647) * Don Sanche d’Aragon (1649) * Andromède (1650) * Nicomède (1651) * Pertharite (1651) * Œdipe (1659) * La Toison d’or (1660) * Sertorius (1662) * Sophonisbe (1663) * Othon (1664) * Agésilas (1666) * Attila (1667) * Tite et Bérénice (1670) * Psyché (1671) (N.B.: simple mise en vers des trois quarts de la pièce composée par Molière en prose; Corneille ne l’a jamais fait figurer dans ses propres œuvres) * Pulchérie (1672) * Suréna (1674) Autres * VariaAu lecteur (1644) * Au lecteur (1648) * Au lecteur (1663) * Discours du poème dramatique (1660) * Discours de la tragédie * Discours des trois unités * Lettre apologétique * Discours à l’Académie * Épitaphe de Dom Jean GouluTraductionsL’Imitation de Jésus-Christ * Louanges de la Sainte Vierge (1665) * Psaumes du Bréviaire romain * L’Office de la Sainte Vierge * Vêpres des dimanches et complies * Hymnes du Bréviaire romain * Hymnes de Saint Victor * Hymnes de Sainte Geneviève Iconographie et hommages divers Dessins et tableaux * Un portrait de Pierre Corneille par le peintre François Sicre est exposé au musée Carnavalet. Billet de banque * Un billet de 100 francs français à son effigie sur les deux faces, œuvre de Jean Lefeuvre, gravé par Poilliot & Piel, est mis en circulation en 1964. Il est remplacé en 1979 par le billet à l’effigie du peintre Eugène Delacroix et retiré en 1986. * Billet de 100 F à l’effigie de Pierre Corneille * * Philatélie * En hommage au tricentenaire de la tragédie Le Cid, La Poste française émet un timbre-poste en 1937. Sculptures et médailles * 1834 – une médaille à l’effigie de Pierre Corneille a été exécutée par le graveur Alexis-Joseph Depaulis, à l’occasion de l’inauguration de la statue de l’écrivain à Rouen. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet (ND 210). * 1834 – statue de Pierre Corneille à Rouen par David d’Angers fonte à la cire perdue par Honoré Gonon. Placée à l’extrémité de l’île près du pont, elle y resta jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et se trouve aujourd’hui depuis 1957 devant le théâtre des Arts. * 1873 – médaille en bronze à son effigie pour le bicentenaire de sa mort. Signé Borrel 1873. * 1937 – statue en bronze de Duaparc, professeur à l’école des beaux-arts de Rouen. Elle se trouve dans la cour du Lycée Corneille. * 1840 – Pierre Corneille, statue de marbre blanc de Jean-Pierre Cortot, dans le hall de l’hôtel de ville de Rouen. * il existe au musée Jeanne d’Arc dans une petite pièce consacrée à Corneille un mannequin de cire le représentant. * 1857 – Statue de Pierre Corneille, aile Turgot, palais du Louvre par le sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire. * Les Statues de Corneille à Rouen. * s.d. – sculpture moderne en pierre de Corneille en Cid par Gérard Leroy. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille


Louise-Victorine Ackermann, née Louise-Victorine Choquet à Paris le 30 novembre 1813 et morte le 2 août 1890 (à 76 ans) à Nice, est une poétesse française. Biographie Louise-Victorine Choquet est née à Paris, de parents parisiens, d'origine picarde. Son père, voltairien et amoureux des lettres, lui fit donner une éducation éloignée de l'enseignement religieux. Il fut l'initiateur des premières lectures de sa fille. De tempérament indépendant, il quitta Paris à trente-trois ans pour la solitude de la campagne, emmenant avec lui sa femme et ses trois filles. Louise vécut une enfance solitaire. Son tempérament studieux et méditatif se déclara très tôt, la mettant à l'écart des enfants de son âge et de ses sœurs. Sa mère, qui se fait mal à la vie campagnarde, est rongée par l'ennui et sera peu conciliante envers sa fille aînée. Elle exige que celle-ci fasse sa première communion, pour respecter les conventions mondaines. Louise découvre ainsi la religion en entrant en pension à Montdidier, et y porte tout d'abord une adhésion fervente, qui alarme son père. Ce dernier lui fait lire Voltaire, et l'esprit du philosophe créera le premier divorce entre Louise Choquet et le catholicisme. De retour de pension, elle poursuit ses lectures et études dans la bibliothèque paternelle, et découvre Platon et Buffon. C'est vers cette époque qu'elle commence à faire ses premiers vers. Sa mère s'en inquiète, ayant une prévention envers les gens de lettres. Elle demande conseil à une cousine parisienne, qui lui recommande au contraire de ne pas brider les élans de sa fille mais de les encourager. Louise est alors mise en pension à Paris, dans une grande institution dirigée par la mère de l'abbé Saint-Léon Daubrée. Élève farouche, elle est surnommée l'« ourson » par ses camarades de classe, mais devient vite la favorite de son professeur de littérature, Félix Biscarrat ami intime de Victor Hugo. Découvrant que Louise compose des vers, Félix Biscarrat porte même certaines de ses œuvres à Victor Hugo qui lui donne des conseils. Félix Biscarrat nourrit les lectures de son élève en lui fournissant les productions des auteurs contemporains. Elle découvre également les auteurs anglais et allemands, Byron, Shakespeare, Goethe et Schiller. La lecture parallèle de la théologie de l'abbé Daubrée la fait renoncer définitivement à la pensée religieuse, même si elle avoue dans ses mémoires avoir eu par la suite des « rechutes de mysticisme ». Au terme de trois années de pension, elle regagne sa famille où elle poursuit l'étude et la composition en solitaire, faisant découvrir à ses proches les auteurs modernes, Hugo, Vigny, Musset, Sénancour. Mais le décès de son père la privera bientôt du seul soutien familial qui valorisait ses compétences littéraires. Sa mère lui interdit la fréquentation des auteurs, et Louise renonce pour un temps à la poésie. Elle obtient en 1838 qu'on la laisse partir à Berlin pour un an, dans une institution modèle de jeunes filles dirigée par Schubart. Ce dernier l'aidera à parfaire son allemand, et elle sera sous le charme de la ville de Berlin, qu'elle définit ainsi : « La ville de mes rêves. À peu d'exceptions près, ses habitants ne vivaient que pour apprendre ou enseigner. » Elle y reviendra trois ans plus tard, après le décès de sa mère. Elle y rencontre le linguiste français Paul Ackermann, ami de Proudhon, qui en devient amoureux et qu'elle épouse sans réel enthousiasme : « Je me serais donc passée sans peine de tout amour dans ma vie ; mais rencontrant celui-là, si sincère et si profond, je n'eus pas le courage de le repousser. Je me mariai donc, mais sans entraînement aucun ; je faisais simplement un mariage de convenance morale. » À sa grande surprise, ce mariage sera parfaitement heureux, mais bref : Paul Ackermann décède de maladie le 26 juillet 1846, à l'âge de 34 ans. Très éprouvée par son veuvage, Louise rejoint une de ses sœurs à Nice, où elle achète un petit domaine isolé. Elle consacre plusieurs années aux travaux agricoles, jusqu'à ce que lui revienne l'envie de faire de la poésie. Ses premières publications ne suscitent que peu d'intérêt, mais retiennent tout de même l'attention de quelques critiques, qui en font la louange tout en blâmant son pessimisme qu'ils attribuent à l'influence de la littérature allemande. Elle se défendra de cette influence, réclamant pour sienne la part de négativisme de ses pensées en expliquant que celle-ci apparaissait déjà dans ses toutes premières poésies, bien qu'il n'y ait aucune trace de celles-ci pour corroborer ses dires. Son autobiographie révèle une pensée lucide, un amour de l'étude et de la solitude, ainsi que le souci de l'humanité qui transparaîtra dans ses textes. Elle meurt à Nice, 22 quai du Midi, le 2 août 1890 à dix heures du matin. Son acte de décès la déclare rentière Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise-Victorine_Ackermann


La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née Bibesco Bassaraba de Brancovan, est une poétesse et une romancière française, d’origine roumaine, née à Paris le 15 novembre 1876 et morte à Paris le 30 avril 1933. Biographie Née à Paris (22 boulevard de La Tour-Maubourg), descendante des familles de boyards Bibescu de Roumanie, elle est la fille d’un expatrié roumain âgé de 50 ans, le prince Grégoire Bibesco Bassaraba de Brancovan lui-même fils du prince valaque Georges Bibesco (en roumain: Gheorghe Bibescu) et de la princesse Zoé Bassaraba de Brancovan (en roumain: Brâncoveanu). Sa mère, plus jeune de 21 ans, est la pianiste grecque née à Constantinople Raluca Moussouros (ou Rachel Musurus), à qui Paderewski a dédié nombre de ses compositions. Sa tante, la princesse Hélène Bibesco, a joué un rôle actif dans la vie artistique parisienne à la fin du XIXe siècle jusqu’à sa mort en 1902. Anna est la cousine germaine des princes Emmanuel et Antoine Bibesco, amis intimes de Proust. Avec son frère aîné Constantin et sa sœur cadette Hélène, Anna de Brancovan mène une vie privilégiée. Elle reçoit son instruction presque entièrement au foyer familial, parle l’anglais et l’allemand en plus du français et a une éducation tournée vers les arts, particulièrement la musique et la poésie. La famille passe l’hiver à Paris et le reste de l’année dans sa propriété, la Villa Bassaraba à Amphion, près d’Évian sur la rive sud du lac Léman. La poésie d’Anna de Noailles portera plus tard témoignage de sa préférence pour la beauté tranquille et l’exubérance de la nature des bords du lac sur l’environnement urbain dans lequel elle devra par la suite passer sa vie. Un rare guéridon au piétement en bois sculpté d’un sphinx ailé (vers 1800) provenant de la collection Antocolsky dispersée en 1906, fut alors acquis par Anna de Noailles pour sa maison d’Amphion, décorée par Emilio Terry, fut exposé par la galerie Camoin Demachy lors de la XIVe biennale des Antiquaires de Paris (reproduit dans Connaissance des Arts no 439, septembre 1988, p. 75). Le 18 août 1897 Anne-Élisabeth, dite Anna, épouse à l’âge de 19 ans le comte Mathieu de Noailles (1873-1942), quatrième fils du septième duc de Noailles. Le couple, qui fait partie de la haute société parisienne de l’époque, aura un fils, le comte Anne Jules (1900-1979). Anna de Noailles fut la muse et entretint une liaison avec Henri Franck normalien et poète patriote proche de Maurice Barrès, frère de Lisette de Brinon et cousin d’Emmanuel Berl, mort de tuberculose à 24 ans en 1912. Elle fut également rendue responsable du suicide, en 1909, du jeune Charles Demange, un neveu de Maurice Barrès qui souffrait pour elle d’une passion qu’elle ne partageait pas. Au début du XXe siècle, son salon de l’avenue Hoche attire l’élite intellectuelle, littéraire et artistique de l’époque parmi lesquels Edmond Rostand, Francis Jammes, Paul Claudel, Colette, André Gide, Maurice Barrès, René Benjamin, Frédéric Mistral, Robert de Montesquiou, Paul Valéry, Jean Cocteau, Léon Daudet, Pierre Loti, Paul Hervieu, l’abbé Mugnier ou encore Max Jacob, Robert Vallery-Radot et François Mauriac. C’est également une amie de Georges Clemenceau. En 1904, avec d’autres femmes, parmi lesquelles Jane Dieulafoy, Julia Daudet, Daniel Lesueur, Séverine et Judith Gautier, fille de Théophile Gautier, elle crée le prix « Vie Heureuse », issu de la revue La Vie heureuse, qui deviendra en 1922 le prix Fémina, récompensant la meilleure œuvre française écrite en prose ou en poésie. Elle en est la présidente la première année, et laisse sa place l’année suivante à Jane Dieulafoy. Elle meurt en 1933 dans son appartement du 40 rue Scheffer (avant 1910, elle habitait au 109 avenue Henri-Martin,) et est inhumée au cimetière du Père-Lachaise à Paris, mais son cœur repose dans l’urne placée au centre du temple du parc de son ancien domaine d’Amphion-les-Bains. Distinctions Elle fut la première femme commandeur de la Légion d’honneur ; la première femme reçue à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (au fauteuil 33 ; lui ont succédé Colette et Cocteau). Elle était aussi membre de l’Académie roumaine. En 1902, elle reçoit le prix Archon-Despérouses. En 1920, son premier recueil de poèmes (Le Cœur innombrable) est couronné par l’Académie française. En 1921, elle en reçoit le Grand prix de littérature. Plus tard, l’Académie française créera un prix en son honneur. Elle a été décorée de l’ordre du Sauveur de Grèce et de Pologne. Œuvre Anna de Noailles a écrit trois romans, une autobiographie et un grand nombre de poèmes. Son lyrisme passionné s’exalte dans une œuvre qui développe, d’une manière très personnelle, les grands thèmes de l’amour, de la nature et de la mort. Romans La Nouvelle Espérance (1903) ; disponible sur Wikisource ; réédition, LGF, coll. « Le Livre de poche" Biblio » no 33578 (2015) (ISBN 978-2-253-02045-5) Le Visage émerveillé (1904) La Domination (1905) disponible sur Gallica ; réédition, LGF, coll. « Le Livre de poche » (2017) Poésie Le Cœur innombrable (1901) disponible sur Gallica L’Ombre des jours (1902) ; réédition en 2011 aux éditions du Livre unique disponible sur Gallica Les Éblouissements (1907) disponible sur la BNR https://ebooks-bnr.com/tag/noailles-anna-de/ Les Vivants et les Morts (1913) disponible sur Gallica De la rive d’Europe à la rive d’Asie (1913) Les Forces éternelles (1920) Les Innocentes, ou la Sagesse des femmes (1923) ; réédition Buchet-Chastel (2009) Poème de l’amour (1924) disponible sur Gallica Passions et Vanités (1926) [lire en ligne] L’Honneur de souffrir (1927) disponible sur Gallica Poèmes d’enfance (1929) Exactitudes (Grasset, 1930) Choix de poésies, Fasquelle (1930) ; réédition avec préface de Jean Rostand de 1960 chez Grasset (1976) Derniers Vers (1933) Autobiographie Le Livre de ma vie (1932) Anthologies posthumes L’Offrande, choix et présentation par Philippe Giraudon, Éditions de la Différence, coll. « Orphée » no 80 (1991) ; réédition en 2012 (ISBN 978-2-7291-1981-2) Anthologie poétique et romanesque: « Je n’étais pas faite pour être morte », LGF, coll. « Le Livre de poche. Classiques » no 32973 (2013) (ISBN 978-2-253-16366-4) Autres publications À Rudyard Kipling (1921) Discours à l’Académie belge (1922) Elle a également écrit la préface du livre du commandant Pierre Weiss, L’Espace (Louis Querelle éditeur, 1929) Témoignages de contemporains « Impossible de rien noter de la conversation. Mme de Noailles parle avec une volubilité prodigieuse ; les phrases se pressent sur ses lèvres, s’y écrasent, s’y confondent ; elle en dit trois, quatre à la fois. Cela fait une très savoureuse compote d’idées, de sensations, d’images, un tutti-frutti accompagné de gestes de mains et de bras, d’yeux surtout qu’elle lance au ciel dans une pâmoison pas trop feinte, mais plutôt trop encouragée. (...) Il faudrait beaucoup se raidir pour ne pas tomber sous le charme de cette extraordinaire poétesse au cerveau bouillant et au sang froid. » —André Gide, Journal, 20 janvier 1910, Gallimard (Folio: Une anthologie), 1951/2012, p. 109-110. « Mme Mathieu de Noailles aime les approbations (...) Elle voudrait la croix, l’Arc de Triomphe, être Napoléon. C’est l’hypertrophie du moi. Elle est le déchaînement. Elle aurait dû vivre à l’époque alexandrine, byzantine. Elle est une fin de race. Elle voudrait être aimée de tous les hommes qui aiment d’autres femmes qu’elle (...) elle aurait dû épouser le soleil, le vent, un élément. » —Abbé Mugnier, Journal, 24 novembre 1908– Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 1985, p. 174 « Achevé le roman: Le Visage émerveillé (...) pour la forme, il y a là du nouveau, des instantanés, et des inattendus. Des sensations qui deviennent des sentiments. Des couleurs, des saveurs, des odeurs prêtées à ce qui n’en avait pas jusqu’ici. Mme de Noailles a renchéri sur Saint-François d’Assise: elle se penche encore plus bas, elle dit au melon blanc: " Vous êtes mon frère", à la framboise, " Vous êtes ma sœur"! Et il y a encore et surtout des joies subites, des désirs qui brûlent, de l’infini dans la limite... » —Abbé Mugnier, Journal, 1er décembre 1910, p. 197 « Le poète des Éblouissements était au lit, dans une chambre sans luxe (...) Une volubilité d’esprit et de paroles qui ne me permettait pas toujours de la suivre (...) Elle m’a dit combien elle aimait Michelet, l’idole préférée, admire Victor Hugo, aime moins Lamartine, admire Voltaire, Rousseau, préfère George Sand à Musset (...) Aujourd’hui, elle n’a plus de vanité (...) Même ses vers les plus lyriques sur le soleil, elle les écrivait avec le désir de la mort. Elle n’était pas joyeuse... Très amusantes anecdotes sur la belle-mère, à Champlâtreux, contées avec un esprit voltairien (...) Elle avait pensé à cette chapelle en écrivant le Visage émerveillé. Elle a écrit sur la Sicile des vers encore inédits (...) à l’intelligence, elle préfère encore la bonté". » —Abbé Mugnier, Journal, 2 décembre 1910, p. 198 et 199 « Elle était plus intelligente, plus malicieuse que personne. Ce poète avait la sagacité psychologique d’un Marcel Proust, l’âpreté d’un Mirbeau, la cruelle netteté d’un Jules Renard. » —Jean Rostand, préface à Choix de poésies d’Anna de Noailles, 1960 « Sacha Guitry admirait infiniment Mme de Noailles, mais qui n’admirait pas Anna de Noailles ? C’était un personnage extraordinaire, qui avait l’air d’un petit perroquet noir toujours en colère, et qui ne laissait jamais placer un mot à personne. Elle recevait dans son lit, les gens se pressaient en foule dans sa ruelle [...] et cela aurait pu être un dialogue étourdissant mais c’était un monologue bien plus étourdissant encore [...] Sacha m’a dit d’elle: quand on l’entend monter l’escalier on a toujours l’impression qu’il y a deux personnes en train de se parler, et quand elle redescend, il semble qu’une foule s’éloigne. » —Hervé Lauwick, Sacha Guitry et les femmes « Elle surgit d’une porte-fenêtre, précédée d’un multitude de cousins multicolores comme dans un ballet russe. Elle avait l’air d’une fée-oiselle condamnée par le maléfice d’un enchanteur à la pénible condition de femme (...). Il me semblait que si j’avais pu prononcer le mot magique, faire le geste prescrit, elle eût, recouvrant son plumage originel, volé tout droit dans l’arbre d’or où elle nichait, sans doute, depuis la création du monde. Puisque c’était impossible, elle parlait. Pour elle seule. Elle parla de la vie, de la mort, les yeux fixés sur Lausanne, moi regardant son profil. Elle ne m’écoutait pas. Il était rare qu’elle le fit. Malheureusement, elle n’avait pas besoin d’écouter pour comprendre. (...). Je reçus tout à coup, en pleine figure, ses énormes yeux, elle rit de toutes ses dents et me dit: "Comment pouvez-vous aimer les jeunes filles, ces petits monstres gros de tout le mal qu’ils feront pendant cinquante ans ? » —Emmanuel Berl, Sylvia, Gallimard, 1952, réédition 1994, p. 89-90 « Octave Mirbeau la ridiculise dans La 628-E8 (passage repris dans la Revue des Lettres et des Arts du 1er mai 1908), la montrant comme une « idole » entourée de « prêtresses »: « Nous avons en France, une femme, une poétesse, qui a des dons merveilleux, une sensibilité abondante et neuve, un jaillissement de source, qui a même un peu de génie… Comme nous serions fiers d’elle!… Comme elle serait émouvante, adorable, si elle pouvait rester une simple femme, et ne point accepter ce rôle burlesque d’idole que lui font jouer tant et de si insupportables petites perruches de salon! Tenez! la voici chez elle, toute blanche, toute vaporeuse, orientale, étendue nonchalamment sur des coussins… Des amies, j’allais dire des prêtresses, l’entourent, extasiées de la regarder et de lui parler. / L’une dit, en balançant une fleur à longue tige: / —Vous êtes plus sublime que Lamartine! / —Oh!… oh!… fait la dame, avec de petits cris d’oiseau effarouché… Lamartine!… C’est trop!… C’est trop! / —Plus triste que Vigny! / —Oh! chérie!… chérie!… Vigny!… Est-ce possible ? / —Plus barbare que Leconte de Lisle… plus mystérieuse que Mæterlinck! / —Taisez-vous!… Taisez-vous! / —Plus universelle que Hugo! / —Hugo!… Hugo!… Hugo!… Ne dites pas ça!… C’est le ciel!… c’est le ciel! / —Plus divine que Beethoven!… / —Non… non… pas Beethoven… Beethoven!… Ah! je vais mourir! / Et, presque pâmée, elle passe ses doigts longs, mols, onduleux, dans la chevelure de la prêtresse qui continue ses litanies, éperdue d’adoration. —Encore! encore!… Dites encore! » » —Octave Mirbeau, La 628-E8, 1907, réédition Éditions du Boucher, 2003, p. 400. L’orientation de ce portrait est reprise par l’ambassadeur de France à Bucarest le comte de Saint-Aulaire, dans ses mémoires qui la montre sans-gêne, prétentieuse et monopolisant la conversation. Charles Maurras fait d’Anna de Noailles l’une des quatre femmes de lettres qu’il prend comme exemplaires du romantisme féminin dont il voit une résurgence à la fin du XIXe siècle, aux côtés de Renée Vivien, Marie de Régnier et Lucie Delarue-Mardrus. Ces qualités sont aussi vantées par les travaux de la critique littéraire antiféministe Marthe Borély. Postérité Les établissements d’enseignement suivants portent son nom: le lycée Anna-de-Noailles à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) ; le collège Anna-de-Noailles à Luzarches (Val-d’Oise) ; le collège Anna-de-Noailles à Noailles (Oise) ; le collège Anna-de-Noailles à Larche (Corrèze) ; une école élémentaire à Barentin (Seine-Maritime). une école élémentaire à Sarcelles (Val-d’Oise). le lycée Anna-de-Noailles à Bucarest, Roumanie. Iconographie Le portrait d’Anna de Noailles par Jean-Louis Forain est conservé au musée Carnavalet. Il lui a été légué par le comte Anne-Jules de Noailles en 1979. Célébrité de son temps, plusieurs peintres de renom de l’époque firent son portrait, comme Antonio de la Gandara, Kees van Dongen, Jacques-Émile Blanche ou Philip Alexius de Laszlo (illustration sur cette page). En 1906, elle fut le modèle d’un buste en marbre par Auguste Rodin, aujourd’hui exposé au Metropolitan Museum of Art à New York ; le modèle en terre glaise, qui lui donne comme un bec d’oiseau, comme le portrait-charge de profil par Sem reproduit sur cette page, est lui exposé au Musée Rodin à Paris. Anna de Noailles avait refusé ce portrait, c’est pourquoi le marbre du Metropolitan porte la mention: « Portrait de Madame X ».[réf. nécessaire]Au cours de l’inauguration du musée Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye, Jean-Claude Brialy demande au sculpteur Cyril de La Patellière la réalisation d’une statue représentant la poétesse d’où sera tiré à part un portrait (2002).[réf. nécessaire]


Charles Guérin, né le 29 décembre 1873 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), où il est mort le 17 mars 1907, est un poète français. Biographie Jeunesse Charles Guérin appartient à une dynastie d’industriels lorrains, propriétaire de la célèbre Faïencerie de Lunéville-Saint-Clément, connue aussi sous le nom Keller et Guérin. Au sein de cette grande famille, où il est l’aîné de huit enfants, il reçoit une solide éducation humaniste et religieuse, dont l’influence sur l’œuvre poétique est déterminante. Il fait ses études à Saint-Pierre-Fourier (Lunéville), puis à la Faculté des Lettres de Nancy, où il prépare une licence d’allemand (1894-1897). Œuvre et activité littéraire À ses études le jeune homme préfère largement la poésie. Il publie son premier recueil Fleurs de neige en 1893, puis Joies grises en 1894 et Le Sang des crépuscules en 1895, trois recueils marqués par l’influence du poète symboliste belge Georges Rodenbach qui préface le premier des trois recueils. Il fait également de nombreux séjours à Paris, où il fréquente les cercles poétiques et littéraires à la mode, en particulier le salon de José-Maria de Heredia et les célèbres Mardis symbolistes de Stéphane Mallarmé, qui préface Le Sang des Crépuscules. Alfred Vallette, directeur du Mercure de France, lui confie la rédaction de quelques articles de critique littéraire et artistique et édite ses œuvres: Le Cœur solitaire, Le Semeur de cendres et L’Homme intérieur. Charles Guérin se consacre désormais entièrement à la littérature, écrit de nombreux poèmes, dont beaucoup ne seront jamais publiés, un projet de roman, des notes diverses de voyage... Il collabore aussi à plusieurs revues dont L’Ermitage et fréquente de nombreux jeunes écrivains: Paul Léautaud, Maurice Magre, Paul Fort, Jean Viollis, Albert Samain, et surtout, à partir de 1897, Francis Jammes, auquel le lie une grande et profonde amitié et qui est le dédicataire de plusieurs poèmes. Voyages La vie parisienne de Charles Guérin est entrecoupée de nombreux voyages à l’étranger: en Allemagne, particulièrement à Bayreuth, où il découvre avec enthousiasme l’œuvre de Richard Wagner, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Italie... Ou encore sur la Côte d’Azur, ou dans le Béarn, à Orthez (Basses-Pyrénées) chez Francis Jammes. La fin Un amour passionné et malheureux pour Jeanne Blumer, mais surtout une sensibilité irrémédiablement mélancolique et une santé fragile épuisent vite le poète, qui meurt prématurément d’une tumeur au cerveau, à l’âge de 33 ans, le 17 mars 1907. La sincérité, la douleur et la profondeur de son œuvre situent Charles Guérin dans la pure tradition lyrique de la poésie française, entre Symbolisme et Parnasse, à la transition des XIXe et XXe siècles. Œuvres * Fleurs de Neige, Nancy, Crépin-Leblond, 1893. Publié sous le pseudonyme: Heirclas Rügen (anagramme de « Charles Guérin »). * Georges Rodenbach, Nancy, Crépin-Leblond, 1893. Texte signé Heirclas Rügen, mais publié sous le nom de Charles Guérin. * L’Art Parjure, Munich, H. Kutzner, 1894. Deuxième édition la même année. Réédition en 2018 par les Éditions Kasemate. * Joies grises (préf. Georges Rodenbach), Paris, P. Ollendorff, 1894. * Le Sang des Crépuscules, Paris, Mercure de France, 1895, avec un Prélude musical de Percy Pitt et une préface de Stéphane Mallarmé. * Le Cœur Solitaire, Paris, Mercure de France, 1898. * Le Semeur de cendres, Paris, Mercure de France, 1901. * L’Homme intérieur, Paris, Mercure de France, 1905. * Douze sonnets, Paris, Librairie des amateurs, 1922. * Premiers et derniers vers, Paris, Mercure de France, 1923. Contient: Fleurs de neige. Joies grises. Le Sang des crépuscules. Derniers vers. * Œuvres, Paris, Mercure de France, 1926-1929. 3 volumes. Réédition des œuvres. Notice d’Henry Dérieux. * Poèmes choisis, Paris, Bernard Grasset, 1972. Édition établie et présentée par Dominique Robaux.Le Cœur solitaire, Le Semeur de cendres et L’Homme intérieur, de Charles Guérin, peu réédités, ainsi que son Georges Rodenbach qui ne le fut jamais, sont disponibles sur Gallica (cf. infra). * À noter, la luxueuse édition illustrée par Auguste Leroux du Semeur de cendres, parue en 1923 chez Ferroud (Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud et F. Ferroud). * Un poème de Charles Guérin, Au bout du chemin, extrait du Semeur de Cendres, a été mis en musique et interprété par Guy Béart. Prix * Prix Archon-Despérouses 1902. Ouvrages sur Charles Guérin * J.-B. Hanson, Le poète Charles Guérin, Paris, Éditions Nizet & Bastard, 1935. * Jacques Nanteuil, L’Inquiétude religieuse et les poètes d’aujourd’hui, essais sur Jules Laforgue, Albert Samain, Charles Guérin, Francis Jammes, Bloud et Gay – 1925 Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gu%C3%A9rin_(po%C3%A8te)


Alphonse Beauregard (1881-1924) est un poète québécois. Biographie Né à La Patrie (Compton en Québec) le 5 janvier 1881, Alphonse Beauregard doit abandonner ses études à la mort de son père. Il pratique alors divers métiers, tout en publiant des poèmes dès 1906 dans quelques journaux et revues (parfois sous pseudonyme de A. Chasseur). Il prend une part active à la rédaction du Terroir et devient secrétaire de l'école littéraire de Montréal, tout en travaillant comme commis au port de Montréal. À peine élu président de l'école, il meurt asphyxié au gaz le 15 janvier 1924. Son poème « Impuissance » est paradoxalement un des plus puissants de cette époque. Ses œuvres * Les forces, 1912, édité par Arbour & Dupont à Montréal * Les alternances : poèmes, 1921, édité par Dupont et Roger Maillet à Montréal * La brume:poésie * Bonheur lucide Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/

Casimir Jean François Delavigne, né le 4 avril 1793 au Havre et mort 11 décembre 1843 à Lyon, est un poète et dramaturge français. Delavigne connaît la célébrité lorsque, après la défaite de Waterloo, il publie ses Premières Messéniennes. « Les pleurs qu’il répandit sur les généreuses victimes de Waterloo, l’anathème qu’il prononça contre les spoliateurs de nos musées, et les sages conseils qu’il donna à ses compatriotes sur le besoin de s’unir contre l’étranger, tous ces sentiments exprimés en vers énergiques, trouvèrent en France des milliers d’échos et rendirent le nom de l’auteur aussi populaire que s’il s’était signalé depuis longtemps »[réf. nécessaire]. Ses origines Son père, Louis-Augustin-Anselme Delavigne, était arpenteur géographe des forêts du Roi. La chute de Louis XVI entraîne aussi celle d’Anselme, fonctionnaire royal. En 1793, la famille prend la route du Havre, où Anselme Delavigne devient armateur avec ses deux frères, Jean-Fortuné et César-Casimir. À cette époque se crée une importante liaison maritime, l’Angleterre recevant son lot d’émigrés. Lorsque la Révolution vacille sur ses arrières, quelques-uns de ceux-ci repassent la Manche pour aller rejoindre Bonchamps et La Rochejaquelein en Vendée. À ce petit jeu fort profitable (il en coûte des fortunes aux passagers), Anselme risque gros. On l’arrête et le 5 avril 1793, jour de la naissance de Casimir Delavigne, son père est au fond d’un cachot. Dans ce monde de bourgeoisie havraise, son épouse trouve une demoiselle Devienne, poétesse, artiste dramatique et confidente des Delavigne pour s’entremettre et intervenir auprès de Robespierre. Anselme se sort discrètement de ce mauvais pas et devient ce négociant estimé de ses concitoyens comme le rapporte la chronique du temps, Le Mercure de Londres, paru en 1834. Après cette entreprise, en 1808, Anselme se lance dans la faïencerie, il fabrique dans son entreprise des assiettes et des plats décoratifs mais, en 1816, les affaires sont si désastreuses qu’il ferme la fabrique. Les années d’enfance Son biographe et frère a écrit : « Il naquit au Havre le 5 avril 1793, au numéro 27 du quai Sollier dans le vieux quartier Saint-François. Il était fils d’un négociant justement considéré, son enfance ne présentait rien de remarquable. Malgré son esprit vif, il ne triompha qu’avec peine de ses premières études ». Il apprend à lire et à compter dans sa ville du Havre auprès de l’abbé Trupel puis en 1801 Casimir rejoint son frère au lycée Henri-IV, il n’a alors que 8 ans. On trouve aujourd’hui un buste de Casimir Delavigne au lycée Henri-IV. Dans ces années, il se fait remarquer—note son frère—par la bonté de son caractère et son application à l’étude. C’est à quatorze ans que ses facultés se développent. Bon écolier, son goût pour la poésie se révèle. Sur les bancs du collège il se lie d’une rare amitié avec Eugène Scribe. Ensemble ils forment des plans d’avenir. Casimir veut être poète. Scribe se destine au barreau ; il deviendra un célèbre auteur dramatique et compositeur d’opérettes aujourd’hui oubliées. En l’absence de sa famille havraise, jeune homme, Casimir est reçu, les jours de liberté, par son oncle Andrieux, avoué à Paris, un ami de Crébillon qui aime et cultive les belles lettres. Casimir lui ayant soumis ses premiers vers, il lui prédit les plus amers désappointements et l’encourage surtout à « se disposer à faire son droit ». Poème pour la naissance du roi de Rome Alors qu’il est encore élève, la naissance du roi de Rome lui offre l’occasion de se faire remarquer. Il compose un « dithyrambe, renfermant des beautés poétiques de l’ordre le plus élevé, écrit son frère. Son oncle Andrieux, juge si bien la chose qu’il lui promet alors une carrière et de véritables succès. Cet encenseur de Napoléon Ier, n’est pourtant pas un foudre de guerre. Il est dispensé de service militaire, réformé, en raison d’une légère surdité qui par la suite disparaîtra complètement. Ce poème fameux, remarqué à la cour, par le comte Antoine Français de Nantes, alors directeur des Droits réunis (contributions indirectes), lui permet de trouver dans ses services un asile, sous couvert d’un petit emploi. Il entre dans son bureau en 1813, sa seule obligation étant de s’y présenter à chaque fin de mois. Il s’efforce de mériter cette bienveillance par ses succès. Auteur d’un poème épique Charles XII à Narva, l’Académie lui remarque un esprit sage, de brillantes qualités, et lui accorde une mention honorable. Rue des Rosiers, au coin de la rue Pavée, la colonie Delavigne est réunie. Germain, son frère et Casimir sont devenus soutiens de famille. Leur père Anselme est ruiné, son épouse (Meyotte), sa fille Louise et le petit Fortuné, étudiant au lycée Napoléon, l’accompagnent. En outre, la tante Aupoix, sœur d’Anselme accompagnée de ses deux serviteurs noirs, Rose et César, qui l’ont accompagnée depuis Saint-Domingue, a trouvé, elle aussi, refuge chez ses neveux. Même la nourrice du poète, la vieille Babet, a suivi la famille depuis le Havre. La découverte de la vaccine L’année suivante, en 1814, le sujet académique imposé est « La découverte de la Vaccine ». Il tente une nouvelle fois la fortune. Il rencontre chez le comte Français le docteur Parisot, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine. Parisot, qui fait lui-même de bons vers, lui donne les explications les plus précises et ils vont même de compagnie vacciner dans les campagnes proches de Paris. Quelques vers techniques consciencieux donnent avec un rare bonheur les effets de ces vaccins. Ces vers seront alors extrêmement appréciés et dans les livres scolaires de littérature choisie, ces vers étaient encore présents jusqu’en 1950. Voici 14 des 218 vers que contient le poème : « Par le fer délicat dont le docteur arme ses doigts, Le bras d’un jeune enfant est effleuré trois fois. Des utiles poisons d’une mamelle impure, Il infecte avec art cette triple piqûre. Autour d’elle s’allume un cercle fugitif, Le remède nouveau dort longtemps inactif. Le quatrième jour a commencé d’éclore, Et la chair par degrés se gonfle et se colore. La tumeur en croissant de pourpre se revêt, S’arrondit à la base, et se creuse au sommet. Un cercle, plus vermeil de ses feux l’environne ; D’une écaille d’argent l’épaisseur la couronne ; Plus mûre, elle est dorée ; elle s’ouvre, et soudain Délivre la liqueur captive dans son sein ».Le ton, considéré comme trop didactique, l’empêche d’avoir le prix, mais d’un suffrage unanime, l’Académie lui décerne un accessit. Les trois premières Messéniennes Cependant les désastres de l’Empire avaient commencé et c’est avec une profonde douleur qu’il assiste à la chute de l’empereur et à l’invasion de la France. Après la funeste bataille de Waterloo, en juillet 1815, il publie ses premières Messéniennes : Waterloo, Les Malheurs de la guerre, puis Jeanne d’Arc et La Mort de Jeanne d’Arc. Les armées étrangères occupaient la France, les bons citoyens déploraient que leur pays fût ainsi mis hors de combat après 25 années de victoires. Le poète prend sa lyre et chante les vaincus. Il se fait courtisan des braves de la Vieille Garde. Dès lors, il mérite d’être appelé le poète national, le poète de la patrie. Il exprime, avec verve et enthousiasme, les regrets qui sont au fond des cœurs. Il fait acte de courage en se déclarant contre les vainqueurs. Quand il voit le musée du Louvre dévasté par les envahisseurs étrangers, ses statues emportées comme butins de guerre, il proteste avec éloquence contre ces abus de la victoire et adresse de touchants adieux à ces merveilles des arts. Comme citoyen, il rappelle fièrement aux étrangers que s’ils pouvaient emporter des statues, ils n’emporteraient pas nos titres de gloire. Bientôt les armées étrangères quittent le pays mais les rivalités de partis, l’avidité des faux serviteurs menacent les libertés renaissantes, alors celui qui avait rendu hommage aux morts de Waterloo fait un appel à l’union, celui qui sortait des bancs universitaires gourmande les partis avec une sagesse précoce. Son dernier adieu aux armées qui évacuent le sol français est un hymne à la concorde qui rend les peuples invincibles. Les livres second et troisième des Messéniennes confortent la popularité de l’écrivain, ils abordent l’histoire de la Grèce antique, Christophe Colomb, et des événements qui relatent la vie de ce début du XIXe siècle. La chute de l’empereur que Casimir Delavigne avait résumé ainsi : « Napoléon a oublié ses origines. Fils de la Liberté (1789) tu détrônas ta mère ». Le comte français est naturellement éloigné des affaires et Casimir perd son « emploi ». Le baron Pasquier, alors garde des Sceaux et chancelier de France, lit avec émotion le poème sur l’exil de Napoléon Ier, et le fait lire au roi qui le trouve très beau. Il fait appeler l’auteur et crée pour lui la place de bibliothécaire de la chancellerie. Les Vêpres siciliennes Libre de son temps et sécurisé par son emploi, toujours dans le genre héroïque, Casimir écrit en 1818 les Vêpres siciliennes, dont il sollicite la lecture au Théâtre-Français. Après deux ans d’attente, l’ouvrage est enfin écouté avec la défiance et la défaveur qu’accueille, ordinairement le coup d’essai d’un jeune homme. Un seul comédien, Thénard, trouve l’ouvrage intéressant et déclare : « J’y trouve la preuve que l’auteur un jour écrira très bien la Comédie ». La pièce est reçue mais à correction. Un an plus tard cette prédiction se réalise, bien que Casimir ait réclamé ensuite et obtenu une seconde lecture dont le résultat sera le refus définitif. L’aréopage appelé à se prononcer sur le mérite de la tragédie ne l’admet qu’à condition que l’auteur n’exige jamais qu’elle soit jouée. Une des dames qui siège au nombre des juges se montrera plus sévère que les autres, elle donne pour raison de son refus qu’il serait scandaleux de mettre le mot vêpres sur une affiche de spectacle. C’est à cette époque que Victor Hugo écrit dans la Gazette du Théâtre : « Casimir Delavigne – Comme auteur tragique, il a du mouvement et manque de sensibilité. Comme auteur comique a de l’esprit et point de gaieté ». Jugement sévère. Trois mois plus tard, Les Comédiens sont écrits, la plus vive et la plus gaie des comédies de l’époque. Elle sera jouée jusqu’en 1861. En 1818, l’Odéon ayant brûlé, le duc d’Orléans, le futur roi des Français (Louis-Philippe) fait reconstruire la salle et lui accorde le privilège de Second Théâtre-Français. Un comité de lecture de gens de lettres reçoit alors avec la plus grande ferveur les Vêpres siciliennes et l’on décide, que parmi tous les ouvrages reçus, celui-ci serait le premier joué au théâtre de l’Odéon. La première représentation a lieu le 23 octobre 1819, c’est un triomphe, la pièce attire une affluence considérable durant trois cents représentations successives, confirmant ainsi la qualité du poète et le choix du comité de lecture. Le théâtre encaisse plus de 400 000 francs lors des 100 premières représentations, somme considérable à cette époque. Le duc d’Orléans le fait bibliothécaire du Palais-Royal En 1821, pendant qu’il poursuivait sa carrière laborieuse avec Le Paria, les événements politiques marchaient très vite. Le ministre n’était plus le même, et comme le caractère indépendant et l’amour de la patrie du poète ne pouvaient convenir aux nouveaux agents du pouvoir, la place de bibliothécaire fut supprimée. Le duc d’Orléans, apprenant ce coup, lui offrit la place de bibliothécaire du Palais-Royal en lui écrivant : « Le tonnerre est tombé sur votre maison, je vous offre un appartement dans la mienne ». Casimir accepta avec reconnaissance. Le 15 décembre 1824, il acquiert une grande bâtisse blanche, construite une dizaine d’années auparavant, admirablement située sur une pente douce menant à la Seine, « La Madeleine », appartenant au général d’Empire Joseph François Dominique de Brémond (1773-1852). Ce bien était chargé d’histoire, car il avait appartenu au XIIe siècle au petit-fils de Richard de Vernon, Adjutor qui devint saint Adjutor, patron des mariniers. Il y fonda un lieu de prière sur lequel les moines bénédictins bâtirent un prieuré. Ce prieuré subsista jusqu’à la Révolution française. C’est sur les ruines de ce prieuré que le général de Brémond bâtit sa superbe demeure. Il y vint souvent, soit qu’il voulut trouver calme et solitude pour travailler, soit qu’il y vint chercher un lieu de repos. Scribe et son frère Germain, qui écrivaient ensemble, s’y installaient pour achever un vaudeville ou un livret d’opéra. Seul, Fortuné, le cadet fort discret n’y vint jamais, retenu par sa charge d’avoué à Paris. Bien que son amour pour la France, une grande fermeté de caractère jointe à une éloquence naturelle et une rectitude de jugement lui eussent permis de jouer un rôle utile et brillant dans les affaires du pays, il s’y refusa constamment, convaincu que les lettres, comme la politique, exigeaient un homme entier. Il refusa ainsi d’entrer à la chambre des députés, qui lui fut offert d’abord par la ville du Havre et ensuite par la ville d’Évreux. L’École des vieillards À ses yeux le plus sûr moyen de gagner les suffrages qui lui manquaient était d’écrire et de publier un titre nouveau. Ce fut L’École des vieillards, pour lequel il s’inspira de la pièce d’Alberto Nota, Les Premiers pas vers le mal. Cette pièce atteste un progrès réel de son auteur, et un critique en 1825 peut écrire dans le Mercure de Londres : « Vu du côté moral, elle offre une leçon utile à la vieillesse, sans l’immoler à la risée publique, sans acheter d’applaudissements aux dépens d’un âge qu’on ne saurait trop respecter ». Une revue des gens de lettres de 1834 la trouva moins originale que les œuvres de Béranger ou Lamartine, mais lui accorda « un talent si pur et si étendu qu’il peut se prêter avec grand succès à l’innovation littéraire ». Une réconciliation s’opéra avec les responsables du Théâtre-Français où l’École des vieillards attira un fidèle public. Au lendemain de l’École des vieillards, Casimir Delavigne est un homme célèbre que les jeunes poètes sont fiers de consulter. En 1825, l’Académie française se décida à ouvrir ses portes au poète que le public du théâtre de l’Odéon semblait avoir adopté. Elle le dédommagea de sa longue attente après les deux tentatives infructueuses. La première fois, il avait pour rival le célèbre Mgr Frayssinous, évêque d’Hermopolis. Son deuxième concurrent fut l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Lorsque des amis vinrent encore conseiller à Casimir Delavigne de se remettre sur les rangs, il repoussa leur offre, disant avec esprit : « Non, cette fois on m’opposerait le pape ». Pourtant, il finit par accepter de tenter sa chance au fauteuil du comte Ferrand. Son élection fut grandiose, obtenant 27 voix sur 28. Il ne participa que rarement à ces réunions de la société des gens de lettres. Il y soutint la candidature de Lamartine contre celle de Victor Hugo. Charles X lui accorda une pension de 1 200 francs. Mais celui-ci la refusa comme la Légion d’honneur que Monsieur de La Rochefoucault lui offrait au nom du roi, n’ayant semble-t-il pas confiance dans l’orientation politique du gouvernement mis en place, en raison d’une sévère restriction des maigres libertés accordées. Il préféra rester indépendant d’un pouvoir qu’il pouvait être amené à combattre. Voyage en Italie Un travail assidu compromit une santé déjà affaiblie. Les médecins ordonnèrent un voyage en Italie. Pendant ce périple dans le berceau des arts, il obtint un véritable triomphe tant il reçut de témoignages d’admirateurs. Pendant ces trois mois passés à Naples, il se refit une santé. Il visita Rome et Venise. C’est dans cette cité qu’il conçut la tragédie Marino Faliero. Pendant cet agréable séjour en Italie, il rédigea sept nouvelles Messéniennes. La première de Marino Faliero fut donnée au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 30 mai 1829. Il rencontra à Rome, en 1826, sa future épouse, Élise de Courtin. Élevée au pensionnat d’Écouen chez Mme Campan, elle avait été remarquée par l’empereur Napoléon Ier. Abandonnée par ses parents elle voulut s’empoisonner. La reine Hortense, mère du futur Napoléon III, elle aussi ancienne élève d’Écouen, émue par la situation de cette orpheline en fit sa protégée. Au fil des ans, la jeune fille devint sa lectrice et sa compagne préférée. Casimir entretint une correspondance assidue avec la jeune Élise d’un an plus âgée que lui. Il dut attendre trois ans le consentement de sa jolie conquête. Dès son retour à Paris, il offrit aux Parisiens une nouvelle œuvre, La Princesse Aurélie, spirituelle comédie qui ne connut qu’un bref succès. Un jeune poète que Casimir avait encouragé, écrivit maladroitement, dans un hebdomadaire, un article satirique dirigé contre Charles X. Le nommé Fonta, arrêté et jugé, fut jeté en prison. Casimir qui avait blâmé la violence de l’article fut profondément affligé par la rigueur de la peine : cinq années de prison, enfermé, avec des escrocs et des voleurs. La libération de ce garçon, fut l’occasion d’une campagne et d’une demande de Casimir auprès du ministre de l’intérieur puis du préfet « Mariguin ». Il reçut un accueil sévère. Le préfet qui l’avait écouté lui dit : « Nous sommes forts, Monsieur, nous ne craignons rien, il faut que justice se fasse ». Malgré ses efforts il ne put rien obtenir. Hymne à la gloire du peuple de Paris Quelques mois après, la Révolution de Juillet, en 1830, il prouva combien était factice la force sur laquelle le régime de Charles X s’appuyait. Cette nouvelle vint surprendre Casimir à la campagne, à « la Madeleine » de Pressagny-l’Orgueilleux. Rentré à Paris, il lui fut demandé de composer un hymne à la gloire du peuple. Il composa La Parisienne pour chanter ses concitoyens morts pour la patrie pendant la Révolution de Juillet. Ce chant populaire eut une grande vogue. Cette marche nationale favorable à la famille d’Orléans comportait sept couplets avec ce refrain : « En avant, marchons Contre les canons ; À travers le fer, le feu des bataillons, Courons à la victoire. (bis) » Il se rendit à Neuilly chez le duc d’Orléans (le châtelain de Bizy) qui avait été son protecteur, et qui était devenu lieutenant général du Royaume. Casimir Delavigne se précipitait ainsi au-devant de la réussite. Il fut d’ailleurs, toujours en excellent termes avec ses voisins de l’autre rive de la Seine, et souvent reçu aussi au château de Saint-Just qui, après avoir connu des propriétaires successifs (le chevalier Suchet, puis son frère le maréchal duc d’Albuféra) en 1831, devint le domaine d’un monsieur Lopez avec qui il sympathisa. La Révolution de 1830 accomplie, Casimir reprit sa tragédie Louis XI, interrompue depuis la mort de l’acteur Talma. Selon certains critiques, ce fut le chef-d’œuvre de Casimir Delavigne, tant les portraits des personnages sont nuancés et fidèles aux mœurs du temps. La première représentation eut lieu le 11 février 1832. Mais le public n’était plus réceptif à ce genre d’œuvre théâtrale. Victor Hugo avait triomphé avec Hernani. Il avait supplanté Casimir dans le cœur des Français. Pourtant sa tragédie Louis XI, après l’épidémie de choléra que connut Paris, connaît un nouveau succès. Son mariage Le 1er novembre 1830, Casimir Delavigne contracta mariage avec Élise de Courtin ; elle devait bientôt lui donner un fils, ce qui rendit son bonheur complet. Son frère Germain épousa le même jour Mademoiselle Letourneur. Ils se marièrent à minuit à l’église Saint-Vincent-de-Paul. « Nous nous marions tous deux jeudi soir, dirent-ils au roi. –Ah ! – À la même heure. –Ah ! –Dans la même église. –Ah ! Et avec la même femme ? » Ce fut une joie pour la reine Hortense que cette union de sa fille d’adoption avec le poète pour lequel elle avait tant de sympathie. Germain obtint, en 1832, le poste de conservateur du Mobilier de la couronne et directeur des Menus Plaisirs du roi. Cette promotion lui permit d’installer toute sa famille au no 2 de la rue Bergère. Casimir, de retour à la Madeleine en compagnie d’Élise, qui lui avait donné un fils dont l’existence est souvent évoquée dans ses tendres soucis, y travaillait abondamment. Il avait fait planter un marronnier qui reflétait pour lui les préoccupations de son épouse au travers de son feuillage plus ou moins fourni au cours des saisons. Serait-il encore identifiable dans le parc actuel ? Il écrivait alors, sur une trame due à Shakespeare Les Enfants d’Édouard. La pièce, le matin de la première, le 18 mai 1833, fit l’objet d’une interdiction. Il reçut un accueil défavorable auprès du ministre de l’Intérieur, Adolphe Thiers, mais, après une courte discussion devant le roi, l’interdiction fut levée. Louis-Philippe qui ne pouvait être présent à la représentation le félicita par un court billet qui commençait ainsi : « J’apprends avec grand plaisir, mon cher Casimir, le succès de votre pièce et je ne veux pas me coucher sans vous avoir fait mon compliment… » On comprend mieux l’attachement du poète à la réussite de Louis-Philippe. Les dernières années de sa vie La douloureuse maladie du foie, soignée au cours de son voyage en Italie recommençait à altérer les jours de Casimir. Il éprouvait de violentes douleurs. Les médecins ne jugeaient pas ce mal comme pouvant nuire à sa vitalité. Ce fut au milieu de douleurs presque continuelles qu’il écrivit Don Juan d’Autriche, comédie pleine de verve, qui ne lui fit pas moins honneur que ses grandes tragédies. La première fut donnée le 17 octobre 1835 et six mois plus tard, le 19 avril 1836, un acte en vers : Une famille au temps de Luther qui n’eut pas beaucoup de succès. Il se rendit, assez désespéré, à sa retraite charmante de Normandie, « la Madeleine », où depuis 1830 il passait tous ses étés. Il aimait beaucoup cette vaste demeure, et sa vue imprenable sur les îles de la Seine. Là, il espérait trouver un peu de soulagement. Il entreprit une œuvre qu’il préférait à tous ses ouvrages : La Popularité, comédie de mœurs en cinq actes et en vers. Après plusieurs retards, la pièce fut représentée le 1er décembre 1838. Elle ne fit que de maigres recettes ; le public était las de Casimir Delavigne. Le 20 janvier de l’année suivante paraît une nouvelle tragédie, La Fille du Cid. Elle n’eut pas un sort plus heureux, le succès fut sans durée. C’est à la fin de cette période douloureuse de l’automne 1839, qu’il dut vendre sa chère Madeleine avec tant de regrets. « Je n’ai point de fortune », écrit-il en 1833, et c’est vrai. À ses ennuis de santé, se sont ajoutés ceux d’argent et, le 9 août 1839, il est contraint d’abandonner « la Madeleine ». La propriété fut vendue 90 750 francs. Quelle tristesse pour le poète, qui écrit alors : « Adieu Madeleine chérie, Qui te réfléchis dans les eaux, Adieu ma fraîche Madeleine ! Madeleine, adieu pour jamais ! Je pars, il le faut, je cède ; Mais le cœur me saigne en partant. » Le poème complet comporte 11 strophes de 8 vers. Il a probablement été rédigé au château de Saint-Just, chez son ami Lopez. Les deux façades de ces demeures sont en vis-à-vis : la Madeleine sur la rive droite de la Seine et Saint-Just sur la rive gauche. Il rentra à Paris pour y suivre l’éducation du fils qui lui était né 9 ans auparavant, et surtout en raison de sa ruine. À cette époque, une descendante du grand Pierre Corneille, que le défaut de fortune plaçait dans de grandes difficultés, vint solliciter un prêt de 500 francs. Casimir ne les avait pas. Il ne put que la rassurer et l’adresser sur-le-champ au duc d’Orléans, « Ce prince universellement aimé et dont la disparition fut une calamité publique », écrivit son frère Germain. Le jour même, la somme demandée fut accordée. Mais ce devait être sa dernière intervention et bonne action. La dernière tragédie à laquelle il travaillait semble bien pressentir sa mort, il écrivait : « Mes jours sont pleins, et bons à moissonner. Dieu qui me les compta pouvant moins m’en donner : les reprendre est son droit… » À partir de ce moment, sa santé déjà si altérée continuait à décliner, malgré les soins empressés du docteur Horteloup. Lorsque Casimir fut surpris par la mort, quatre actes de la tragédie Mélusine étaient écrits, dans un genre tout à fait nouveau, et dont le sujet admettait toutes les richesses de la poésie. Depuis qu’il avait vendu « la Madeleine », il passait tous les ans la belle saison à Paris. Scribe, son ami de toujours, qui connaissait son goût pour la campagne et qui espérait qu’il pourrait y trouver quelques soulagements, lui offrit sa charmante maison du Montalais, à Saint-Jean-Lespinasse dans le Lot. Casimir s’y établit et trouva là quelques douceurs pendant trois mois. Quand il revint à Paris, il sentit qu’il ne pourrait résister à la saison, et il retourna chercher un climat plus doux dans le midi. Il se décida à partir malgré sa faiblesse, accompagné de sa femme et de son fils. Il quitta Paris le 2 décembre 1843. Il soutint la fatigue avec plus de courage que de force jusqu’à Lyon où il fut obligé de s’arrêter. C’est en vain qu’il lutta contre le mal, il lui fallut céder et rester à Lyon. Dans ses derniers moments, le 11 décembre à neuf heures du soir, il se faisait faire la lecture par sa femme. Comme celle-ci, trop émue, sautait des lignes, il la pria doucement de bien vouloir recommencer. Cependant quelques minutes après il parut cesser d’écouter la lecture, et posant sa tête sur sa main, murmura quelques mots, puis retombant sur son oreiller, sembla s’endormir. C’est ainsi qu’il s’éteignit dans la force de l’âge et du talent. La perte de Casimir suscita des profonds regrets. On vit se presser à ses funérailles tout ce que Paris renfermait de plus distingué, dans tous les genres et de tous les rangs. On y remarqua entre autres, Victor Hugo qui prononça au nom de l’Académie française l’éloge funèbre de celui qui fut le plus jeune académicien (35 ans), le dernier des classiques, et sans doute un des premiers romantiques. Le roi ordonna que son portrait et son buste fussent placés dans la Galerie de Versailles. Le Havre, sa ville natale, décida qu’un de ses quais porterait son nom et qu’une statue serait élevée sur une place de la ville. Elle y fut érigée, avenue du général Archinard. Épargnée par les fléaux de la dernière guerre elle se dresse actuellement en compagnie d’un autre illustre enfant du Havre : Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) au pied du bel escalier de pierre du Palais de Justice, aux côtés de deux lions débonnaires. La ville du Havre sauvait ainsi ces deux célébrités de l’oubli. En cette même année 1843, messieurs les sociétaires de la Comédie-Française (qui avait succédé au Théâtre-Français), arrêtèrent en assemblée générale, que le buste de Casimir Delavigne serait placé dans leur foyer au milieu des portraits de tous les grands hommes qui ont illustré ce théâtre. L’œuvre officielle de Casimir Delavigne représente une quinzaine de pièces de théâtre, une trentaine de poésies dont Les Messéniennes, des épîtres, des études sur l’antiquité, quatre chants populaires, ainsi que de nombreuses nouvelles et autres pièces en prose. Postérité Telle fut la gloire passagère d’un poète, considéré en son propre temps comme insurpassé et insurpassable, oublié aujourd’hui des publications littéraires et dont seule subsiste la Vaccine et la courte magnificence d’une bâtisse bourgeoise, pas très belle, mais admirablement implantée dans cet ancien domaine du marquis de Tourny à Pressagny-l’Orgueilleux. Balzac l’admirait éperdument et puisait son inspiration dans Les Vêpres Siciliennes à une époque où il n’était pas encore connu. Dans Illusions perdues (1836-1843), Les Petits Bourgeois (1855), Les Employés ou la Femme supérieure (1838), Casimir Delavigne est abondamment cité comme un génie. Flaubert, au contraire, l’appelle « un médiocre monsieur […] qui épiait le goût du jour et s’y conformait, conciliant tous les partis et n’en satisfaisant aucun, un bourgeois s’il en fut, un Louis-Philippe en littérature. » Il lui reproche surtout la forme de son évolution littéraire, qui prouve, selon lui, que Casimir Delavigne « s’est toujours traîné à la remorque de l’opinion ». Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (division 49). Depuis 1864, l’ancienne rue Voltaire, dans le 6e arrondissement de Paris, porte le nom de rue Casimir-Delavigne. Une rue et un quai du Havre portent également le nom du poète. Publications partielles ThéâtreLes Vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes, 1820 Les Comédiens, comédie Le Paria, 1821 L’École des vieillards, 1823 Marino Faliero, 1829 Don Juan d’Austriche, 1835 Les Messéniennes, 1818Divers. Charles VI, opéra en cinq actes, musique de Fromental Halevy, en collaboration avec son frère Germain (1843)Œuvres complètes, 1836, nouvelle édition revue et corrigée avec œuvres posthumes Derniers chants, Poëmes et Ballade sur l’Italie, Paris, Didier libraire-éditeur, 1855. Chants populaires, Discours, Épîtres, Études sur l’antiquité, Poésies de jeunesse Sources Notice biographique tirée des Œuvres complètes de Casimir Delavigne, Paris, H. L. Delloye & V. Lecou, 1836. Mme Fauchier-Delavigne, Casimir Delavigne intime, Paris, SFIL, 1907. Bulletin municipal de Pressagny-l’Orgueilleux, no 25, 2006, p. 64-76. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Casimir_Delavigne


Louise Colet, née Révoil de Servannes à Aix-en-Provence le 15 septembre 1810 et morte à Paris le 8 mars 1876, est une poétesse et écrivaine française. Biographie Âgée d’une vingtaine d’années, Louise Révoil2 épouse Hippolyte-Raymond Colet, un musicien académique, en partie afin d’échapper à la vie provinciale et de résider à Paris. À son arrivée à Paris, Louise Colet commence à publier ses poèmes et obtient bientôt le prix de l’Académie française d'un montant de deux mille francs, le premier de quatre prix de l’Académie qu’elle obtiendra. Dans son salon littéraire du no 2 rue Bréda elle a fréquenté nombre de ses contemporains du monde littéraire parisien, tels que Victor Hugo, Musset, Vigny, Baudelaire, ainsi que de nombreux peintres et des politiciens. En 1840 elle met au monde sa fille Henriette, mais ni son mari Hippolyte Colet, ni son amant Victor Cousin n’acceptent d’en reconnaître la paternité. Le journaliste Alphonse Karr révèle dans un pamphlet la liaison adultère. Furieuse, Louise Colet l'agresse avec un couteau de cuisine qu'elle lui plante dans le dos. Karr s'en tire avec une égratignure, et avec élégance renonce à porter plainte au grand soulagement de Victor Cousin. Elle devient ensuite la maîtresse de Gustave Flaubert (encore inconnu du public), d'Alfred de Vigny, d’Alfred de Musset et d’Abel Villemain. En 1844, Louise Colet publie une traduction des Œuvres choisies de Tommaso Campanella. Dans les années 1840 et 1850, ses œuvres sont plusieurs fois couronnées par de nombreux prix littéraires prestigieux, notamment le Prix de l'Académie française. Après la mort de son mari à Paris, le 21 avril 1851, Louise Colet et sa fille subsistent grâce à ses écrits et à l'aide de Victor Cousin. Elle est inhumée à Verneuil-sur-Avre (Eure).

Camille-André Lemoyne, né le 27 novembre 1822 à Saint-Jean-d’Angély où il est mort le 28 février 1907, est un poète et romancier français. Biographie Avocat au barreau de Paris en 1847, il fut successivement typographe, correcteur, puis chef de publicité chez Didot de 1848 à 1877, date à laquelle il fut nommé bibliothécaire de l’École des arts décoratifs. André Lemoyne figure dans la liste des poètes nommés dans la lettre de Rimbaud à Paul Demeny, dite Lettre du Voyant. En 1893, il reçoit le prix Archon-Despérouses. Jugements « Cet homme de modestie et de mérite a fait de sa vie deux parts: il livre l’une à la nécessité, au travail ; il réserve l’autre, inviolable et secrète. Tous les six mois, il distille une goutte d’ambre qui se cristallise en poésie et qui s’ajoute à son cher trésor. Les Roses d’antan renferment des pièces parfaites de limpidité et de sentiment. J’ai des raisons de recommander celle qui a pour titre L’Étoile du berger. » « S’il [André Lemoyne] n’a pas beaucoup produit, chacune de ses compositions est marquée d’un caractère spécial. Son œuvre offre une série de tableaux variés, peints avec largeur dans un petit cadre. [...] Les Roses d’antan, Les Charmeuses ont été couronnés à la fois par l’Académie française en 1871 ». Œuvres * Stella Maris (1860) * Chemin perdu (1863) * Les Sauterelles de Jean de Saintonge (1863) * Les Roses d’antan (1865) * Les charmeuses (1867) * Une Idylle normande (1874) * Alise d’Évran (1876) * Paysages de mer et fleurs des prés (1876) * Légendes des bois et chansons marines (1878) * Oiseaux chanteurs (1882) * Soirs d’hiver et de printemps (1883) * Fleurs et ruines (1888) * Fleurs du soir (1893) * Le Moulin des prés (1894) * La mare aux chevreuils (1902) * Poésies, Paris, Lemerre, 1883-1897, 4 volumes comprenant: Les Charmeuses ; Les Roses d’antan ; Légendes des bois et chansons marines ; Paysages de mer et fleurs des prés ; Soirs d’hiver et de printemps ; Fleurs et ruines ; Oiseaux chanteurs ; Fleurs du soir ; Chansons des nids et des berceaux * Romans, Paris, Lemerre, 1886, comprenant: Une Idylle normande ; Le Moulin des prés ; Alise d’Évran ; le volume comprend également des Pensées d’un paysagiste et des Notes de voyage Texte en ligne * La Tour d’Ivoire, Paris, Lemerre, 1902 Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lemoyne


Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul sur l’île de la Réunion et mort le 17 juillet 1894 à Voisins (Louveciennes). Leconte de Lisle est le vrai nom de famille du poète. Il l’adopta comme nom de plume, sans mentionner ses prénoms (Charles Marie René), et ce choix a été repris dans les éditions de ses œuvres, dans sa correspondance, ainsi que dans la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés et dans les anthologies. C’est ce nom qui est utilisé dans la suite de l’article. Son prénom usuel, utilisé par ses proches, était « Charles ». Leconte de Lisle passa son enfance à l’île de la Réunion et en Bretagne. En 1845, il se fixa à Paris. Après quelques velléités d’action politique lors des événements de 1848, il y renonça et se consacra entièrement à la poésie. Son œuvre est dominée par trois recueils de poésie, Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884), ainsi que par ses traductions d’auteurs anciens: Homère, Hésiode, les tragiques grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide), Théocrite, Biôn, Moskhos, Tyrtée, Horace, etc. Il est considéré comme le chef de file du mouvement parnassien ou tout au moins comme le maître des jeunes poètes de cette école, autant par l’autorité que lui a conférée son œuvre poétique propre que par des préfaces dans lesquelles il a exprimé un certain nombre de principes auxquels se sont ralliés les poètes d’une génération—entre la période romantique et le symbolisme—regroupés sous le terme de parnassiens à partir de 1866. L’Empire lui assura une pension et le décora. La République l’attacha à la bibliothèque du Sénat, dont il devint sous-bibliothécaire en 1872, et le nomma officier de la Légion d’honneur en 1883. En 1886, neuf ans après une candidature infructueuse à l’Académie française, où il n’eut que les voix de Victor Hugo et d’Auguste Barbier, Leconte de Lisle fut élu, succédant à Victor Hugo. Il y fut reçu par Alexandre Dumas fils le 31 mars 1887. Idées Idées littéraires Le choix de certains thèmes et leur traitement par Leconte de Lisle le relient au romantisme, notamment: la description de la nature sauvage (couleur, exotisme, animaux, …), les sujets historiques et mythologiques, le goût de la liberté dans la fantaisie, l’énergie. Mais, amplifiant l’impulsion donnée par Théophile Gautier avec son culte de l’Art pour l’Art et par Théodore de Banville, Leconte de Lisle rompt avec ce mouvement et défend une doctrine nouvelle—celle qui va servir de modèle aux parnassiens—caractérisée par quelques principes: la poésie doit rester impersonnelle (le poète ne doit pas chanter son ego) ; le poète doit privilégier le travail de la forme plutôt que se laisser aller à sa seule inspiration débridée ; il doit viser la beauté, dont l’antiquité (grecque, hindoue, nordique, etc.) fournit les modèles absolus ; par opposition aux sentiments, la science, guidée par la raison, constitue un champ d’expression infini ; le poète ne doit pas s’impliquer dans la vie moderne. Idées philosophiques [Cette section est un extrait de J. Calvet, Manuel illustré d’histoire de la littérature française, J. de Gigord, 13e édition, 1946, p. 715.] À l’Antiquité grecque et à l’Inde, Leconte de Lisle ne demandait pas seulement des mythes pour ses rêves et des images pour sa poésie: il y cherchait aussi des idées. Voué au culte de la Beauté, il estime qu’elle n’a été aimée et réalisée que par le paganisme grec et que le christianisme en a détruit le culte. De là cette haine contre l’Église, les papes et les rois, dont il emprunte l’expression, en l’amplifiant, à Victor Hugo et à Flaubert. Pour le monde moderne, fermé au sens de la beauté, il n’a pas assez de sarcasmes. Ne trouvant partout que déception et douleur, il va chercher dans l’Inde la philosophie consolatrice: c’est le nirvana, l’écoulement et l’anéantissement de l’être ; tout est vain, tout est illusion, même la vie, il n’y a qu’une réalité, le calme du néant où la mort nous précipitera en nous guérissant de la fièvre d’avoir été. La poésie est une distraction, et elle nous prépare à accepter et à souhaiter le néant. Biographie Discours de Jean Mistler [Cette section reprend une grande partie d’un discours prononcé par Jean Mistler à la Bibliothèque nationale, le 23 septembre 1977.] Il naquit à Saint-Paul en 1818, et cette île berça son enfance sous ses palmiers peuplés d’oiseaux éclatants. Son paysage intérieur a été formé de ces images, de ces couleurs, de ces parfums. En écrivant ses poèmes bibliques, il n’a eu nul besoin de puiser dans les récits de la Genèse pour évoquer le paradis terrestre, il lui a suffi de se souvenir. Leconte de Lisle avait trente ans lorsque la Révolution de 1848 apporta la liberté aux esclaves. Sans attendre cette date, il avait combattu le servage dans ses premiers écrits, notamment dans les deux nouvelles publiées vers 1845: l’une montrait le Noir Job amoureux de la créole Marcie, et l’autre, un esclave, Sacatove, qui enlevait sa jeune maîtresse. Ces deux récits finissaient dans le sang et de manière un peu mélodramatique, mais ils montrent que le problème de l’égalité des hommes se posait déjà fortement pour le jeune écrivain. Cette libération des esclaves, répondant à son idéal de justice, posa cependant de difficiles problèmes pour son père et pour lui. Réalisée peut-être après une préparation insuffisante, la réforme fut suivie, à la Réunion, d’une grave crise économique, sa famille fut ruinée et la pension que le jeune étudiant parisien recevait n’arriva plus qu’irrégulièrement, puis cessa tout à fait, et ce fut pour lui la misère. Le groupe d’artistes décrit par Henry Murger dans sa Vie de Bohème ne fut pas le seul, dans le Paris de 1850, à vivre d’expédients! Des enfants des Îles, amis de notre poète et poètes eux-mêmes, ou journalistes, tels que Lacaussade et Laverdan, d’autres nés à Paris, Thalès Bernard, Louis Ménard, connurent comme lui, non seulement des fins de mois difficiles, mais des mois entiers d’expédients et de privations, les cachets impayés à la pension Laveur en retard chez les logeuses et une liberté s’alimentant au pain et à l’eau, comme dans les prisons. Un cousin de Leconte de Lisle, Foucque, qui est riche, ne lui donne point d’argent, mais des conseils: « Tu rimes facilement, pourquoi n’écrirais-tu pas des chansons pour Thérésa ? » Écrire, oui, le jeune homme écrira, mais pas pour les chanteuses de cafés-concerts! Ses amis et lui-même visent plus haut: Lacaussade achève une traduction d’Ossian, Thalès Bernard travaille à un savant Dictionnaire de la mythologie, Louis Ménard, qui gagne à peu près convenablement sa vie comme préparateur au laboratoire du chimiste Pelouze (et qui, par parenthèse, y découvrira un jour le collodion), se plonge dans l’exégèse des religions et des mythes et étudie les textes symboliques de la vieille Égypte. Les bourgeois peuvent bien rire en voyant Ménard se promener au Luxembourg, portant autour du cou un boa de plumes passablement dépenaillé, mais le soir, lorsque les amis se retrouvent, au cinquième étage de Leconte de Lisle, sans feu, autour d’une chandelle de suif qui pleure sur la table, dans l’épaisse fumée des pipes, ils évoquent les ciels lumineux de l’Orient, les marbres de la Grèce, et ce sont déjà les rêves mystiques et païens que fera revivre un jour Louis Ménard. La politique ? Oui, ils en font beaucoup et ils ont applaudi à la chute du roi citoyen. Ils sont affiliés à des clubs d’extrême gauche et Leconte de Lisle sera même chargé d’une campagne électorale, dans les Côtes-du-Nord, par le Club des clubs, sorte de centrale des groupements extrémistes: ce voyage ne lui vaudra que quelques horions. Il n’y a pas grand-chose non plus à retenir de sa collaboration à La Démocratie pacifique ou à d’autres organes plus ou moins fouriéristes. Retenons simplement—conclusion prévisible—l’échec du jeune homme à la licence en droit. Quant à croire qu’il fit vraiment le coup de feu pendant les journées de juin et qu’il alla, comme on l’a raconté, laver dans la Seine « sa figure noire de poudre », j’en doute un peu: les gardes nationales avaient la détente facile ces soirs-là, et je pense que, s’il coucha une nuit ou deux au poste, ce fut tout. En tout cas, de cette période de bouillonnement intellectuel, Leconte de Lisle garda des opinions farouchement républicaines qui ne se calmèrent un peu qu’au spectacle de la Commune en 1871. Du moins, ce qui ne devait point pâlir, ce fut son anticléricalisme. Le poète descendit de sa tour d’ivoire—entendez le cinquième du boulevard des Invalides, ou, plus tard, le quatrième de la rue Cassette—pour rédiger un Catéchisme populaire républicain en trente-deux pages, et ensuite une Histoire populaire du christianisme, qui furent ses deux plus grands succès de librairie, mais n’ajoutent rien à Qaïn ou à Hypathie. Né dans toute l’Europe du bouleversement politique et social qui avait renversé tant de trônes et d’institutions, le romantisme prétendait apporter du nouveau, non seulement dans les arts et les lettres, mais aussi dans les idées et dans les mœurs. Le Parnasse eut des ambitions plus étroitement littéraires. Arrivant à un moment de notre histoire où s’étaient succédé, en soixante ans, sept ou huit régimes politiques, et groupant des hommes plus âgés de quinze à vingt ans que les jeunes chevelus du Cénacle, les Parnassiens cherchaient moins à régenter et à formuler des théories qu’à donner des exemples. Ils ne fondèrent pas une revue, comme avait été jadis la Muse française, mais ils publièrent un recueil collectif de poésie, le Parnasse contemporain, un in-octavo qui parut trois fois: en 1866, sur deux cent quatre-vingt-quatre pages, en 1869, sur quatre cent une, enfin en 1876, sur quatre cent cinquante et une. Cette dernière édition groupait soixante-neuf poètes. L’ordre alphabétique n’y était troublé que par la contribution de Jean Aicard qui, parvenue trop tard, fut rejetée à la fin. Dans les trois éditions, on retrouvait tous les noms connus, et même plusieurs inconnus. De Baudelaire à Verlaine et Catulle Mendès (dont il existe depuis peu une biographie téléchargeable sur Amazon) à Mallarmé, tous les poètes étaient là sauf le plus grand. Certes Hugo était en exil en 1866, lorsque parut le premier Parnasse, mais ses livres étaient publiés en France sans entrave. Ne fut-il donc pas sollicité ? On a peine à le croire, mais encore plus de peine à supposer qu’il aurait refusé. Les contributions étaient aussi inégales en qualité qu’en étendue: vingt-six sonnets de Heredia, vingt-quatre rondeaux de Banville, un acte d’Anatole France, les Noces corinthiennes, un énorme poème de Leconte de Lisle, l’Épopée du moine. Leconte de Lisle, à qui la responsabilité des choix n’incombait point, jugeait l’ensemble sans indulgence, et voici ce qu’il en disait, dans une lettre du 19 janvier 1875 à Heredia: « Ce que je connais des rimes envoyées est assez misérable, celles de Prudhomme, de Manuel, de Mme Ackermann, de Mme Blanchecotte et de Soulary sont écœurantes. En outre, on a donné à Lemerre une poésie de Baudelaire, et absolument authentique, quoi qu’en disent quelques-uns, attendu qu’il me l’a récitée lui-même, il y a bien des années. Ces vers sont fort obscènes et non des meilleurs qu’il ait faits. » Tout ce que je sais de ce poème, c’est qu’il ne devait point figurer dans le volume paru en 1876. Tel quel, le Parnasse contemporain fut ce qu’on appelle aujourd’hui une manifestation de masse. Son effet se prolongea longtemps après la mort de ses principaux participants, et l’Université ne fut pas étrangère à sa durée: elle retrouvait en effet chez Leconte de Lisle, et même chez Heredia, le solide héritage de la tradition gréco-latine et des poètes qui, tels Ronsard ou Chénier, avaient su la faire revivre sur le terroir français. Reconnu chef d’école, Leconte de Lisle devait, assez naturellement, penser à l’Académie. Il ne se hâta pourtant pas et s’y présenta pour la première fois qu’à près de soixante ans. […] La modeste indemnité académique—quinze cents francs à l’époque, mais des francs-or—n’eût cependant pas été à dédaigner pour l’auteur des Poèmes barbares, dont la situation matérielle était très difficile. Marié depuis trente ans avec une jeune orpheline rencontrée jadis chez les Jobbé-Duval, il menait la vie la plus simple: la pauvreté en redingote. Ses droits d’auteur étaient insignifiants et les articles qu’il donnait de temps en temps dans la presse, fort mal payés. Le Conseil général de la Réunion lui versait une petite subvention, mais elle fut supprimée en 1869. Le gouvernement impérial, désireux d’encourager la littérature, avait accordé au poète, à partir de 1863, une pension annuelle de 3 600 francs. Les anciens rois de France avaient octroyé de telles faveurs à plusieurs écrivains et les souverains du XIXe siècle avaient repris cette tradition. Mais, après le 4 septembre, cette allocation fut retirée et on la reprocha durement à Leconte de Lisle. L’intervention de quelques amis fit obtenir au poète une modeste sinécure, un poste de conservateur-adjoint à la bibliothèque du Sénat. Son caractère ombrageux prit fort mal la chose et il écrivit à Heredia: « Ce n’est au fond qu’une insulte de plus ajoutée à toutes celles que j’ai déjà endurées. » Cependant, l’agréable appartement de fonction attaché à cette place, avec ses fenêtres sur le jardin du Luxembourg, lui fit un certain plaisir. Chaque année, il allait au bord de la mer, en Normandie ou en Bretagne, soit dans un modeste meublé, soit chez des amis. Mais il se plaignait souvent de la chaleur excessive! Au Puis, près de Dieppe, par exemple, en septembre 1891, il se réjouit de voir arriver « de copieuses ondées qui rafraîchissent l’air et de bons vieux nuages assez noirs qui obscurcissent l’atroce sérénité du ciel ». Mais après cette « atroce sérénité », il enchaîne, peut-être en souriant sous cape: « J’aurais dû naître ou vivre au fond de quelque fjord de Norvège, dans un perpétuel brouillard, en compagnie des phoques dont je partage les goûts et les mœurs, n’ayant jamais su lire ni écrire et fumant d’éternelles pipes en l’honneur des Dieux Norses. » Malgré tout, ses amis, et notamment le fidèle Heredia, lui conseillent toujours de se présenter à l’Académie. Le 9 août 1883, répondant sans doute à une lettre particulièrement pressante, il écrivait à Heredia cette curieuse page qui nous introduit dans le cercle de Victor Hugo: « Quant à l’Académie, j’y renonce absolument, sauf dans le cas où Hugo mourrait avant moi… » […] Cependant, Hugo meurt le 22 mai 1885, et alors, à l’élection du 11 février 1886, brusque changement à vue: dès le premier tour, Leconte de Lisle est élu, par vingt et une voix contre six à Ferdinand Fabre, le romancier des gens d’église! François Coppée eut ce commentaire: « Leconte de Lisle répandra à l’Académie sa noire méchanceté, comme la seiche dans les flots de la mer. » Si c’est être méchant que d’être juste, je dois à la vérité de dire que l’auteur des Poèmes barbares a porté sur Coppée plus d’un jugement où la justice tient davantage de place que l’indulgence. Il fit pour sa réception un consciencieux éloge de Hugo et, dans sa réponse, Alexandre Dumas fils ne dépassa point l’esthétique du Demi-monde et de la Dame aux camélias. Les Goncourt, qui assistaient à la séance, notèrent dans leur Journal que, pendant les discours, Coppée regarda beaucoup en l’air, vers la Coupole… La fin de la vie de Leconte de Lisle fut sans grands événements extérieurs. Il ne mourut point en pleine jeunesse, comme Chénier, Nerval, Apollinaire, il n’atteignit pas non plus l’âge des patriarches, mais c’est dans ses dernières années qu’il connut le plus profondément les joies et les tortures de l’amour, et cet homme qui avait fait de l’impassibilité le premier article de son art poétique, écrivit: Amour, tu peux mourir, ô lumière des âmes, Car ton rapide éclair contient l’Éternité.Il s’éteignit le 17 juillet 1894, en pleine lucidité. […] Au lendemain de sa mort, un poète écrivait que Leconte de Lisle « avait rendu leurs anciens noms aux dieux ». Oui, mais il ne s’est pas borné à ceux de la Grèce et de Rome, à ceux du Parthénon et du temple d’Égine. Son horizon ne s’est point limité à la Méditerranée classique, il y a fait entrer les vents et les nuages de tous les ciels, les houles de tous les océans. Dans cette poésie cosmique, l’histoire est présente. Oui, le même vaisseau qui emporta Hélène est toujours paré pour emporter nos rêves. Là-bas, vers ce point de l’horizon marin d’où sans cesse, depuis Eschyle, accourt l’innombrable troupeau des vagues rieuses. Galerie Portraits Monuments Chronologie Œuvres Poésie * L’apport littéraire essentiel de Leconte de Lisle est constitué par les trois recueils de poésie qu’il a destinés à la publication, tels que mentionnés dans le tableau suivant. Compte tenu du nombre d’éditions et d’évolutions que ces recueils ont connues de son vivant, ce tableau précise pour chacun d’eux les éditions les plus significatives: * la première édition, en raison du rôle qu’elle a joué dans l’histoire littéraire ; * la dernière édition composée par lui, appelée de ce fait « édition de référence ».En dehors de ces trois recueils, il existe des poèmes, publiés de son vivant ou pas, qui ont fait l’objet de deux recueils posthumes dans la décennie qui a suivi sa disparition: * Pendant près d’un siècle et demi, la structure adoptée pour la publication des poésies complètes de Leconte de Lisle a été celle de l’éditeur Alphonse Lemerre, en quatre volumes, constitués entre 1872 et 1895: Poèmes antiques, Poèmes barbares, Poèmes tragiques, Derniers Poèmes. * En 2011, Edgard Pich, dans son édition critique nouvelle, a mis en évidence qu’entre 1837 et 1847, Leconte de Lisle avait constitué sans les publier quatre recueils de poésie: Essais poétiques de Ch. Leconte de Lisle ; Cœur et âme ; Odes à la France ; Hypatie. * Les poèmes de Leconte de Lisle sont sur wikisource. Liste des œuvres * Outre la poésie qui constitue l’essentiel de son œuvre, Leconte de Lisle a écrit des pièces de théâtre, des traductions d’auteurs anciens, des manifestes, des récits en prose, des œuvres polémiques, des notices, des discours, des préfaces, des pétitions. La liste suivante répartit les œuvres connues de Leconte de Lisle selon ces catégories et, à l’intérieur de chaque catégorie, les range par ordre chronologique de publication. Pour certaines œuvres, les dates des rééditions parues avant 1900 sont aussi mentionnées. Une partie importante des œuvres est disponible sur wikisource. * Les deux œuvres suivantes sont mentionnées séparément, car elles posent problème: * 1854. Épître au Czar, au sujet des lieux saints adressée à S. M. Nicolas Ier, par Le Cte de Lisle, Paris, chez Ledoyen, in-8, IX-63 p. Cette œuvre est attribuée à Leconte de Lisle dans l’ouvrage collectif Le premier siècle de l’Institut de France, sous la direction du comte de Franqueville (1895). En réalité, ce comte de Lisle a écrit, p. 30 de son œuvre, qu’il était « propriétaire et rédacteur en chef du journal La France, qu’il avait fondé dans les intérêts monarchiques et religieux de l’Europe ». Il n’a donc rien à voir avec le poète. * 1873. Grand Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas. La contribution de Leconte de Lisle est inconnue. En mars 1870, Dumas remet son manuscrit à l’éditeur Alphonse Lemerre. Il ne le verra pas publié: il meurt le 5 décembre de la même année. Après la guerre et la Commune, Lemerre confie à Leconte de Lisle et au jeune Anatole France la direction éditoriale de l’ouvrage, qui paraît en 1873. Ce sont d’ailleurs vraisemblablement ces deux écrivains qui ont signé L.T. l’avant-propos « Alexandre Dumas et le Grand Dictionnaire de cuisine », L. pour Leconte de Lisle et T. pour Thibault, le vrai nom de France. À l’appui supplémentaire de cette hypothèse, l’hommage appuyé à Baudelaire, qu’admiraient tant les poètes parnassiens. On doit peut-être à Leconte de Lisle la part importante qui y est donnée aux épices et aux recettes exotiques. Articles * Esquisses littéraires. Article premier. Hoffmann. De la satire fantastique, « La Variété », deuxième livraison, mai 1840, p. 44-49 ; texte sur wikisource. * George Sand. Cosima, « La Variété », deuxième livraison, mai 1840, p. 58-60 ; texte sur wikisource. * Esquisses littéraires. Article deuxième. Sheridan. De l’art comique en Angleterre, « La Variété », troisième livraison, juin 1840, p. 66-72 ; texte sur wikisource. * Esquisses littéraires. Article troisième. André Chénier. De la poésie lyrique à la fin du XVIIIe siècle, « La Variété », cinquième livraison, août 1840, p. 129-135 ; texte sur wikisource. * Revue mensuelle. Toussaint Louverture. Romans et nouvelles. Poésies. Une revue critique, « La Variété », cinquième livraison, août 1840, p. 159-160 ; texte sur wikisource. * Revue mensuelle. Revue parisienne. Romans. Poésie de Lacenaire. M. Alexandre Dumas, « La Variété », septième livraison, octobre 1840, p. 190-192 ; texte sur wikisource. * Revue dramatique. Vaudeville. Les Fleurs animées.—Gymnase. Les Quatre Reines.—Palais Royal. Mon Voisin d’omnibus, « La Démocratie pacifique », 21 juillet 1846 ; texte sur wikisource. * Les Femmes de Byron, « La Phalange », t. IV, septembre 1846, p. 184-188 ; texte sur wikisource. * Théâtre-Français. Don Gusman ou la Journée d’un séducteur, comédie en cinq actes et en vers par M. Adrien de Courcelles, « La Phalange », t. IV, octobre 1846, p. 383 ; texte sur wikisource. * La Justice et le Droit, « La Démocratie pacifique », 25 octobre 1846, p. 1 ; texte sur wikisource. * Un dernier attentat contre la Pologne!, « La Démocratie pacifique », t. VII, no 122, 22 novembre 1846 ; texte sur wikisource. * L’Oppression et l’Indigence, « La Démocratie pacifique », 29 novembre 1846 ; texte sur wikisource. Correspondance Répertoires * La correspondance de Leconte de Lisle a fait l’objet de répertoires: * Irving Putter, La dernière illusion de Leconte de Lisle, Librairie Droz– Genève, 1968, appendice A, p. 166-170. Il s’agit d’un répertoire des principaux ouvrages contenant des lettres de Leconte de Lisle. * Œuvres de Leconte de Lisle, édition critique par Edgard Pich, IV, Œuvres diverses, Société d’édition « Les Belles Lettres », 1978, p. 576-596. Sélection d’ouvrages * 1902. Lettres à Julien Rouffet ; Texte sur wikisource * 1968. Lettres à Émilie Leforestier * 1894. Lettres à Jules Huret, à l’occasion du différend de Leconte de Lisle avec Anatole France en 1891 ; les lettres figurent en appendice de: Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1894, p. 439-442 ; texte sur wikisource * 1927. Lettre à Gustave Flaubert. * 1933. Lettres échangées avec Jean Marras * 2004. Correspondance entre Leconte de Lisle et Franz Servais * 2004. Lettres à José-Maria de Heredia Entrevues * Le Télégraphe, 8 juin 1885, La succession de Victor Hugo à l’Académie Française. Chez M. Leconte de Lisle. * Le Matin, 15 février 1886, Leconte de Lisle ; Texte sur Gallica * Gazette anecdotique, 31 octobre 1888, p. 235, [Shakespeare] * L’Écho de Paris, 29 avril 1891, Enquête sur l’évolution littéraire, article signé Jules Huret, p. 2 ; journal sur Gallica ; article repris dans Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1894, p. 278-286 ; texte sur wikisource * Le Journal, 30 septembre 1892, Une statue à Baudelaire– Chez M. Leconte de Lisle. * Le Rappel, 5 janvier 1893, Chez M. Leconte de Lisle—La santé du poète—Au dîner celtique—Les chances de M. Zola—Les décadents. Article signé Noël Amaudru. texte de l’article sur Gallica. * Le Gaulois, 20 mars 1893, Interview-Express ; texte sur Gallica * L’Éclair, 21 janvier 1894, Le sort d’une tête– Comment devrait être composée la commission des grâces. Sources Éditions modernes des œuvres de Leconte de Lisle * Les éditions des œuvres ou poésies complètes sont, selon l’ordre chronologique inverse de leur publication: * 2011-2015. Leconte de Lisle, Œuvres complètes, édition critique par Edgard Pich, collection « Textes de littérature moderne et contemporaine », Paris, Honoré Champion éditeur, en cinq tomes, n’incluant pas les traductions. Les tomes I à IV sont reliés et le tome V est broché: * Tome I: L’Œuvre romantique (1837-1847), 2011. (ISBN 978-2-7453-2157-2) * Tome II: Poèmes antiques (1837-1848), 2011. (ISBN 978-2-7453-2238-8) * Tome III: Poèmes barbares, 2012. (ISBN 978-2-7453-2399-6) * Tome IV: Poèmes tragiques, Les Érinnyes, Derniers Poèmes, L’Apollonide, 2014. (ISBN 978-2-7453-2631-7) * Tome V: Œuvres en prose (1852-1894), 2015. (ISBN 978-2-7453-2835-9) * 2011. Leconte de Lisle, Œuvres complètes, édition critique publiée par Vincent Vivès, Classiques Garnier, collection « Bibliothèque du XIXe siècle » sous la direction de Pierre Glaudes et Paolo Tortonese, no 11, série Leconte de Lisle dirigée par Didier Alexandre, en onze tomes, incluant les traductions: * Tome I: Poèmes antiques, 2011. (ISBN 978-2-8124-0304-0) * Tome II à XI: à paraître ? (Le projet semble avoir été abandonné.) * 1976-1978. Œuvres de Leconte de Lisle, édition critique par Edgard Pich, publiée par la Société d’édition « Les Belles Lettres », en quatre tomes: * Tome I: Poèmes antiques, 1977. * Tome II: Poèmes barbares, 1976. * Tome III: Poèmes tragiques– Derniers Poèmes, 1977. * Tome IV: Œuvres diverses, 1978.Pour compléter cette édition, signalons qu’Edgard Pich avait déjà rassemblé un certain nombre de textes de Leconte de Lisle: * Articles, Préfaces. Discours, textes recueillis, présentés et annotés par Edgard Pich, Les Belles Lettres, 1971. * 1927-1928. Poésies complètes de Leconte de Lisle, texte définitif avec notes et variantes [de Jacques Madeleine et Eugène Vallée, mentionnés tome IV, p. 228], eaux-fortes de Maurice de Becque, Lemerre, en quatre tomes: * Tome I: Poèmes antiques, 1927. * Tome II: Poèmes barbares, 1927. * Tome III: Poèmes tragiques. – Les Érinnyes. – L’Apollonide, 1928. * Tome IV: Derniers poèmes, La Passion, Pièces diverses, Notes et variantes, 1928.En format de poche, il existe une édition de deux recueils, présentée, établie et annotée par Claudine Gothot-Mersch, Gallimard, collection « Poésie »: * 1985. Poèmes barbares, collection « Poésie » no 202 ; * 1994. Poèmes antiques, collection « Poésie » no 279.Depuis 2000: * 2001, éditions Paléo: Homère: Hymnes, La Batrakhomyomakhie, Épigrammes. * 2007, éditions Omnibus: Mourir pour Troie, Eschyle, Sophocle, Euripide. Édition établie par Annie Collognat-Barès. * 2009, éditions Bibliobazaar: Poèmes Barbares ; Poèmes Tragiques ; Catéchisme populaire républicain. * 2009, éditions Kessinger Publishing: Catéchisme populaire républicain ; Le Sacre de Paris ; Homère: Odyssée ; Eschyle ; Histoire populaire du Christianisme. * 2009, éditions Pocket classiques: Homère: Odyssée, préface de Paul Wathelet ; Homère: Iliade, préface d’Odile Mortier-Waldschmidt, commentaires d’Annie Collognat-Barès. * 2010, éditions Bibliobazaar: Poëmes et poésies ; Discours de réception de Leconte de Lisle et réponse d’Alexandre Dumas fils. * 2010, éditions Kessinger Publishing: Premières poésies et lettres intimes * 2010, éditions Nabu Press: Poèmes antiques ; Poèmes barbares ; Poèmes tragiques ; Derniers Poèmes. La Passion. L’Apollonide. Poètes contemporains ; Euripide ; Homère: Odyssée ; Catéchisme populaire républicain ; Discours de réception à l’Académie française ; Sophocle ; Poèmes et poésies ; Idylles de Théocrite et Odes anacréontiques ; Histoire populaire de la Révolution française ; Eschyle ; Le Sacre de Paris. Ouvrages sur la vie de Leconte de Lisle Témoignages directs * Théodore de Banville, Camées parisiens, troisième et dernière série, « Petite bibliothèque des curieux », Paris, chez René Pincebourde, 1873 ; quatrième douzaine, ch. I, Leconte de Lisle, p. 115. Texte sur wikisource * Léon Barracand: * Leconte de Lisle, Revue bleue, 28 juillet 1894, p. 97-101. Texte sur wikisource * Souvenirs d’un homme de lettres, in Revue des deux mondes, 15 août et 1er septembre 1937. Texte sur wikisource * Jules Breton, Un peintre paysan, Alphonse Lemerre, 1896, p. 187-196 ; texte sur wikisource. * Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, Nouvelle Librairie Nationale, 1920, pages 54-56. texte sur wikisource. * Jean Dornis * Leconte de Lisle intime, 1895 ; texte sur wikisource * Essai sur Leconte de Lisle, 1909 ; texte sur wikisource * Henry Houssaye, Discours de réception à l’Académie française, avec l’éloge de Leconte de Lisle, prononcé le 12 décembre 1895. Texte sur wikisource * José Maria de Heredia, Léon Bourgeois, Sully Prudhomme, etc., Discours prononcés et poème lu lors de l’inauguration du monument de Denys Puech érigé « à Leconte de Lisle » au jardin du Luxembourg, le 10 juillet 1898, Le Temps, 11 juillet 1898 ; texte sur Gallica * Jacques-Vincent, Un salon parisien d’avant-guerre, Éditions Jules Tallandier, 1929, ch. 1 à 3, Période: 1892-1894. * Jules Massenet, Mes souvenirs, 1848-1912, Pierre Lafitte & Cie, 1912, chapitre IX, Au lendemain de la guerre. Texte sur wikisource. * Jean Moréas, Feuillets, Éditions de la Plume, 1902, ch. I, « Leconte de Lisle », p. 7-13. Texte sur IA * Adolphe Racot, Portraits d’aujourd’hui, À la librairie illustrée, 1887 ; ch. Leconte de Lisle, p. 113-124. Texte sur Gallica * Henri de Régnier * Portraits et souvenirs, Mercure de France, 1913, chapitre « Au Luxembourg », p. 51-59. texte sur IA * Proses datées, Mercure de France, 1925, ch. 1, p. 5-20. * Nos rencontres, Mercure de France, 1931, chapitre « Louis Ménard et Leconte de Lisle », p. 215-228 ; texte sur Gallica. * Louis Tiercelin, Bretons de Lettres, Honoré Champion, 1905 ; ch. 1 « Leconte de Lisle étudiant (1837-1843) », p. 1-158. Texte sur wikisource * Paul Verlaine, Souvenirs sur Leconte de Lisle, Le Journal, 20 juillet 1894. * Henri Welschinger, Leconte de Lisle bibliothécaire, Journal des débats, 16 août 1910 ; Texte sur wikisource. Autres documents * Marius-Ary Leblond, Leconte de Lisle, essai sur le génie créole, Mercure de France, 1906. Texte sur wikisource * Fernand Calmettes, Un demi-siècle littéraire, Leconte de Lisle et ses amis, Plon, s.d. Texte sur wikisource * Edmond Estève, Leconte de Lisle, l’homme et l’œuvre, Boivin & Cie, s.d. ; Texte sur wikisource * Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857, Gallimard, 1972, éd. revue et complétée 1988, tome 3, livre I. La névrose objective, 5. Névrose et prophétie, p. 338-440. * Jean Mistler, Sous la Coupole, Bernard Grasset, 1981. Le chapitre consacré à Leconte de Lisle reprend, en treize pages, un discours prononcé à la Bibliothèque nationale le 23 septembre 1977. * Henri Cornu, Charles Marie Leconte de Lisle. Bourbon et Marie-Élixène, Azalées Éditions & Musée de Villèle, 1995, (ISBN 2-908127-39-3). * Caroline De Mulder, Leconte de Lisle, entre utopie et république, Éditions Rodopi B.V. Amsterdam-New York, 2005, (ISBN 90-420-1657-4) Biographie de référence * Christophe Carrère, Leconte de Lisle ou la Passion du beau, Fayard, 2009. (ISBN 978-2-213-63451-7). Études de l’œuvre de Leconte de Lisle Critiques contemporaines de Leconte de Lisle * Le tableau suivant inclut la plupart des critiques retenues par Catulle Mendès, dans l’article consacré à Leconte de Lisle dans son Rapport sur le Mouvement poétique français de 1867 à 1900, Imprimerie nationale, 1902, p. 162-166 (voir le texte de l’article et les extraits des critiques sur Gallica). * À signaler également la monographie suivante que Paul Verlaine a consacrée à Leconte de Lisle: Études classiques * Citons, parmi les auteurs d’études parues entre 1895 et 1944: * P.V. Delaporte, * Jean Dornis, * Pierre Flottes, * Joseph Vianey. Études modernes * Citons parmi les études parues depuis 1945: * Irving Putter 1951-54-61 * Jules-Marie Priou, 1966 * Edgard Pich, 1975 * Robert Sabatier, 1977 Divers Famille de Leconte de Lisle * Son grand-père paternel: Charles Marie Leconte de Lisle (1759-1809), apothicaire à Dinan. * Ses parents, mariés le 26 novembre 1817 à Saint-Paul (La Réunion). * Son père: Charles Marie Leconte de Lisle, né le 14 octobre 1793 à Dinan (Côtes-du-Nord), Breton, nommé chirurgien sous-aide dans les armées de Napoléon, émigrant en 1816 à l’Île Bourbon (actuellement Île de la Réunion) et devenu planteur ; mort à Saint-Denis (La Réunion) le 28 juillet 1856. * Sa mère: Anne Suzanne Marguerite Élysée de Riscourt de Lanux (1800-1872), fille d’un planteur de Saint-Paul, arrière-petite-fille de Jean Baptiste François de Lanux, issue d’une famille du Languedoc installée à Bourbon depuis 1720 (en la personne du Marquis François de Lanux, languedocien, exilé par le Régent), qui appartient à l’aristocratie de l’île et est apparentée au poète Parny. * Ses cinq frères et sœurs: • Élysée Marie Louise (23 octobre 1821– ?) • Alfred (10 novembre 1823– janvier 1888) • Anaïs (31 juillet 1825– ?) • Emma (1836– ?) • Paul (18 mars 1839– 23 février 1887). * Sa femme: Anna Adélaïde Perray (29 mars 1833, Versailles—8 septembre 1916, Versailles), fille de Jacques Perray et d’Amélie Leconte. Mariage: Paris, 10 septembre 1857. Origine du nom de Leconte de Lisle * Les éléments constitutifs du nom « Leconte de Lisle » ont les origines suivantes: * de Lisle. Ce nom provient de la terre de « l’Isle », située sur les anciens villages de Saint-Samson-de-l’Isle et de Cendres (non loin du Mont Saint-Michel) qui font partie aujourd’hui de la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). * Leconte: les ancêtres de Leconte de Lisle s’appelaient « Le Conte » ; il y eut: 11. Jean (au milieu du XVIe siècle) ; 10. Jean ; 9. Thomas ; 8. Charles ; 7. Thomas ; 6. Jean (fin du XVIIe siècle) ; 5. Michel (apothicaire, habite Pontorson, ajoute « de Préval » à son nom, et, ayant épousé la fille de François Estienne, hérite de la terre de « l’Isle ») ; 4. Jacques Le Conte de Préval ; 3. Charles Marie Le Conte, grand-père du poète (c’est lui qui ajoute « de l’Isle » à son nom) ; 2. Charles Marie (père du poète) ; 1. Charles Marie René (le poète ; c’est lui qui fusionne “Le” et “Conte” en “Leconte”).Remarque.—Corrigeons plusieurs erreurs souvent rencontrées à propos du nom du poète: * Leconte de Lisle n’était en rien un aristocrate: le “de” n’est pas une particule nobiliaire, pas plus que “Leconte” n’est une déformation de “Le Comte”. * Leconte de Lisle n’a pas cherché, par vanité, à faire croire à une prétendue origine noble, en ajoutant “de Lisle” à son nom “Leconte”: le nom complet “Le Conte de Lisle” était déjà le patronyme de sa famille paternelle. Et c’est même lui le premier qui a réuni “Le” et “Conte”, « pour éviter le semblant d’un titre ». * Le nom “Lisle” ne se rapporte pas, avec une écriture archaïque, à l’île Bourbon (La Réunion), son lieu de naissance: Lisle est en fait le nom d’une terre bretonne, située à Pleine-Fougères. * “Leconte de Lisle”, dans les rangements alphabétiques, doit se placer à "Leconte…", et non pas à “Lisle (Leconte de)”. Lieux où Leconte de Lisle a vécu * Au total, en dehors de son île natale et de la métropole, ses voyages l’auront amené à voir l’Île Maurice, Le Cap et l’Île Sainte-Hélène. Cela laisse peu de place à des « voyages en Orient » évoqués parfois. Ils ont probablement été inventés, peut-être sur la base de déclarations de Leconte de Lisle lui-même. * * Iconographie de Leconte de Lisle * Des photographies sont disponibles sur le site de la BNF: se reporter au paragraphe Liens externes en fin d’article. * Portrait, par Jean-François Millet. * Portrait, par Jobbé-Duval, 1850 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, p. 176A sur wikisource * Gravure-caricature d’Étienne Carjat. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 25. * Portrait, par Rajon, pour Poèmes antiques, 1874. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 26. * Portrait, par F. A. Cazals. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 31. * Dessin, par Maurice Ray. En frontispice des Poèmes antiques, Société des Amis du Livre, 1908. * Photographies, par Nadar: sur Gallica 1, 2, 3, 4. * Photographie de la collection Félix Potin, par Boyer: exemplaire au musée d’Orsay. * Photographie, par Carjat, 1857 ; reproduction en frontispice de: Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, sur wikisource * Photographie, du studio Eugène Piriou, décembre 1878. Reproduction dans: Malou Haine, L’Apollonide de Leconte de Lisle et Franz Servais. * Dessin, par E. Giraudat, après 1886. Reproduction dans: Malou Haine, L’Apollonide de Leconte de Lisle et Franz Servais. * Tableau Chez Alphonse Lemerre, à Ville-d’Avray, par Paul Chabas. Ce tableau représente de nombreux parnassiens, dont Leconte de Lisle, dans la propriété de l’éditeur. Il a été exposé au salon de 1895. * Quatre eaux-fortes, par Maurice de Becque. En frontispice des 4 tomes de l’édition Lemerre, 1927-28. * Photographie, par Émile Perray. En frontispice de: Pierre Flottes, Le Poète Leconte de Lisle– Documents inédits, 1929. * Deux croquis, par Paul Verlaine. * Portrait, par Jacques-Léonard Blanquer, 1885. * Dessin de Jules Breton, 1885 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, p. 272A, sur wikisource. * Dessin de M. Reichan. Paris.– Une séance de réception à l’Académie française, dessiné d’après nature par M. Reichan, lors de la réception de M. le Comte de L’Isle [sic], journal hebdomadaire Le Monde illustré, n° 1655, 15 décembre 1888, lien vers Gallica, p. 380-381. * Portrait de Benjamin Constant, 1888 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, p. 320A, sur wikisource. * Henri Mairet, Panorama du siècle, album de 110 photos ; voir planche 26 recto: Leconte de Lisle, 1889TimbreUn timbre, émis par la Poste en 1978, dans le groupe « Personnages célèbres 1978 ». Sources des poèmes * Joseph Vianey a établi les principales sources utilisées par Leconte de Lisle. La liste est la suivante. * Poèmes indiensLe Maha-Bharata, traduit par Hippolyte Fauche, Paris, Durand, 1865, texte du Mahâ-Bhârata sur wikisource * Victor Henry, Les Littératures de l’Inde ; édition 1904 en ligne sur Gallica * Valmiky, Ramayana, traduit du sanskrit par Hippolyte Fauche, Paris, Franck, 1854 ; texte sur wikisource * Rig-Véda ou livre des Hymnes, traduit du sanskrit par Alexandre Langlois, 4 vol., Paris, F. Didot, 1848-51 ; édition 1870 en ligne sur wikisource * Le Bhâgavata Purâna ou Histoire politique de Krichna, traduit et publié par Eugène Burnouf, Paris, Imprimerie royale, 1840-47, texte sur wikisource: tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 * Jules Lacroix de Marlès, Histoire générale de l’Inde ancienne et moderne, depuis l’an 2000 avant J.C. jusqu’à nos jours, Paris Emler frères, vol. 1/6, appendice no II, Naissance, mariage et aventures de Nour-Mahal, page 177-189, texte sur wikisource.Poème égyptienGaston Maspero, Études de mythologie et d’archéologie égyptiennes, en ligne sur Gallica: 1 2 3 4 5 6 7 8 * Gaston Maspero, Les Contes populaires de l’Égypte ancienne, en ligne sur wikisource: édition 1882 sur wikisource * Gaston Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, en ligne sur Gallica: 11e édition revue 1912Poèmes scandinavesXavier Marmier, Chants populaires de Nord (Islande, Danemark, Suède, Norvège, Feroe, Finlande), Paris, Charpentier, 1842 * La Saga des Nibelungen dans les Eddas, traduction précédée d’une étude sur la formation des épopées nationales, par E. de Laveleye, Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verbrœckhoven et Cie, 1866, texte sur Gallica * J.- J. Ampère, Littérature et Voyages, Allemagne et Scandinavie, Paris, Poulin, 1833 * A.-F. Ozanam, Les Germains avant le Christianisme, Paris, Lecoffre, 1847. œuvres complètes, tome 3, édition 3, 1861, sur Gallica. * Xavier Marmier, Lettres sur l’Islande, Paris, Bonnaire, 1837Poèmes finnoisLéouzon Le Duc, La Finlande, son histoire primitive, sa mythologie, sa poésie épique, avec la traduction complète de sa grande épopée le Kalewala, son génie national, sa condition politique et sociale depuis la conquête russe, 2 vol., Paris, Labitte, 1845 * Xavier Marmier, De la poésie finlandaise, Revue des deux Mondes, 1er octobre 1842, texte en ligne sur wikisourcePoèmes celtiquesVicomte Théodore Hersart de La Villemarqué, Poèmes des bardes bretons du VIe siècle traduits pour la première fois avec le texte en regard revu sur les plus anciens manuscrits, Paris, Renouard, 1850 * Robert Burns, Poésies complètes, traduites de l’écossais par M. Léon de Wailly, Paris, Delahays, 1843Poèmes espagnolsM. de Marlès, Histoire de la domination des Arabes en Espagne et en Portugal, rédigée sur l’Histoire traduite de l’arabe en espagnol par M. Joseph Condé, 3 vol., Paris, Alexis Eymery, 1825. Texte en ligne sur Gallica: tome 1er, tome 2, tome 3 * Louis Viardot, Essai sur les Arabes d’Espagne, 2 vol., Paris, 1833 * Damas-Hinard, Romancero général, ou Recueil des Chants populaires de l’Espagne, traduction complète, Paris, Charpentier, 1844Poèmes sur le nouveau mondeJ.-A. Moerenhout, Voyages aux îles du Grand Océan, 2 vol., Paris, Arthus Bertrand, 1837 * Armand de Quatrefages, Les Polynésiens et leurs migrations, Revue des deux Mondes, 1er et 15 février 1864 * Goussin, Du dialecte de Tahiti, de celui des îles Marquises, et, en général, de la langue polynésienne, Paris, Didot, 1863 * Abbé Em. Domenech, Voyage pittoresque dans les Grands Déserts du Nouveau Monde, Paris, Morizot, s.d. (1860 ?) Leconte de Lisle et l’Académie française * Leconte de Lisle se porta deux fois candidat à l’Académie française. La première fois, en 1877, il n’obtint que deux voix, dont celle de Victor Hugo. Il se représenta à la succession de Victor Hugo en 1885, fut élu le 11 février 1886 et reçu sous la coupole en le 31 mars 1887 par Alexandre Dumas fils. La boîte déroulante ci-dessous donne le détail des scrutins qui l’ont concerné. Musique inspirée par des poèmes de Leconte de Lisle * Trois compositions ont été évoquées plus haut au titre du théâtre de Leconte de Lisle: * Ernest Chausson, Hélène, drame lyrique, en deux actes (op. 7, 1883-4). * Jules Massenet, Les Érinnyes,. Partition en ligne pour chant et piano * Franz Servais, L’Apollonide (Iõn) Partition en ligne pour chant et pianoUne œuvre orchestrale a été inspirée par un poème de Leconte de Lisle: * César Franck, Les Éolides, inspiré par le poème Les Éolides.Par ailleurs, de nombreux musiciens ont écrit des mélodies sur des poèmes de Leconte de Lisle, parmi lesquels: Tableau inspiré par des poèmes de Leconte de Lisle * Paul Gauguin a intitulé un tableau Poèmes barbares. Il l’a peint en 1896 lors de son second séjour en Polynésie, sous l’influence de la lecture du recueil de 1862 de Leconte de Lisle. Le tableau est exposé aux Harvard Art Museums à Cambridge (Massachusetts). Il représente une Polynésienne dont la posture combine des gestes chrétiens et bouddhistes, ainsi qu’un animal identifié à Ta’aroa, le dieu tahitien créateur de l’univers. Éditions illustrées de Leconte de Lisle * Dans la liste suivante, les noms des illustrateurs figurent en gras. * Poésies complètes * Maurice de Becque, Paris, édition Lemerre en quatre tomes, 1927-1928, (voir plus haut). Tirage total 540 exemplaires (325 ex. num. sur vergé Lafuma, 125 Hollande Van Gelder, 10 Chine, 25 Japon, 15 Madagascar, 40 H.C.). * Poèmes antiques * Maurice Ray, Paris, Société des Amis des Livres, 1908 ; 30 eaux-fortes originales en noir dans le texte de Maurice Ray, gravées par Louis Muller, dont un frontispice ; grand in-8 en ff., imprimé par Draeger par les soins de R. Claude-Lafontaine, emboîtage d’éditeur. Tirage 110 ex. sur vélin. * Poèmes barbares * Léon Carré, Paris, imprimé pour Jean Borderel, 1911 ; vingt poèmes, 25 eaux-fortes originales, dont un frontispice et 24 vignettes in-texte, serpentes. In-4. Tirage 10 ex. sur vergé, H.C. * Raphaël Freida, Paris, Éditions A. Romagnol, 1914 ; 99 eaux-fortes originales dont 18 en pleine page gravées par Edmond Pennequin et imprimées en taille-douce par A. Porcabeuf. Tirage limité à 301 exemplaires numérotés. In-4 (19 x 28,5 cm), 426 pages. * Philippe Labèque, gravures originales sur cuivre, sans lieu, Aux dépens de soixante-dix-sept bibliophiles, sans date. In-Folio, couv. rempliée, sous chemise et cartonnage, 77 exemplaires sur Grand Vélin de Rives. * Maurice de Becque, Six Poèmes barbares illustrés de douze eaux-fortes dont six hors-texte, gravées en couleur au repérage, Paris, chez Maurice de Becque, 1925. * Paul Jouve, Lausanne, Gonin, 1929 ; 30 compositions, en noir et en couleurs, gravées sur bois par Perrichon: 1 vignette de titre, 2 sur double page, 10 à pleine page, 17 in-texte. Tirage limité à 119 exemplaires * Odette Denis, Le Livre De Plantin, Paris 1948, in 4° en feuilles, 26 eaux fortes originales d’Odette Denis. Tirage limité à 205 exemplaires. * Maurice de Becque, Six poèmes barbares, édition ornée de douze eaux-fortes, dont six hors-texte, gravées en couleurs au repérage par Maurice de Becque. Album grand in-4° en feuillets, couverture rempliée illustrée, chez Maurice de Becque, 1925. Tirage limité à 220 exemplaires. * V. M. Vincent, Les Elfes, un vol. grand in-8°, br., 12 ff, Bordeaux, imprimerie René Samie, 1935. * Poèmes tragiques. * Hugues de Jouvancourt, Pantouns malais avec cinq eaux-fortes et six ornements, in-folio, Genève, Pierre Cailler, 1946. * Les Idylles de Théocrite * René Ménard et Jacques Beltrand, 25 gravures sur bois originales dont un frontispice de Ménard, 19 en têtes en couleurs, une vignette, un cul de lampe et 3 en têtes et bordures de Beltrand. Paris, Société du Livre d’art, 1911. In 4°, broché, sous chemise et étui. Tirage à 135 exemplaires. * Raphael Drouart, Paris, Gaston Boutitie, 1920. 92 bois originaux N/B (dans le texte, en front-de-chapitre, en culs-de-lampe et en hors-texte), in 4°, 204 pages, en feuillets, sous chemise, 23,5x28,5 cm. Tirage total 320 exemplaires (225 ex. num. sur vergé teinté d’Arches, 25 Whatman, 50 autres vergé d’Arches, 20 H.C.). * Les Érinnyes * François Kupka, Paris, Librairie de la Collection des Dix, A. Romagnol éditeur, 1908 ; grand in-8°, 35 compositions de François Kupka, dont 25 eaux-fortes originales (3 hors-texte et 22 à mi-page formant en-têtes de chapitres) et 10 gravées sur bois par E. Gaspé (8 culs-de-lampe et 2 titres) ; texte dans un encadrement. Tirage total à 301 exemplaires. * Auguste Leroux, Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1912 ; petit in folio 270 x 210 mm, 7 ff., 78 pages, 3 ff. ; illustré de 3 eaux-fortes hors texte et de 40 bandeaux gravés sur bois dans le texte en couleurs. Tirage à 150 exemplaires sur papier du Japon sous la direction de Charles Meunier, 125 réservés aux Membres de la Société. * A. Bouchet, Paris, Édouard-Joseph, 1920. Coll. Petites curiosités littéraires. Bois dessinés et gravés par A. Bouchet. Tirage total à 1000 exemplaires. * Odes Anacréontiques * André Derain, Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1953, illustré de 50 lithographies originales en noir, dans et hors texte par André Derain, 1 vol. grand in-8° en feuilles sous couverture rempliée, chemise cartonnée, dos parchemin, et boîte cartonnée, 81 p. + tables + liste des sociétaires. Imprimé par Fequet et Baudier. Tirage 200 exemplaires numérotés, sur vélin B.F.K. de Rives. * Homère, Iliade * Jo Moller (ch. 1 à 4), Remo Giatti (ch. 5 à 8), Eric Massholder (ch. 9 à 13), Paso (ch. 13 à 16), Toos van Holstein (ch. 17 à 20), Alain Lestié (ch. 20 à 24 et 26): La Diane Française, 2012. * Homère, Odyssée * Georges Rochegrosse, Paris, A. Ferroud– F. Ferroud, successeur, 1931, 304 p. Illustration: 25 hors-texte gravés à l’eau-forte par Eugène Decisy et 72 vignettes, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois en couleurs par P. Baudier, Ch. Clément, Gaspérini et P. Gusman. Tirage total 501 exemplaires numérotés (1 ex. sur papier de Hollande, 100 ex. sur grand japon impérial, 400 ex. sur vélin d’Arches). * Homère, Nausikaa, sixième rhapsodie de l’Odyssée * Gaston de Latenay, Paris, Piazza, 1899, in-4°, br., couv. rempliée ill. en couleurs, 54 p., 53 compositions coloriées au pochoir par E. Greningaire et gravées par Ruckert. Tirage 400 ex. * Pièces réunionnaises. * Hugues de Jouvancourt, Québec, Éditions la Frégate, 1994 ; in-4°, 66 p. + les illustrations, en feuillets, sous couverture imprimée rempliée, emboîtage. Ouvrage édité pour le centenaire de la mort du poète. Tirage 100 exemplaires. Traductions en langues étrangères d’œuvres de Leconte de Lisle * « Pour les traductions en langue allemande, voir Fromm, Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französisch zwischen 1700 und 1948. Qaïn a été traduit en tchèque dès 1880 (Prague, Otto). Deux traductions des Érinnyes ont été publiées, en espagnol par la revue de Buenos Ayres Nosotros, et en russe par Lozinskij (1922). Un recueil de morceaux choisis, traduits en russe par Igor Postupalskij et commentés par N. Balachov, a été publié à Moscou en 1960. En Italie, des morceaux choisis de Vigny et de Leconte de Lisle ont été publiés à Milan en 1945, traduits par Filippo Ampola (Éditeur: Garzanti). » (Edgard Pich, Leconte de Lisle et sa création poétique, 1975, p. 535). Dédicaces à Leconte de Lisle * Auguste Lacaussade, poème Le Cap Bernard du recueil Poèmes et paysages, 1852 ; * Léon Dierx, Poèmes et Poésies, 1861: « À mon cher et vénéré Maître Leconte de Lisle » ; * Albert Glatigny, Les Flèches d’or, 1864: « À M. Leconte de Lisle » ; * François Coppée, Le Reliquaire, 1866: « À mon cher Maître / Leconte de Lisle / Je dédie mes premiers vers. » ; * Armand Silvestre, Le Doute, 1870, texte sur wikisource ; * Catulle Mendès, Hespérus, 1872: « À Leconte de Lisle » ; * Anatole France, Les Poèmes dorés, 1873: « À / Leconte de Lisle / auteur des poèmes antiques / et des poèmes barbares / en témoignage / d’une vive et constante / admiration / ce livre est dédié » ; * Judith Gautier, La Sœur du Soleil, 1887 ; texte sur wikisource ; * José-Maria de Heredia, Les Trophées, 1893: « À Leconte de Lisle » ; * Edmond Haraucourt, Les Âges: L’Espoir du Monde, 1894 ; * Jean Dornis, La Voie douloureuse, Calmann Lévy, 1894. * Pierre Louÿs, Pour la stèle de Leconte de Lisle, poème (date ?) Attribution du nom de Leconte de Lisle * Portent le nom de Leconte de Lisle: * un lycée prestigieux de Saint-Denis de La Réunion, le lycée Leconte-de-Lisle ; mais aussi à La Réunion un collège à Saint-Louis, trois écoles primaires à Saint-André, Saint-Paul et Saint-Pierre ; * la médiathèque de Saint-Paul de la Réunion ; la salle de spectacles Lespas Leconte de Lisle, toujours à Saint-Paul ; * un paquebot, le Leconte-de-Lisle (1922-1956). Se reporter à la section #Liens externes pour consulter le site qui lui est consacré ; * un ITEP dans la Haute-Saône, l’ITEP Leconte de Lisle ; * des voies (rues, avenues, squares, impasses, boulevards, promenades, villa, etc.): * en métropole: Bergerac, Dinan, Louveciennes, Mennecy, Ozoir-la-Ferrière, Paris XVIe, Rennes, Saint-Gaudens, Saint-Lubin-des-Joncherets ; * à La Réunion: Bras-Panon, Cilaos, Le Port, Saint-Benoît, Saint-Denis (une place), Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Clotilde. Liens externes * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque nationale de Pologne • Bibliothèque nationale d’Israël • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • WorldCat * Ressources relatives à la littérature: Académie française (membres) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren • Internet Speculative Fiction Database • LibriVox • Online Books Page • Representative Poetry Online • Les Voix de la poésie * (fr) Sur la page de recherche de la BNF, tapez « Leconte de Lisle » pour accéder à des photographies: Leconte de Lisle, sa femme, sa maison natale, etc. * (fr) Généalogie de Leconte de Lisle sur le site geneanet samlap. * (fr) Pavillon de Voisins où Leconte de Lisle mourut, vu du ciel. * (fr) Adolphe Racot, Portraits d’aujourd’hui, 1887: voir texte, p. 113-124, sur Gallica. * (fr) Le paquebot « Leconte-de-Lisle ». * (fr) Le Jardin des dieux, émission radiophonique de François-Xavier Szymczak, France Musique, 17 février 2013, comprenant des œuvres musicales sur des poèmes de Leconte de Lisle, notamment: Lydia de Gabriel Fauré, Les Éolides de César Franck ; Études latines de Reynaldo Hahn ; Phydilé de Henri Duparc ; etc. * (fr) Vincent Dubois, la Compagnie des Indes Orientales, chapitre 12: Un écrivain réunionnais célèbre: Leconte de Lisle * (ru) Site russe signalant une édition des poèmes de Leconte de Lisle traduits en langue russe, en quatre volumes (2016), avec la traduction de plusieurs d’entre eux (Hypatie, etc.), (ISBN 978 5 91763 282 7) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Leconte_de_Lisle


Germain Marie Bernard Nouveau, né le 31 juillet 1851 à Pourrières (Var) où il est mort le 4 avril 1920, est un poète français. Biographie Germain Nouveau est l’aîné des quatre enfants de Félicien Nouveau (1826-1864) et de Marie Augustine Silvy (1832-1858). Germain Nouveau perd sa mère alors qu’il n’a que sept ans et est élevé par son grand-père. Après une enfance à Aix-en-Provence et des études qu’il effectue au petit séminaire, pensant même à embrasser la prêtrise, et après une année d’enseignement au lycée Thiers de Marseille en 1871-1872, Nouveau s’installe à Paris à l’automne 1872. Il publie son premier poème, Sonnet d’été, dans La Renaissance littéraire et artistique, revue d’Émile Blémont et fait connaissance de Mallarmé, de Jean Richepin et les « Vivants » (Ponchon…) qui se réunissent au café Tabourey. Il fréquente aussi les zutistes, fait la connaissance de Charles Cros avec lequel il collabore à la rédaction des Dixains réalistes qui tournent en dérision les parnassiens. Il découvre dans l’Album zutique les poèmes laissés par Rimbaud et Verlaine, qui ont quitté la capitale depuis juillet 1872. Fin 1873, il rencontre Arthur Rimbaud au café Tabourey et, en mars 1874, ils partent ensemble en Angleterre pour s’installer à Londres, au 178 Stamford Street. Nouveau aide Rimbaud à la copie des Illuminations mais revient seul à Paris en juin de la même année. Cette version est désormais contestée, la possibilité étant que Nouveau soit l’auteur des Illuminations et Rimbaud partiellement son copiste,. A tout le moins les Illuminations pourraient être un recueil à quatre mains, chacun des deux poètes ayant apporté sa contribution à ce projet d’écriture collective, parfois au sein d’un même poème. Nouveau voyage ensuite en Belgique et aux Pays-Bas. En 1875, à Bruxelles, il reçoit de Verlaine le manuscrit des Illuminations que Rimbaud, croisé à Stuttgart, a adressé à Nouveau afin de le faire publier. Nouveau retourne à Londres où il fait la connaissance de Verlaine avec lequel il restera longtemps ami. En 1878, il entre au ministère de l’Instruction publique, collabore au Gaulois, où il se lie d’amitié avec Camille de Sainte-Croix, et au Figaro, sous le pseudonyme de Jean de Noves, avant de reprendre des voyages en 1883 qui le mèneront notamment à Beyrouth. En 1883-1884, il enseigne le français et le dessin au collège de la Charité fraternelle à Aramoun (dans la montagne libanaise), fondé par le père Chbat ; ayant séduit la mère d’un collégien, il est renvoyé par la direction ; il rentre alors au pays, rapatrié à sa demande par le consulat de France, et publie ses Sonnets du Liban dans le Chat noir et le Monde moderne. Devenu professeur de dessin au collège Bourgoin dans l’Isère, puis au lycée Janson de Sailly, à Paris, il est frappé, en plein cours, d’une crise de folie mystique en 1891. Il doit être interné à l’hôpital Bicêtre d’où il sort après quelques mois d’enfermement. Il traverse plusieurs crises mystiques proches de l’aliénation et entreprend une vie de mendiant et de pèlerin, s’inspirant de saint Benoît Labre. Après des années d’errance, dont deux pèlerinages à Rome et un à Saint-Jacques de Compostelle, il revient dans son village natal en 1911 et y meurt d’un jeûne trop prolongé entre le Vendredi saint et Pâques 1920. Ses poésies seront essentiellement publiées après sa mort, Nouveau s’y étant opposé de son vivant, allant jusqu’à faire un procès lors de la publication de son recueil Savoir aimer, la première version de sa Doctrine de l’Amour. Il eut une grande influence sur les surréalistes et Aragon le considérait « non un poète mineur mais un grand poète. Non un épigone de Rimbaud : son égal. » Dans le roman de Léonce de Larmandie, Floréal (1900), Germain Nouveau apparaît sous les traits d’un peintre-poète du nom de Jean Germain, répétiteur dans une famille de banquiers juifs fortunés de Paris, qui s’éprend d’un amour impossible pour Aimée de Chantenay. C’est ce même Léonce de Larmandie qui fera publier, contre la volonté de l’auteur, deux éditions de poèmes sous le pseudonyme d’Humilis : Savoir aimer en 1904 (sous les auspices de la Société des Poètes français) et en 1910 Les Poèmes d’Humilis (avec des reproductions de dessins d’Auguste Rodin). Hommage La commune de Pourrières lui rend hommage en baptisant une de ses rues « rue Germain Nouveau » et une autre « rue Humilis » (angle de sa dernière demeure). Ses noms de plume P. Néouvielle (1872-1873) Duc de la Mésopotamie (1878) Largillière ou Largellière (?) Jean de Noves / Jean de la Noce (?) Gardéniac (?) Sansay (?) Bernard Marie / Bernard-Marie B.-M. Nouveau François Bernard François La Guerrière La Guerrière / Laguerrière / Guerrière Le Guerrier J.-Germain Nouveau (1910) Imbert Dupuis (1910) Bénédict J.-G.-N. Nom de plume douteux G.-N. Humilis : utilisé par Larmandie pour la publication de Savoir aimer mais il n’est pas prouvé que Nouveau lui-même en ait fait usage. Poison perdu En 1895, Verlaine publie les Œuvres complètes d’Arthur Rimbaud dans lesquelles il intègre le poème Poison perdu. L’attribution de ce sonnet qui a pu être faite à Germain Nouveau est d’autant plus discutable que Poison perdu recèle, dans l’agencement de ses rimes, un certain nombre de faiblesses que l’on n’a jamais trouvées chez Nouveau. Œuvres * Œuvres poétiquesSa production essentielle n’a été publiée qu’après sa mort. Les éditeurs la divisent en : * Premiers vers (1872-1878) * Dixains réalistes * Notes parisiennes * La Doctrine de l’amour * Sonnets du Liban * Valentines * Ave Maris Stella * Derniers vers (1885–1918)ÉditionsG.-N. Humilis, Savoir Aimer, publié par les amis de l’auteur, sous les auspices de la Société des poètes français, Paris, 1904 * Les poèmes d’Humilis, enrichis de quatre compositions inédites d’Auguste Rodin, collection de “ La Poétique ”, Paris, 1910 * Ave Maris Stella, Aix, Librairie des Quatre Dauphins, 1912 * Valentines et autres vers, préface de Ernest Delahaye, Paris, Albert Messein, éditeur, 1922 * Poésies d’Humilis et vers inédits, préface de Ernest Delahaye, Paris, Albert Messein, éditeur, 1924 * Le Maron travesti ou la quatrième églogue de Virgile mise en vers burlesques par Monsieur La Guerrière, Paris, Messein, MCMIII (1935 ou 1936) * Le calepin du mendiant précédé d’autres poèmes (vers inédits), introduction, biographie et notes par Jules Mouquet, beaux textes, textes rares, textes inédits, Genève, Pierre Cailler éditeur, 1949 * Œuvres poétiques, édition de Jacques Brenner et Jules Mouquet, Gallimard, 2 vol., 1953-1955 * Sonnets du Liban, Zurich, Handpresse am Predigerplatz, 1956 * La doctrine de l’amour, Paris, Les bibliophiles franco-suisses (pour la société Le Livre contemporain), 1966, eaux-fortes de Henri Landier * Œuvres complètes, jointes à celles de Lautréamont, édition de Pierre-Olivier Walzer, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1970 (ISBN 2070103048). * La Doctrine de l’amour, Valentines, Dixains réalistes, Sonnets du Liban, édition de Louis Forestier, Poésie/Gallimard, 1981 (ISBN 207032205X) * L’Amour de l’amour, choix et présentation de Jacques Brenner, Éditions Orphée/Éditions de la Différence, 1992 (ISBN 2-7291-0767-3) * Germain Nouveau, quelques premiers vers, édition de la Société de Découragement de l’Escrime, Bruxelles-Liège, 2009 * Germain Nouveau, Saber amar, edicion y traduccion Pedro J. Vizoso, arKadia, 2015 (ISBN 978-0692260364) * Germain Nouveau, Tout fait l’amour, anthologie poétique, préface de Jacques Lovichi, Peigneurs de comètes, collection “ les admirables ”, 2015 * Germain Nouveau, Proses et Vers, les cahiers de curiosités, éditions marguerite waknine, 2017Sur Germain NouveauAlbert Lopez, La vie étrange d’Humilis (Germain Nouveau), Bruges, éditions Ch. Beyaert, s. d. (1928) * Léon Vérane, Humilis, poète errant, Paris, Bernard Grasset, 1929 * Louis Forestier, Germain Nouveau, Poètes d’aujourd’hui n°203, 172 pages, Paris, Seghers, 1971 * Michael Pakenham, Germain Nouveau, Pages complémentaires, University of Exeter, 1983 * Alexandre Amprimoz, Germain Nouveau dit Humilis : étude biographique, Chapel Hill, UNC, Department of romance languages, North Carolina studies in the romance languages and litteratures, 220, 1983 (ISBN 0-8078-9224-6) * Alexandre Amprimoz, La Poésie érotique de Germain Nouveau : une lecture des Valentines, Saratoga, California, Anma Libri, Stanford French and Italian Studies 28, 1983 (ISBN 0-915838-09-5) * Alexandre Amprimoz, À l’ombre de Rimbaud : le Germain Nouveau d’avant La Doctrine de l’amour, Saratoga, California, Anma LIbri, Stanford French and Italian studies 43, 1986 (ISBN 0-915838-58-3) * Maïté Dabadie, L’écharde dans la chair ou la vie du poète Germain Nouveau, Humilis, Marseille, P. Tacussel, 1986 (ISBN 2-903-963-21-5) * Alexandre Amprimoz, L’Inspiration religieuse des Symbolistes : le cas de la Doctrine de l’amour de Germain Nouveau, Saratoga, California, Anma Libri, 1989 (ISBN 0-915838-76-1) * François Proïa, Les Routes initiatiques de Germain Nouveau, Napoli, ed. Scientifiche Italiane, Lutetia 8, 2001 (ISBN 88-495-0260-5) * Jacques Lovichi, Germain Nouveau, précurseur du surréalisme ?, Marseille, éditions Autres Temps, Autre Sud-documents, 2005 (ISBN 2-84521-201-1) * Cahiers Germain Nouveau no 1 (2008), no 2 (2009), no 3 (2011) et n° 4 (2018) (ISSN 1964-9908) * Germain Nouveau : sur les traces du poète de Pourrières au Liban, revue Art matin n°7, Éditions Plaine Page, 2013 (ISSN 2118-0121) * Eddie Breuil, Du Nouveau chez Rimbaud, collection Champion Essais n°43, 2014 (ISBN 978-2-7453-2889-2) Liens externes * Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque nationale d’Israël • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Suède • Bibliothèque apostolique vaticane • WorldCat * Ressources relatives aux beaux-arts : AGORHA • Bénézit • Musée d’Orsay • Union List of Artist Names * Valentines et autres vers (251 pages) (Gallica) * Poésies d’Humilis et vers inédits (174 pages) (Gallica) * Poésies de Germain Nouveau (Les Grands Classiques) * Poésies de Germain Nouveau (Paradis des Albatros) Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_Nouveau

Évariste Désiré de Forges, chevalier puis vicomte de Parny, est un poète français né le 6 février 1753 à Saint-Paul de l’île Bourbon (actuelle île de La Réunion), et mort le 5 décembre 1814 à Paris. Biographie Issu d’une famille originaire du Berry, installée en 1698 à l’île Bourbon, Évariste de Parny est né en 1753 à L’Hermitage de Saint-PaulIl quitte son île natale à l’âge de neuf ans pour venir en France métropolitaine avec ses deux frères, Jean-Baptiste et Chériseuil. Il fait ses études au collège Saint-Thomas de Rennes. D’après l’historien Prosper Ève, « une tradition développée par ses ennemis veut qu’à dix-sept ans, il a envisagé d’embrasser la carrière ecclésiastique et est entré au séminaire de Saint-Firmin avec l’intention ferme de s’enfermer au couvent de La Trappe ». En fait, il a déjà « perdu une foi qui n’a d’ailleurs jamais été trop vive ». La thèse de Catriona Seth montre que les archives confirment le séjour du futur écrivain à Saint-Firmin. Il part officiellement pour cause de maladie mais il s’agit peut-être d’une maladie diplomatique... En définitive, Parny choisit une carrière militaire, celle de ses frères et de son père, après avoir estimé qu’il avait trop peu de religion pour prendre l’habit, le christianisme le séduisant avant tout par les images de la Bible. Son frère Jean-Baptiste, écuyer du comte d’Artois, l’introduit à la cour de Versailles où il fait la connaissance de deux autres militaires qui, comme lui, se feront un nom dans la poésie: Antoine Bertin, originaire comme lui de l’île Bourbon, et de Nicolas-Germain Léonard, qui était, lui, originaire de la Guadeloupe. En 1772, il est capitaine d’une compagnie de gendarmes du Roi. En 1773, son père le rappelle à l’île Bourbon, où il revient âgé. Durant ce séjour, le jeune homme de vingt ans découvre ses dispositions poétiques et tombe passionnément amoureux d’une jeune personne, Esther Lelièvre, que son père l’empêche d’épouser. S’ennuyant de Paris, il retourne en France métropolitaine en 1775 après avoir indiqué dans une lettre à Bertin qu’il ne saurait se plaire dans un pays où se pratique l’esclavage, contre lequel il s’élève. Peu après son départ, la jeune fille dont il s’est épris est mariée à un médecin. Cette histoire inspire au jeune homme les Poésies érotiques, publiées en 1778, où Esther apparaît sous le nom d’Éléonore. Le recueil a d’emblée un grand succès et apporte la célébrité à son auteur. En 1777, il rédige l’Epitre aux insurgents de Boston pour manifester sa solidarité avec les insurgés de la Boston Tea Party, qui réclament la liberté. Selon Prosper Éve, « cet amour de la liberté lui vient certainement de la lecture des philosophes, mais il n’a pu naître et croître que par le spectacle des outrances de la société bourbonnaise ». Le 6 novembre 1779, Parny est nommé capitaine au régiment des dragons de la Reine. En 1783, il revient à l’île Bourbon pour régler la succession de son père et voyage également à l’Île-de-France. En 1785, il quitte l’île Bourbon pour Pondichéry pour suivre, en qualité d’aide de camp, le gouverneur général des possessions françaises dans les Indes. Il ne se plait pas du tout en Inde mais y recueille une part de la matière de ses Chansons madécasses, parmi les premiers poèmes en prose en langue française. Il ne tarde pas à revenir en France pour quitter l’état militaire et s’installer en 1786 dans la maison qu’il possède dans le vallon de Feuillancourt, entre Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi, qu’on appelle la Caserne. Avec Bertin et Léonard, il forme la « société de la caserne », qui a coutume de s’y réunir. Lorsqu’éclate la Révolution française, Parny, qui ne reçoit aucune pension du Roi et qui ne s’intéresse pas particulièrement à la politique, ne se sent pas véritablement concerné. Mais il doit solder les dettes laissées par son frère Jean-Baptiste et, en 1795, les remboursements en assignats le ruinent presque complètement. Il obtient une place dans les bureaux du ministère de l’Intérieur où il reste treize mois, puis à l’administration du théâtre des Arts. En 1804, le comte Français de Nantes le fait entrer dans l’administration des droits réunis. En 1802, Parny se marie avec Marie-Françoise Vally et, l’année suivante, il est reçu à l’Académie française, où il occupe le 36e fauteuil. En 1813, Napoléon Ier lui accorde une pension de 3 000 francs, mais celle-ci lui est supprimée sous la Restauration en 1814. Il meurt le 5 décembre 1814 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (11e division). À cette occasion Pierre-Jean de Béranger écrit une chanson en son hommage, pour laquelle Wilhem compose la musique. Œuvres * La poésie de Parny a été extrêmement populaire au début du XIXe siècle. « Je savais par cœur les élégies du chevalier de Parny, et je les sais encore », écrit ainsi Chateaubriand en 1813. * Le grand écrivain russe Pouchkine, qui écrivit également de la poésie érotique, avait Parny en grande estime et disait de lui: « Parny, c’est mon maître ». * Parny s’est fait connaître par ses Poésies érotiques (1778) qui apportent un peu de fraîcheur dans la poésie académique du XVIIIe siècle. Il reste aussi par ses Chansons madécasses (1787), où il dit traduire des chansons de Madagascar, et qu’on s’entend pour considérer comme le premier essai de poèmes en prose en langue française. Elles ont été illustrées par Jean Émile Laboureur (1920) . Certaines ont été mises en musique: par Maurice Ravel (Chansons madécasses, 1925) et par Zoé De La Rue (Romance: “C’en est fait, j’ai cessé”). * Voyage de Bourgogne, en vers et en prose, avec Antoine Bertin, 1777. * Épître aux insurgents de Boston, 1777. * Poésies érotiques, 1778. * Opuscules poétiques, 1779. * Élégies, 1784. * Chansons madécasses, 1787. * La Guerre des Dieux, poème en 10 chants, 1799: poème condamné par un arrêt du 27 juin 1827 mais qui a souvent été réimprimé clandestinement. * Goddam!, poème en 4 chants, 1804. * Le Portefeuille Volé, 1805, contenant: Les Déguisements de Vénus, Les Galanteries de la Bible, Le Paradis perdu (poème en 4 chants). * Le Voyage de Céline, poème, 1806. * Réflexion amoureuse. Recueil: Poésies érotiques (1778) http://www.poesie-francaise.fr/evariste-de-parny/poeme-reflexion-amoureuse.php Ressources Bibliographie * Par Catriona Seth: * Les poètes créoles du XVIIIe siècle, Paris-Rome, Memini, Bibliographie des écrivains français, 1998, 318 p. * « Le corps d’Eléonore: réflexions sur les Poésies érotiques du chevalier de Parny » in Roman no 25 (1988). * « Chateaubriand et Parny » in Bulletin de la Société Chateaubriand (1989). * « Ginguené et Parny » in Ginguené (1748– 1816), idéologue et médiateur, textes réunis par Edouard Guitton, Rennes, P.U.R., 1995. * « Parny revisité: les lettres de l’abbé du Chatelier à Rosette Pinczon du Sel, un fonds breton inédit » in Cahiers Roucher– André Chénier no 16 (1997). * « Entre autobiographie et roman en vers: les Poésies érotiques » in Autobiographie et fiction romanesque autour des « Confessions », Actes du Colloque de Nice réunis par Jacques Domenech, Nice, Presses universitaires, 1997. * « L’éloge des infidèles chez Parny », in Poétesses et égéries poétiques (1750– 1820), Cahiers Roucher-André Chénier no 17 (1998). * « Les Chansons madécasses de Parny: une poésie des origines aux origines du poème en prose » in Aux origines du poème en prose: la prose poétique, sous la direction de Nathalie Vincent-Munnia, Paris, Champion, 2003, p. 448-457. * « Parny et l’Instruction Publique » in La République directoriale, sous la direction de Philippe Bourdin et Bernard Gainot, Clermont-Ferrand, 1998. * « Un opéra politiquement correct sous le Directoire: L’Alceste de l’an V », Tragédies tardives, p. p. P. Frantz et F. Jacob, Paris, Champion, 2002, p. 169-177. * « Le réseau Parny », Réseaux et sociabilités littéraires en Révolution, sous la direction de Philippe Bourdin et de Jean-Luc Chappey, Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, 2007, p. 127-141. Articles connexes * Familles subsistantes de la noblesse française Liens externes * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Suède • Bibliothèque apostolique vaticane • Base de bibliothèque norvégienne • WorldCat * Ressources relatives à la littérature: Académie française (membres) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes * « Évariste de Parny: éléments biographiques et bibliographiques », site Internet de l’Académie de La Réunion. * « Évariste Parny (1753– 1814) », Journal de l’île de La Réunion, avant le 1er janvier 2005. * « Sa généalogie », GeneaNet. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_de_Parny

François Marie Robert-Dutertre (3 juin 1815, Ernée– 15 août 1898) est un écrivain, homme politique libre-penseur français. Biographie Il étudia le droit. Il fut pendant les 17 dernières années de sa vie adjoint d’Ernée .Il a publié, outre une série d’articles dans divers périodiques, différents ouvrages. (voir ci-dessous) Publications Chants composés pour l’orphéon d’Ernée, Fougères, Douchin, s.d., in-8, 14 p. ; Principes généraux d’agriculture, Mayenne, Derenne, 1861, in-8, 59 p. ; Notice sur... le Comice agricole d’Ernée, Mayenne, Derenne, 1862, in-8, 32 p. ; M. le Progrès et Mme la Routine, scénario, mêlé de chants, Mayenne, Derenne, 1864, in-8, 24 p. ; Ensemencements et labours ; Notice sur... comice agricole d’Ernée, Mayenne, Derenne, 1866, in-8, 22 p. ; Loisirs lyriques, Paris, 1866 ; Les angoisses d’un mari sexagénaire, comédie, 1 acte en vers, Laval, Moreau, 1866, in-12, 42 p. ; Les campagnes de Crimée, poème, Laval, Lenormand, 1866, in-8, 12 p. Histoire d’un grain de blé, Laval, Bonnieux, 1875, in-12, 159 p. ; La bonne agriculture rationnellement démontrée, Paris, Marie Blanc, 1877, in-12, 29 p. ; Eloge de Voltaire, poésies, Paris, Marie Blanc, 1877, in-8, 22 p. ; Les bataillons scolaires, poème, Laval, 1884, in-8, 4 p. ; L’article VII et l’instruction des femmes, poème, Laval, imprimerie Jamin, s.d., in 12, 16 p. Voir aussi Les grenouilles de bénitier et les crapauds de sacristie. sur le site: Les Athées d’Ille et Vilaine. Source « François-Marie Robert-Dutertre », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne) Portail de la Mayenne Portail de la littérature française Portail de l’agriculture et l’agronomie Portail de la politique française Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/François-Marie_Robert-Dutertre


Cécile Sauvage, « poétesse de la maternité »ne femme de lettres française, née à La Roche-sur-Yon le 20 juillet 1883 et morte le 26 août 1927. Biographie De 1888 à 1907, elle vécut à Digne-les-Bains, dans une maison située avenue de Verdun, où est apposée une plaque qui lui rend hommage. Étudiante au lycée de Digne, elle envoie un manuscrit Les Trois Muses à La Revue forézienne, dont le rédacteur est Pierre Messiaen. Ils échangent une correspondance, puis se marient « Notre mariage eut lieu le 9 septembre 1907, en l’église des Sieyes, près Digne (Basses-Alpes) » . Ils seront les parents d’Alain Messiaen et Olivier Messiaen qu’elle éleva, selon ce dernier, dans un « univers féerique ». Le couple est uni et heureux ; Cécile dédie Primevère à son cher Pierrot, en souvenir de nos fiançailles et de notre mariage. Elle vécut la majeure partie de sa vie à Saint-Étienne[réf. nécessaire], et écrit chaque jour à sa petite table de bois blanc tachée d’encre. Elle découvre les poètes anglais, dont Keats dont le vers La poésie de la terre ne meurt jamais semble être écrit pour illustrer la poésie de Cécile Sauvage. Elle s’installe à Grenoble avec ses fils alors que son époux part au front de la guerre 14/18 ; puis la famille vivra à Paris, qui n’attire pas la poétesse. De santé fragile, elle s’éteint le 26 août 1927, dans les bras de son époux et de ses fils. Son ami Henri Pourrat lui a consacré un ouvrage, La Veillée de novembre.