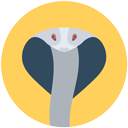Info
Setter, chienne et chiots
Thomas Hewes Hinckley
1843
Private Collection

Antoine Tenant de Latour, né à Saint-Yrieix le 30 août 1808, mort à Sceaux le 27 avril 1881, est un écrivain français. Biographie Fils de l’éditeur et bibliophile Jean-Baptiste Tenant de Latour (1779-1862), Antoine Tenant de Latour devient, après des études à l’École Normale (1826), précepteur du duc de Montpensier (1832) puis son premier secrétaire en 1843. Homme de lettres et poète, il publie abondamment. Amoureux de l’Espagne et de sa littérature, il fit connaître de nombreux auteurs espagnols par ses essais et traductions de Calderón de la Barca, Fernán Caballero, Juan de Mariana, Juan Díaz de Solís, Juan Eugenio Hartzenbusch, Ramón de la Cruz, mais aussi des auteurs italiens comme Silvio Pellico, Vittorio Alfieri, Alessandro Manzoni ou Antonio Astesano (it), Il est reçu le 9 mai 1858 à la Real Academia de Buenas Letras de Séville. Œuvres * Grand ami d’Aloysius Bertrand, il laisse une correspondance avec celui-ci. * Poésies et essayés: * La vie intime (1833) * Poésies complètes (1841) * La baie de Cadix: nouvelles études sur l’Espagne (1858) * L’Espagne religieuse et littéraire, pages détachées (1863) * Etudes litteraires sur l’Espagne contemporaine (1864) * Espagne, traditions, mœurs et littérature (1869) * Tolede et les Bords du Tage– Nouvelles Etudes Sur L’Espagne (1870) * Pèlerinage au pays de Jeanne d’Arc (1875)Traduction: * Mes prisons. Mémoires de Silvio Pellico de Saluces, traduits de l’italien, et précédés d’une introduction biographique, par A. de Latour. Édition ornée du portrait de l’auteur et augmentée de notes historiques par P. Maroncelli, Paris, H. Fournier jeune, 1833. * Des devoirs des hommes. Par Silvio Pellico, traduit de l’italien, avec une introduction, par Antoine de Latour, Paris, Fournier, 1834. * Œuvres dramatiques de Calderon, traduction de M. Antoine De Latour (vol. I e II), 1871. * Œuvres dramatiques de Calderon (II Comédies), 1875. * Don Miguel De Mañara: Sa Vie, Son Discours Sur La Vérité, Son Testament, Sa Profession De Foi, Classic Reprint, 2012. * Mémoires de Victor AlfieriVittorio Alfieri, d’Asti, écrits par lui-même, et traduits de l’italien par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2012. * Sainètes de Ramon de la Cruz, Traduits de l’espagnol et précédés d’une introduction par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2018.Archives: * Paris, Bibliothèque Nationale * Saluces, Archives historique de la Maire Bibliographie * Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen: Index général, De Boeck, 2000, p. 447. Liens internes * Pedro Calderón de la Barca * Silvio Pellico * Vittorio Alfieri * Ramon de la Cruz Liens externes * Sur les liens avec Aloysius Bertrand: [1] * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • Bibliothèque apostolique vaticane • WorldCat Portail de la littérature française Portail de la France au XIXe siècle Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Latour

Évariste Désiré de Forges, chevalier puis vicomte de Parny, est un poète français né le 6 février 1753 à Saint-Paul de l’île Bourbon (actuelle île de La Réunion), et mort le 5 décembre 1814 à Paris. Biographie Issu d’une famille originaire du Berry, installée en 1698 à l’île Bourbon, Évariste de Parny est né en 1753 à L’Hermitage de Saint-PaulIl quitte son île natale à l’âge de neuf ans pour venir en France métropolitaine avec ses deux frères, Jean-Baptiste et Chériseuil. Il fait ses études au collège Saint-Thomas de Rennes. D’après l’historien Prosper Ève, « une tradition développée par ses ennemis veut qu’à dix-sept ans, il a envisagé d’embrasser la carrière ecclésiastique et est entré au séminaire de Saint-Firmin avec l’intention ferme de s’enfermer au couvent de La Trappe ». En fait, il a déjà « perdu une foi qui n’a d’ailleurs jamais été trop vive ». La thèse de Catriona Seth montre que les archives confirment le séjour du futur écrivain à Saint-Firmin. Il part officiellement pour cause de maladie mais il s’agit peut-être d’une maladie diplomatique... En définitive, Parny choisit une carrière militaire, celle de ses frères et de son père, après avoir estimé qu’il avait trop peu de religion pour prendre l’habit, le christianisme le séduisant avant tout par les images de la Bible. Son frère Jean-Baptiste, écuyer du comte d’Artois, l’introduit à la cour de Versailles où il fait la connaissance de deux autres militaires qui, comme lui, se feront un nom dans la poésie: Antoine Bertin, originaire comme lui de l’île Bourbon, et de Nicolas-Germain Léonard, qui était, lui, originaire de la Guadeloupe. En 1772, il est capitaine d’une compagnie de gendarmes du Roi. En 1773, son père le rappelle à l’île Bourbon, où il revient âgé. Durant ce séjour, le jeune homme de vingt ans découvre ses dispositions poétiques et tombe passionnément amoureux d’une jeune personne, Esther Lelièvre, que son père l’empêche d’épouser. S’ennuyant de Paris, il retourne en France métropolitaine en 1775 après avoir indiqué dans une lettre à Bertin qu’il ne saurait se plaire dans un pays où se pratique l’esclavage, contre lequel il s’élève. Peu après son départ, la jeune fille dont il s’est épris est mariée à un médecin. Cette histoire inspire au jeune homme les Poésies érotiques, publiées en 1778, où Esther apparaît sous le nom d’Éléonore. Le recueil a d’emblée un grand succès et apporte la célébrité à son auteur. En 1777, il rédige l’Epitre aux insurgents de Boston pour manifester sa solidarité avec les insurgés de la Boston Tea Party, qui réclament la liberté. Selon Prosper Éve, « cet amour de la liberté lui vient certainement de la lecture des philosophes, mais il n’a pu naître et croître que par le spectacle des outrances de la société bourbonnaise ». Le 6 novembre 1779, Parny est nommé capitaine au régiment des dragons de la Reine. En 1783, il revient à l’île Bourbon pour régler la succession de son père et voyage également à l’Île-de-France. En 1785, il quitte l’île Bourbon pour Pondichéry pour suivre, en qualité d’aide de camp, le gouverneur général des possessions françaises dans les Indes. Il ne se plait pas du tout en Inde mais y recueille une part de la matière de ses Chansons madécasses, parmi les premiers poèmes en prose en langue française. Il ne tarde pas à revenir en France pour quitter l’état militaire et s’installer en 1786 dans la maison qu’il possède dans le vallon de Feuillancourt, entre Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi, qu’on appelle la Caserne. Avec Bertin et Léonard, il forme la « société de la caserne », qui a coutume de s’y réunir. Lorsqu’éclate la Révolution française, Parny, qui ne reçoit aucune pension du Roi et qui ne s’intéresse pas particulièrement à la politique, ne se sent pas véritablement concerné. Mais il doit solder les dettes laissées par son frère Jean-Baptiste et, en 1795, les remboursements en assignats le ruinent presque complètement. Il obtient une place dans les bureaux du ministère de l’Intérieur où il reste treize mois, puis à l’administration du théâtre des Arts. En 1804, le comte Français de Nantes le fait entrer dans l’administration des droits réunis. En 1802, Parny se marie avec Marie-Françoise Vally et, l’année suivante, il est reçu à l’Académie française, où il occupe le 36e fauteuil. En 1813, Napoléon Ier lui accorde une pension de 3 000 francs, mais celle-ci lui est supprimée sous la Restauration en 1814. Il meurt le 5 décembre 1814 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (11e division). À cette occasion Pierre-Jean de Béranger écrit une chanson en son hommage, pour laquelle Wilhem compose la musique. Œuvres * La poésie de Parny a été extrêmement populaire au début du XIXe siècle. « Je savais par cœur les élégies du chevalier de Parny, et je les sais encore », écrit ainsi Chateaubriand en 1813. * Le grand écrivain russe Pouchkine, qui écrivit également de la poésie érotique, avait Parny en grande estime et disait de lui: « Parny, c’est mon maître ». * Parny s’est fait connaître par ses Poésies érotiques (1778) qui apportent un peu de fraîcheur dans la poésie académique du XVIIIe siècle. Il reste aussi par ses Chansons madécasses (1787), où il dit traduire des chansons de Madagascar, et qu’on s’entend pour considérer comme le premier essai de poèmes en prose en langue française. Elles ont été illustrées par Jean Émile Laboureur (1920) . Certaines ont été mises en musique: par Maurice Ravel (Chansons madécasses, 1925) et par Zoé De La Rue (Romance: “C’en est fait, j’ai cessé”). * Voyage de Bourgogne, en vers et en prose, avec Antoine Bertin, 1777. * Épître aux insurgents de Boston, 1777. * Poésies érotiques, 1778. * Opuscules poétiques, 1779. * Élégies, 1784. * Chansons madécasses, 1787. * La Guerre des Dieux, poème en 10 chants, 1799: poème condamné par un arrêt du 27 juin 1827 mais qui a souvent été réimprimé clandestinement. * Goddam!, poème en 4 chants, 1804. * Le Portefeuille Volé, 1805, contenant: Les Déguisements de Vénus, Les Galanteries de la Bible, Le Paradis perdu (poème en 4 chants). * Le Voyage de Céline, poème, 1806. * Réflexion amoureuse. Recueil: Poésies érotiques (1778) http://www.poesie-francaise.fr/evariste-de-parny/poeme-reflexion-amoureuse.php Ressources Bibliographie * Par Catriona Seth: * Les poètes créoles du XVIIIe siècle, Paris-Rome, Memini, Bibliographie des écrivains français, 1998, 318 p. * « Le corps d’Eléonore: réflexions sur les Poésies érotiques du chevalier de Parny » in Roman no 25 (1988). * « Chateaubriand et Parny » in Bulletin de la Société Chateaubriand (1989). * « Ginguené et Parny » in Ginguené (1748– 1816), idéologue et médiateur, textes réunis par Edouard Guitton, Rennes, P.U.R., 1995. * « Parny revisité: les lettres de l’abbé du Chatelier à Rosette Pinczon du Sel, un fonds breton inédit » in Cahiers Roucher– André Chénier no 16 (1997). * « Entre autobiographie et roman en vers: les Poésies érotiques » in Autobiographie et fiction romanesque autour des « Confessions », Actes du Colloque de Nice réunis par Jacques Domenech, Nice, Presses universitaires, 1997. * « L’éloge des infidèles chez Parny », in Poétesses et égéries poétiques (1750– 1820), Cahiers Roucher-André Chénier no 17 (1998). * « Les Chansons madécasses de Parny: une poésie des origines aux origines du poème en prose » in Aux origines du poème en prose: la prose poétique, sous la direction de Nathalie Vincent-Munnia, Paris, Champion, 2003, p. 448-457. * « Parny et l’Instruction Publique » in La République directoriale, sous la direction de Philippe Bourdin et Bernard Gainot, Clermont-Ferrand, 1998. * « Un opéra politiquement correct sous le Directoire: L’Alceste de l’an V », Tragédies tardives, p. p. P. Frantz et F. Jacob, Paris, Champion, 2002, p. 169-177. * « Le réseau Parny », Réseaux et sociabilités littéraires en Révolution, sous la direction de Philippe Bourdin et de Jean-Luc Chappey, Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, 2007, p. 127-141. Articles connexes * Familles subsistantes de la noblesse française Liens externes * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Suède • Bibliothèque apostolique vaticane • Base de bibliothèque norvégienne • WorldCat * Ressources relatives à la littérature: Académie française (membres) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes * « Évariste de Parny: éléments biographiques et bibliographiques », site Internet de l’Académie de La Réunion. * « Évariste Parny (1753– 1814) », Journal de l’île de La Réunion, avant le 1er janvier 2005. * « Sa généalogie », GeneaNet. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_de_Parny


Charles-Augustin Sainte-Beuve est un critique litté, raire et écrivain français, né le 23 décembre 1804 à Boulogne-sur-Mer et mort le 13 octobre 1869 à Paris. La méthode critique de Sainte-Beuve se fonde sur le fait que l’œuvre d’un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et pourrait s’expliquer par elle. Elle se fonde sur la recherche de l’intention poétique de l’auteur (intentionnisme) et sur ses qualités personnelles (biographisme). Cette méthode a été critiquée par la suite. Marcel Proust, dans son essai Contre Sainte-Beuve, est le premier à la contester, reprochant de plus à Sainte-Beuve de négliger, voire condamner de grands auteurs comme Baudelaire, Stendhal ou Balzac. L’école formaliste russe, ainsi que les critiques Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer, suivront Proust dans cette route. Cette opposition entre Sainte-Beuve et Proust peut aussi se comprendre comme un renversement de perspective de la critique littéraire. En effet, il faut reconnaître à Sainte-Beuve une capacité de critique formelle fondée: il l’a montré avec le Salammbô de Flaubert, si bien que Flaubert lui-même en tint compte dans la suite de son œuvre. Seulement, chez lui, cette analyse semble devoir rester subordonnée à la connaissance de la vie de l’auteur, et c’est là que s’opère le renversement proustien: si rapport il y a entre l’œuvre et la vie de son auteur, pour Proust c’est bien la première qui doit apparaître comme la plus riche source d’enseignements sur le sens profond de la seconde. Ce renversement est à la base de la poétique de Proust et s’incarne dans À la recherche du temps perdu. S’il est moins connu du grand public de nos jours, entre 1870 et au moins jusqu’aux années 1950, il est resté longtemps l’une des figures majeures du panthéon littéraire transmis par l’école républicaine, avec Victor Hugo, Montaigne ou Lamartine, et tous les écoliers connaissaient au moins son nom. Biographie Né à Moreuil le 6 novembre 1752, le père de l’auteur, Charles-François Sainte-Beuve, contrôleur principal des droits réunis et conseiller municipal à Boulogne-sur-Mer, se marie le 30 nivôse an XII (21 janvier 1804) avec Augustine Coilliot, fille de Jean-Pierre Coilliot, capitaine de navire, née le 22 novembre 1764. Toutefois, atteint par une angine, il meurt le 12 vendémiaire an XIII (4 octobre 1804). Orphelin de père dès sa naissance le 2 nivôse an XIII (23 décembre 1804) à Boulogne-sur-Mer, Sainte-Beuve est élevé par sa mère et une tante paternelle, veuve également. En 1812, il entre en classe de sixième comme externe libre à l’institution Blériot, à Boulogne-sur-Mer, où il reste jusqu’en 1818. À cette époque, il obtient de poursuivre ses études à Paris. Placé dans l’institution Landry en septembre 1818, il suit comme externe les cours du collège Charlemagne, de la classe de troisième à la première année de rhétorique, puis ceux du collège Bourbon, où il a pour professeur Paul-François Dubois, en seconde année de rhétorique et en philosophie. En 1822, il est lauréat du Concours général, remportant le premier prix de poésie latine. Après l’obtention de son baccalauréat ès lettres, le 18 octobre 1823, il s’inscrit à la faculté de médecine le 3 novembre. Puis, conformément à l’ordonnance du 2 février 1823, qui l’exige pour les professions médicales, il prend des leçons particulières de mathématiques et passe le baccalauréat ès sciences, le 17 juillet 1824. Toutefois, alors qu’il a été nommé en 1826 externe à l’hôpital Saint-Louis avec une chambre, il abandonne ses études de médecine en 1827 pour se consacrer aux lettres. Après un article anonyme paru le 24 octobre 1824, il publie dans Le Globe, journal libéral et doctrinaire fondé par son ancien professeur, Paul-François Dubois, un article signé « Joseph Delorme » le 4 novembre. Le 2 et le 9 janvier 1827, il publie une critique élogieuse des Odes et ballades de Victor Hugo, et les deux hommes se lient d’amitié. Ensemble, ils assistent aux réunions au Cénacle de Charles Nodier à la Bibliothèque de l’Arsenal. Il a une liaison avec l’épouse de Hugo, Adèle Foucher. Le 20 septembre 1830, Sainte-Beuve et l’un des propriétaires du journal Le Globe, Paul-François Dubois, se battent en duel dans les bois de Romainville. Sous la pluie, ils échangent quatre balles sans résultats. Sainte-Beuve conserva son parapluie à la main, disant qu’il voulait bien être tué mais pas mouillé. Après l’échec de ses romans, Sainte-Beuve se lance dans les études littéraires, dont la plus connue est Port-Royal, et collabore notamment à La Revue contemporaine. Port-Royal (1837-1859), le chef-d’œuvre de Saint-Beuve, décrit l’histoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs, de son origine à sa destruction. Ce livre résulte d’un cours donné à l’Académie de Lausanne entre le 6 novembre 1837 et le 25 mai 1838. Cette œuvre a joué un rôle important dans le renouvellement de l’histoire religieuse. Certains historiens qualifient Port-Royal de « tentative d’histoire totale ». Élu à l’Académie française le 14 mars 1844 au fauteuil de Casimir Delavigne, il est reçu le 27 février 1845 par Victor Hugo. Il est à noter que ce dernier portait néanmoins sur leurs relations un regard désabusé: « Sainte-Beuve, confiait-il à ses carnets en 1876, n’était pas poète et n’a jamais pu me le pardonner . » En 1848-1849, il accepte une chaire à l’université de Liège, où il donne un cours consacré à Chateaubriand et son groupe littéraire, qu’il publie en 1860. À partir d’octobre 1849, il publie, successivement dans Le Constitutionnel, Le Moniteur et Le Temps des feuilletons hebdomadaires regroupés en volumes sous le nom de Causeries du lundi, leur titre venant du fait que le feuilleton paraissait chaque lundi. À la différence de Hugo, il se rallie au Second Empire en 1852. Le 13 décembre 1854, il obtient la chaire de poésie latine au Collège de France, mais sa leçon inaugurale sur « Virgile et L’Énéide », le 9 mars 1855, est perturbée par des étudiants qui veulent dénoncer son ralliement. Il doit alors envoyer, le 20 mars, sa lettre de démission. Par la suite, le 3 novembre 1857, il est nommé maître de conférences à l’École normale supérieure, où il donne des cours de langue et de littérature françaises de 1858 à 1861. Sous l’Empire libéral, il est nommé au Sénat, où il siège du 28 avril 1865 jusqu’à sa mort en 1869. Dans ces fonctions, il défend la liberté des lettres et la liberté de penser. Réception Friedrich Nietzsche, pourtant adversaire déclaré de Sainte-Beuve, a incité en 1880 Ida Overbeck, femme de son ami Franz Overbeck, à traduire les Causeries du lundi en allemand. Jusque-là, Sainte-Beuve n’avait jamais été publié en allemand, malgré sa grande importance en France, car considéré en Allemagne comme représentant d’une manière détestable et typiquement française de penser. La traduction d’Ida Overbeck est parue en 1880 sous le titre Menschen des XVIII. Jahrhunderts (« l’être humain au XVIIIe siècle »). Nietzsche a écrit à Ida Overbeck le 18 août 1880: « Il y a une heure que j’ai reçu Menschen des XVIII. Jahrhunderts. [...] C’est un livre merveilleux, je crois que j’ai pleuré, et ce serait bizarre si ce petit livre ne pouvait pas exciter la même sensation chez beaucoup d’autres personnes ». La traduction d’Ida Overbeck est un document important du transfert culturel entre l’Allemagne et la France, mais fut largement ignorée. En 2014 apparut la première édition critique et annotée. Charles Maurras s’inspire directement de la méthode d’analyse du critique littéraire pour forger sa methode d’analyse politique, l’empirisme organisateur, qui aboutira chez lui au nationalisme intégral,. Œuvres Poésie * Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829) * Les Consolations (1830) * Pensées d’août (1837) * Livre d’amour (1843) * Poésies complètes (1863) Romans et nouvelles * Volupté (1834)– réédité par S.E.P.E. en 1947 avec illustrations de Marguerite Bermond. * Madame de Pontivy (1839) * Christel (1839) * Le Clou d’or qu’il dédia à Sophie de Bazancourt, femme de lettres et épouse du général François Aimé Frédéric Loyré d’Arbouville. * La Pendule (1880) Critique * Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle (1828), 2 volumes * Port-Royal (1840-1859), 5 volumes * Portraits littéraires (1844 et 1876-78), 3 volumes * Portraits contemporains (1846 et 1869-71), 5 volumes * Portraits de femmes (1844 et 1870) * Les Lundis * Causeries du lundi (1851-1862), 16 volumes * Nouveaux lundis (1863-1870), 13 volumes * Premiers lundis (1874-75), 3 volumes * Étude sur Virgile (1857). Texte de cette étude annoté par Henri Goelzer en 1895. * Chateaubriand et son groupe littéraire (1860), 2 volumes * Le Général Jomini (1869) * Madame Desbordes-Valmore: sa vie et sa correspondance (1870) * M. de Talleyrand (1870) * P.-J. Proudhon (1872) * Chroniques parisiennes (1843-1845 et 1876) * Les cahiers de Sainte-Beuve (1876) * Mes poisons (1926): carnet secret édité à titre posthume Correspondance * Lettres à la princesse (Mathilde) (1873) * Correspondance (1877-78), 2 volumes * Nouvelle correspondance (1880) * Lettres à Collombet (1903) * Correspondance avec M. et Mme Juste Olivier (1904) * Lettres à Charles Labitte (1912) * Lettres à deux amies (1948) * Lettres à George Sand * Lettres à Adèle Couriard * Correspondance générale, 19 volumes Biographie * Le général Jomini, étude, Paris 1869. Texte sur Gallica Hommage * Denys Puech (1854-1942), Monument à Sainte-Beuve, 1898, Paris, jardin du Luxembourg. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_Sainte-Beuve


Charles Le Goffic, né le 14 juillet 1863 à Lannion où il est mort le 12 février 1932, est un poète, romancier et critique littéraire français dont l’œuvre célèbre la Bretagne. Biographie Charles-Henri Francis Jean-Marie Le Goffic est le fils de Marie-Aimée Alexandrine Le Tulle, dite Manon, et d’un libraire-imprimeur de Lannion, Jean-François Le Goffic, qui mourut l’année suivant sa naissance. Alors que sa mère ne tire que peu de ressources de l’entreprise, le petit Charles passe ses étés avec sa nourrice, soit à Ploumanac’h, soit à Trégastel. En octobre 1888, il épouse Julie Fleury. À la faveur d’une adjudication, il achète peu après une petite ferme à Rûn-Rouz en Trégastel. Son roman Morgane, la sirène a pour cadre cette ferme de Rûn-Rouz. Agrégé de littérature en 1887, il est enseignant successivement à Gap, Évreux, Nevers et au Havre. En 1886, il fonde avec Maurice Barrès et Raymond de La Tailhède la revue littéraire Les Chroniques. Proche de Charles Maurras, il collabore à la Revue d’Action française (1899), qui deviendra L’Action française (1908), ainsi qu’à la Revue critique des idées et des livres. Bien que républicain convaincu, son régionalisme militant et ses idéaux traditionalistes lui font appuyer le projet maurrassien de restauration monarchique comme en témoigne sa lettre publiée dans L’Enquête sur la monarchie (1900) du chef de file de l’Action française. Il prend la vice-présidence de l’Union régionaliste bretonne, créée en 1898, et lui sert de relais parisien en suscitant la parution d’articles dans la presse.Parlant parfaitement le breton, il ne voulait pas l’utiliser à l’écrit de peur « de se montrer inférieur à sa réputation ». Il est barde d’honneur de la Gorsedd de Bretagne sous le nom d’Eostik ar Garante (Le Rossignol de l’Amour). Le Goffic est élu membre de l’Académie française en 1930 au 12e fauteuil. En 1895, il a introduit en Bretagne la Great Highland Bagpipe (grande cornemuse écossaise) devenue le « biniou bras » à côté du biniou kozh des anciens. Il est inhumé dans l’enclos de l’église du bourg de Trégastel avec sa femme Julie et sa fille Hervine-Marie, morte à l’âge de 17 ans des suites d’un accident de battage survenu à Trégastel. Un monument surmonté de son buste en bronze par Jean Boucher a été érigé par souscription nationale à Lannion. En 1934, un médaillon à son effigie a été apposée sur la Roche des Poètes (Roche des Martyrs) à La Clarté. À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, un médaillon, œuvre du sculpteur Michel Sprogis, est posé sur un rocher près de la chapelle Sainte-Anne. Œuvres * Nous autres (1879) * Velléda, sous le pseudonyme de Jean Capekerne, (Morlaix, 1882), * Les Mémoires de Saint-Simon, avec Jules Tellier (Paris, 1888) * Amour breton, poésie (Lemerre, 1889) * Les Romanciers d’aujourd’hui (1890) * Nouveau traité de versification française, en collaboration avec Édouard Thieulin (1890) * Chansons bretonnes (1891) * Le Crucifié de Keraliès (1892), ouvrage couronné par l’Académie française. Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000404).—Avec des bois de Géo-Fourrier (ISBN 9782824004877). * A travers Le Havre, effets de soir et de nuit, en collaboration avec Daniel de Vénancourt, 12 eaux-fortes de Gaston Prunier, Lemale éditeur, 1892. * Passé l’amour (1894) * Contes de l’Assomption (1895) * Quatre jours à l’île de Sein (1896) * Sur la côte (1896), ouvrage couronné par l’Académie française. Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782846187695). * Gens de mer (1897) * La Payse (1897). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000046). * Morgane la sirène (1898) * Les Phares (1899) * Le Bois dormant, poésie (1900) * Le Mouvement panceltique (1900) * Le Pardon de la reine Anne, poésie (1901) * L’Âme bretonne (4 vol., 1902-1922). Réédition en 4 volumes, Ed. des Régionalismes. * Deux tableaux de la vie terreneuvienne (1903) * Les Métiers pittoresques (1903) * L’Erreur de Florence (1903) * Les Sept-Iles (1904) * Les Calvaires bretons (1904) * Les Bonnets rouges (1906). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824001500). * La Cigarière (1907) * La Crise sardinière (1907) * Passions celtes (1909). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000008). * La double confession (1909) * La littérature française au XIXe siècle (1909) * Ventôse. Le pays (1910) * Fêtes et coutumes populaires, les fêtes patronales, le réveillon, les masques et travestis, le joli mois de mai, les noces en Bretagne, la fête des morts, les feux de la Saint-Jean, danses et musiques populaires, Armand Colin éditeur, Paris 1911. * Tristan Corbière (1911)—Préface au recueil Les Amours jaunes * Racine (2 vol., 1912) * Le Pirate de l’île Lern (1913). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000053). * Monsieur Ernest Renan dans la Basse-Bretagne (1913) * Poésies complètes (1913) * Dixmude, un chapitre de l’histoire des fusiliers marins (1915), qui reçut le prix Lasserre en 1915 * Bourguignottes et pompons rouges (1916) * Les Marais de Saint-Gond (1917) * Steenstraëte, un deuxième chapitre de l’histoire des fusiliers marins (1917) * Sans nouvelles (1917) * La Guerre qui passe (1918) * Saint-Georges et Nieuport, les derniers chapitres de l’histoire des fusiliers marins (1919) * Les Trois Maréchaux (1919) * Bretagne (1920) * La Littérature française aux XIXe et XXe siècles (1920) * La Marne en feu (1921) * L’Abbesse de Guérande (1921). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824001876). * Chez les Jean Gouin (1921) * L’Odyssée de Jean Chevanton (1921) * L’Illustre Bobinet (1922). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000015). * Croc d’argent (1922) * Poésies complètes (1922) * Le Treizain de la nostalgie et du déchirement. La visite nocturne, poésies (1926) * Madame Ruguellou (1927). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782824000022). * La Tour d’Auvergne (1928) * Contes de l’Armor et de l’Argoat (1928). Réédition Ed. des Régionalismes (ISBN 9782846188951). * Anthologie des poètes de la mer (1929) * Mes Entretiens avec Foch, suivis d’un entretien avec le général Weygand (1929) * De Quelques ombres (1929) * La Chouannerie: Blancs contre Bleus (1790-1800) (1931) * Poésies complètes (2 vol., 1931) * La Rose des sables (1932) * Ombres lyriques et romanesques (1933) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Goffic


François-Marie Arouet, dit Voltairebre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778 (à 83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières, anglomane, féru d’arts et de sciences, personnage protéiforme et complexe, non dénué de contradictions, Voltaire domine son époque par la durée de sa vie, l’ampleur de sa production littéraire et la variété des combats politiques qu’il a menés. Son influence est décisive sur la bourgeoisie libérale avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle. Anticlérical mais déiste, il dénonce dans son Dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de son époque. Sur le plan politique, il est en faveur d’une monarchie modérée et libérale, éclairée par les « philosophes ». Mettant sa notoriété au service des victimes de l’intolérance religieuse ou de l’arbitraire, il prend position dans des affaires qu’il a rendues célèbres: Jean Calas, Pierre-Paul Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally. Son œuvre littéraire est riche et variée: son importante production théâtrale, ses longs poèmes épiques, telle La Henriade, et ses œuvres historiques firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au XVIIIe siècle. Son œuvre comprend aussi des contes, notamment Candide ou l’Optimisme, des Lettres philosophiques, le Dictionnaire philosophique et une correspondance monumentale dont nous connaissons plus de 15 000 lettres sur un total parfois estimé à 40 000. Titulaire d’une charge officielle d’historiographe du roi, il a publié Le siècle de Louis XIV, puis Le Siècle de Louis XV, ouvrages considérés comme les premiers essais historiques modernes. Il a traduit librement La Science nouvelle de Jean-Baptiste Vico en lui donnant pour titre l’expression inédite de Philosophie de l’histoire, ce qui fait de lui le précurseur du déterminisme historique au XIXe siècle, puis de l’histoire culturelle au XXe siècle. Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir, qui l’embastille et le contraint à l’exil en Angleterre ou loin de Paris. En 1749, après la mort d’Émilie du Châtelet, avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse pendant quinze ans, il part pour la cour de Prusse mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin, il se brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard aux Délices, près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise, à l’abri des puissants. Il ne reviendra à Paris qu’en 1778, ovationné par le peuple après une absence de près de vingt-huit ans. Il y meurt à 83 ans. Voltaire aime le confort, les plaisirs de la table et de la conversation qu’il considère, avec le théâtre, comme l’une des formes les plus abouties de la vie en société. Soucieux de son aisance matérielle, qui garantit sa liberté et son indépendance, il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives qui préfigurent les grandes spéculations boursières sous Louis XVI et dans la vente de ses ouvrages, ce qui lui permet de s’installer en 1759 au château de Ferney et d’y vivre sur un grand pied, tenant table et porte ouvertes. Le pèlerinage à Ferney fait partie en 1770-1775 du périple de formation de l’élite européenne éclairée. Investissant ses capitaux, il fait du village misérable de Ferney une petite ville prospère. Généreux, d’humeur gaie, il est néanmoins chicanier et parfois féroce et mesquin avec ses adversaires comme Jean-Jacques Rousseau ou Crébillon. La Révolution française voit en lui comme en Rousseau un précurseur, si bien qu’il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau. À cette même période, sur l’initiative du marquis de Villette qui l’hébergeait, le « quai des Théatins » où l’écrivain habitait à Paris au moment de sa mort sera baptisé « quai Voltaire ». Célébré par la IIIe République (dès 1870, à Paris, un boulevard et une place portent son nom), il a nourri, au XIXe siècle, les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et, au-delà, de l’esprit des Lumières. Biographie Débuts (1694-1733) Origines: naissance et filiation contestée François-Marie Arouet est né officiellement le 21 novembre 1694 à Paris et a été baptisé le lendemain à l’église de Saint-André-des-Arcs. Il est le deuxième fils de François Arouet (1647-1722), notaire au Châtelet depuis 1675, marié le 7 juin 1683 à Saint-Germain-l’Auxerrois avec Marie-Marguerite Daumart (1661-1701), fille d’un greffier criminel au Parlement qui lui donne cinq enfants (dont trois atteignent l’âge adulte). Le père revend en 1696 sa charge de notaire pour acquérir celle de conseiller du roi, receveur des épices à la Chambre des comptes. Voltaire perd sa mère à l’âge de sept ans. Il a comme frère aîné, Armand Arouet (1685-1765), avocat au Parlement, puis successeur de son père comme receveur des épices, personnalité très engagée dans le jansénisme parisien à l’époque de la Fronde parlementaire et du Diacre Pâris. Sa sœur, Marie Arouet (1686-1726), seule personne de sa famille qui ait inspiré de l’affection à Voltaire, épousera Pierre François Mignot, correcteur à la Chambre des comptes, et elle sera la mère de l’abbé Mignot, qui jouera un rôle à la mort de Voltaire, et de Marie-Louise, la future « Madame Denis », qui partagera une partie de la vie de l’écrivain. Cependant, Voltaire a plusieurs fois affirmé qu’il était né le 20 février 1694 à Châtenay-Malabry, où son père avait une propriété, le château de la Petite Roseraie. Ce fait semble confirmé par la personne devenue propriétaire du château, la comtesse de Boigne ainsi qu’elle l’écrit dans ses mémoires: « La naissance de Voltaire dans cette maison lui donne prétention à quelque célébrité ». Il a contesté aussi sa filiation paternelle, persuadé que son vrai père était un certain Roquebrune,: « Je crois aussi certain que d’Alembert est le fils de Fontenelle, comme il est sûr que je le suis de Roquebrune ». Voltaire prétendit que l’honneur de sa mère consistait à avoir préféré un homme d’esprit comme était Roquebrune, « mousquetaire, officier, auteur et homme d’esprit », à son père, le notaire Arouet dont Roquebrune était le client, car Arouet était, selon Voltaire, un homme très commun. Le baptême à Paris aurait été retardé du fait de la naissance illégitime et du peu d’espoir de survie de l’enfant. Aucune certitude n’existe sinon que l’idée d’une naissance illégitime et d’un lien de sang avec la noblesse d’épée ne déplaisait pas à Voltaire. Du côté paternel, les Arouet sont originaires d’un petit village du nord du Poitou, Saint-Loup-sur-Thouet, près d’Airvault, où ils exercent aux XVe et XVIe siècles une activité marchands tanneurs, ce qui faisait de l’aïeul de Voltaire, Helenus Arouet (1569-1625), un très riche marchand, propriétaire de la seigneurie de Puy-Terrois, acquéreur en 1612 pour 4000 livres tournois « la maison noble terre et seigneurie et métairie de la Routte » à Saint-Loup qu’il revend en 1615. Le premier Arouet à quitter sa province s’installe à Paris en 1625 où il ouvre une boutique de marchand de draps et de soie. Il épouse la fille d’un riche marchand drapier et s’enrichit suffisamment pour acheter en 1675 pour son fils, François, le père de Voltaire, une charge anoblissante de notaire au Châtelet, assurant à son titulaire l’accès à la petite noblesse de robe. Le père de Voltaire, travailleur austère et probe aux relations importantes, arrondit encore la fortune familiale, et épouse le 7 juin 1683 la fille d’un greffier criminel au Parlement. Études chez les Jésuites (1704-1711) À la différence de son frère aîné chez les jansénistes, François-Marie entre à dix ans comme interne (400 puis 500 livres par an) au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites. François-Marie y reste durant sept ans. Les jésuites enseignent le latin et la rhétorique, mais veulent avant tout former des hommes du monde et initient leurs élèves aux arts de société: joutes oratoires, plaidoyers, concours de versification, et théâtre. Un spectacle, le plus souvent en latin et d’où sont par principe exclues les scènes d’amour, et où les rôles de femmes sont joués par des hommes, est donné chaque fin d’année lors la distribution des prix. Arouet est un élève brillant, vite célèbre par sa facilité à versifier: sa toute première publication est son Ode à sainte Geneviève. Imprimée par les Pères, cette ode est répandue hors les murs de Louis-le-Grand (au grand dam ultérieurement de Voltaire adulte). Il apprend au collège Louis-le-Grand à s’adresser d’égal à égal aux fils de puissants personnages, le tout jeune Arouet tisse de précieux liens d’amitié, très utiles toute sa vie: entre bien d’autres, les frères d’Argenson, René-Louis et Marc-Pierre, futurs ministres de Louis XV et le futur duc de Richelieu. Bien que très critique en ce qui concerne la religion en général et les ecclésiastiques en particulier, il garde toute sa vie une grande vénération pour son professeur jésuite Charles Porée. Voltaire écrit en 1746: « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également cher à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimables. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses ; et j’aurais voulu qu’il eût été établi dans Paris, comme dans Athènes, qu’on pût assister à de telles leçons ; je serais revenu souvent les entendre ». Débuts comme homme de lettres et premières provocations (1711-1718) Arouet quitte le collège en 1711 à dix-sept ans et annonce à son père qu’il veut être homme de lettres, et non avocat ou titulaire d’une charge de conseiller au Parlement, investissement pourtant considérable que ce dernier est prêt à faire pour lui. Devant l’opposition paternelle, il s’inscrit à l’école de droit et fréquente la société du Temple, qui réunit dans l’hôtel de Philippe de Vendôme, des membres de la haute noblesse et des poètes (dont Chaulieu), épicuriens lettrés connus pour leur esprit, leur libertinage et leur scepticisme. L’abbé de Châteauneuf, son parrain, qui y avait ses habitudes, l’avait présenté dès 1708. En leur compagnie, il se persuade qu’il est né grand seigneur libertin et n’a rien à voir avec les Arouet et les gens du commun. C’est aussi pour lui une école de poésie ; il va ainsi y apprendre à faire des vers « légers, rapides, piquants, nourris de référence antiques, libres de ton jusqu’à la grivoiserie, plaisantant sans retenue sur la religion et la monarchie ». Son père l’éloigne un moment de ce milieu en l’envoyant à Caen, puis en le confiant au frère de son parrain, le marquis de Châteauneuf, qui vient d’être nommé ambassadeur à La Haye et accepte d’en faire son secrétaire privé. Mais son éloignement ne dure pas. À Noël 1713, il est de retour, chassé de son poste et des Pays-Bas pour cause de relations tapageuses avec une demoiselle. Furieux, son père veut l’envoyer en Amérique mais finit par le placer dans l’étude d’un magistrat parisien. Il est sauvé par un ancien client d’Arouet, lettré et fort riche, M. de Caumartin, marquis de Saint-Ange, qui le convainc de lui confier son fils pour tester le talent poétique du jeune rebelle. Arouet fils passe ainsi des vacances au château de Saint-Ange près de Fontainebleau à lire, à écrire et à écouter les récits de son hôte qui lui serviront pour La Henriade et Le Siècle de Louis XIV. En 1715, alors que débute la Régence, Arouet a 21 ans. Il est si brillant et si amusant que la haute société se dispute sa présence. Il aurait pu devenir l’ami du Régent mais se retrouve dans le camp de ses ennemis. Invité au château de Sceaux, centre d’opposition le plus actif au nouveau pouvoir, où la duchesse du Maine, mariée au duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV, tient une cour brillante, il ne peut s’empêcher de faire des vers injurieux sur les relations amoureuses du Régent et de sa fille, la duchesse de Berry, qui vient d’accoucher clandestinement. Le 4 mai 1716, il est exilé à Tulle. Son père use de son influence auprès de ses anciens clients pour fléchir le Régent qui remplace Tulle par Sully-sur-Loire, où Arouet fils s’installe dans le château du jeune duc de Sully, une connaissance du Temple, qui vit avec son entourage dans une succession de bals, de festins et de spectacles divers. À l’approche de l’hiver, il sollicite la grâce du Régent qui la lui accorde. Le jeune Arouet alors recommence sa vie turbulente à Saint-Ange et à Sceaux, profitant de l’hospitalité des nantis et du confort de leurs châteaux. Mais, pris par l’ambiance, quelques semaines plus tard, il récidive. S’étant lié d’amitié avec un certain Beauregard, en réalité un indicateur de la police chargé de le faire parler, il lui confie être l’auteur de nouveaux ouvrages de vers satiriques contre le Régent et sa fille. Le 16 mai 1717, il est envoyé à la Bastille par lettre de cachet. Arouet a alors 23 ans et il restera embastillé durant onze mois. Premiers succès littéraires et retour à la Bastille (1718-1726) À sa première sortie de la prison de la Bastille, conscient d’avoir jusque-là gaspillé son temps et son talent, il veut donner un nouveau cours à sa vie, et devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature de son époque: la tragédie et la poésie épique. Pour rompre avec son passé, et notamment avec sa famille, afin d’effacer un patronyme aux consonances vulgaires et équivoques, il se crée un nom euphonique: Voltaire. On ne sait pas à partir de quels éléments il a élaboré ce pseudonyme. De nombreuses hypothèses ont été avancées, toutes vraisemblables mais jamais prouvées: inversion des syllabes de la petite ville d’Airvault (proche du village dont est originaire la famille Arouet), anagramme d’Arouet l.j. (le jeune) ou encore référence à un personnage de théâtre nommé Voltare[Lequel ?]. La ville de Volterra en Toscane fut aussi évoquée: organisée en République de Volterra dans la ligue Guelfe, elle fut fière et rebelle et s’opposa à l’autorité des évêques. Il a été dit que Voltaire, en voyage et malade y fut si bien soigné qu’il en fut reconnaissant ; l’hypothèse est belle mais contestée par Chaudon. Le 18 novembre 1718, sa première pièce écrite sous le pseudonyme de Voltaire, Œdipe, obtient un immense succès. Le public, qui voit en lui un nouveau Racine, aime ses vers en forme de maximes et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion. Ses talents de poète mondain triomphent dans les salons et les châteaux. Il devient l’intime des Villars, qui le reçoivent dans leur château de Vaux, et l’amant de Madame de Bernières, épouse du président à mortier du parlement de Rouen. Après l’échec d’une deuxième tragédie, il connaît un nouveau succès en 1723 avec La Henriade, poème épique de 4 300 alexandrins se référant aux modèles classiques (Iliade d’Homère, Énéide de Virgile) dont le sujet est le siège de Paris par Henri IV et qui trace le portrait d’un souverain idéal, ennemi de tous les fanatismes: vendu à 4 000 exemplaires en quelques semaines, ce poème connaîtra soixante éditions successives du vivant de son auteur. Pour ses contemporains admiratifs, Voltaire va être longtemps l’auteur de La Henriade, le « Virgile français », le premier à avoir écrit une épopée nationale, mais celle-ci n’est pas passée à la postérité et a été repoussée dans l’oubli par le romantisme au XIXe siècle. En janvier 1726, il subit une humiliation qui va le marquer toute sa vie. Le chevalier de Guy-Auguste de Rohan-Chabot, jeune gentilhomme arrogant, appartenant à l’une des plus illustres familles du royaume, l’apostrophe à la Comédie-Française: « Monsieur de Voltaire, Monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ? » ; Voltaire réplique alors: « Voltaire! Je commence mon nom et vous finissez le vôtre ». Quelques jours plus tard, on le fait appeler alors qu’il dîne chez son ami le duc de Sully. Dans la rue, il est frappé à coups de gourdin par les laquais du chevalier, qui surveille l’opération de son carrosse. Blessé et humilié, Voltaire veut obtenir réparation, mais aucun de ses amis aristocrates ne prend son parti. Le duc de Sully refuse ainsi de l’accompagner chez le commissaire de police pour appuyer sa plainte. Il n’est pas question d’inquiéter un Rohan pour avoir fait rouer de coups un écrivain: « Nous serions bien malheureux si les poètes n’avaient pas d’épaules », dit un parent de Caumartin. Le prince de Conti écrit sur l’incident que les coups de bâtons « ont été bien reçus mais mal donnés ». Voltaire veut venger son honneur par les armes, mais son ardeur à vouloir se faire justice lui-même indispose tout le monde. Les Rohan obtiennent que l’on procède à l’arrestation de Voltaire, qui est conduit à la Bastille le 17 avril. Il n’est libéré, deux semaines plus tard, qu’à la condition qu’il s’exile. En Angleterre, « terre de Liberté » (1726-1728) Voltaire a 32 ans. Cette expérience va le marquer d’une empreinte indélébile. Il est profondément impressionné par l’esprit de liberté de la société anglaise (ce qui ne l’empêche pas d’apercevoir les ombres du tableau, surtout vers la fin de son séjour). Alors qu’en France règnent les lettres de cachet, la loi d’Habeas corpus de 1679 (nul ne peut demeurer détenu sinon par décision d’un juge) et la Déclaration des droits de 1689 protègent les citoyens anglais contre le pouvoir du roi. L’Angleterre, cette « nation de philosophes », rend justice aux vraies grandeurs qui sont celles de l’esprit. Présent en 1727 aux obsèques solennelles de Newton à Westminster Abbey, il fait la comparaison: à supposer que Descartes soit mort à Paris, on ne lui aurait certainement pas accordé d’être enseveli à Saint-Denis, auprès des sépultures royales. La réussite matérielle du peuple d’Angleterre suscite aussi son admiration. Il fait le lien avec le retard de la France dans le domaine économique et l’archaïsme de ses institutions. Il estime que, là où croît l’intensité des échanges marchands et intellectuels, grandit en proportion l’aspiration des peuples à plus de liberté et de tolérance. Il ne lui faut que peu de temps pour acquérir une excellente maitrise de l’anglais. En novembre 1726, il s’installe à Londres. Il rencontre des écrivains, des philosophes, des savants (physiciens, mathématiciens, naturalistes) et s’initie à des domaines de connaissance qu’il ignorait jusqu’ici. Son séjour en Angleterre lui donne l’occasion de découvrir Newton dont il n’aura de cesse de faire connaître l’œuvre. Ainsi s’esquisse la mutation de l’homme de lettres en « philosophe », qui le conduit à s’investir dans des genres jusqu’alors considérés comme peu prestigieux: l’histoire, l’essai politique et plus tard le roman. C’est en Angleterre qu’il commence à rédiger en anglais l’ouvrage où il expose ses observations sur l’Angleterre, qu’il fera paraître en 1733 à Londres sous le titre Letters Concerning the English Nation et dont la version française n’est autre que les Lettres philosophiques. Il se rapproche de la cour de Georges Ier puis de Georges II et prépare une édition de la Henriade en souscription accompagnée de deux essais en anglais qui remporte un grand succès (343 souscripteurs) et renfloue ses finances. Une souscription analogue ouverte en France par son ami Thériot n’en rassemble que 80 et fera l’objet de nombreuses saisies de la police. Retour d’Angleterre (1728-1733) À l’automne 1728, il est autorisé à rentrer en France pourvu qu’il se tienne éloigné de la capitale. L’affaire Rohan remonte à plus de trois ans. Voltaire procède précautionneusement, séjournant plusieurs mois à Dieppe où il se fait passer pour un Anglais. Il obtient en avril l’autorisation de venir à Paris, mais Versailles lui reste interdit. Voltaire veut être riche pour être un écrivain indépendant. À son retour d’Angleterre, il n’a que quelques économies qu’il s’emploie activement à faire fructifier. Il gagne un capital important (avec d’autres et sur une idée du mathématicien La Condamine) en participant à une loterie d’État mal conçue. Puis, il part à Nancy spéculer sur des actions émises par le duc François III de Lorraine, opération dans laquelle il aurait « triplé son or ». Il reçoit aussi en mars 1730 sa part de l’héritage paternel. Ces fonds vont être judicieusement placés dans le commerce, « les affaires de Barbarie », vente des blés d’Afrique du Nord vers l’Espagne et l’Italie où elle est plus lucrative qu’à Marseille et les « transactions de Cadix », échange de produits des colonies françaises contre l’or et l’argent du Pérou et du Mexique. En 1734, il confie ses capitaux aux frères Pâris dans leur entreprise de fournitures aux armées. Enfin, à partir de 1736, Voltaire va surtout prêter de l’argent à des grands personnages et des princes européens, prêts transformés en rentes viagères selon une pratique courante de l’époque (à lui d’actionner ses débiteurs, désinvoltes mais ayant du répondant, pour obtenir le paiement de ses rentes). « J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre ». Programme réalisé à son retour d’Angleterre. En 1730, un incident, dont il se souviendra à l’heure de sa mort, le bouleverse et le scandalise. Il est auprès d’Adrienne Lecouvreur, une actrice qui a joué dans ses pièces et avec laquelle il a eu une liaison, lorsqu’elle meurt. Le prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice refuse la sépulture (la France est alors le seul pays catholique où les comédiens sont frappés d’excommunication). Le cadavre doit être placé dans un fiacre jusqu’à un terrain vague à la limite de la ville où elle est enterrée sans aucun monument pour marquer sa tombe. Quelques mois plus tard meurt à Londres une comédienne, Mrs Oldfield, enterrée à Westminster Abbey. Là encore, Voltaire fait la comparaison. Voltaire fait sa rentrée littéraire à Paris par le théâtre (mais il travaille selon son habitude à plusieurs œuvres à la fois). Sans beaucoup de succès avec Brutus, La mort de César et Eriphyle. Mais Zaïre en 1732 remporte un triomphe comparable à celui d’Œdipe et est joué dans toute l’Europe (la 488e représentation a eu lieu en 1936). La mise sur orbite avec les Lettres philosophiques ou Lettres anglaises, publiées en 1734 apparaît le premier grand travail des Lumières. Vingt-cinq lettres abordent des sujets assez variés: la religion, les sciences, les arts, la politique ou la philosophie (de Pascal notamment). L’ouvrage est destiné à un peuple plus ou moins cultivé, capable de lire mais nécessitant une éducation certaine. Ce sont des lettres ouvertes, destinées à être lues par un plus grand nombre grâce à leur parution sous forme d’un livre. Les Lettres philosophiques et l’Académie (1733-1749) Depuis des mois, sa santé délabrée fait que Voltaire vit sans maîtresse. En 1733, il devient l’amant de Mme du Châtelet. Émilie du Châtelet a 27 ans, 12 de moins que Voltaire. Fille de son ancien protecteur, le baron de Breteuil, elle décide pendant seize ans de l’orientation de sa vie, dans une situation quasi conjugale (son mari, un militaire appelé à parcourir l’Europe à la tête de son régiment, n’exige pas d’elle la fidélité, à condition que les apparences soient sauves, une règle que Voltaire « ami de la famille » sait respecter). Ils ont un enthousiasme commun pour l’étude et sous l’influence de son amie, Voltaire va se passionner pour les sciences. Il « apprend d’elle à penser », dit-il. Elle joue un rôle essentiel dans la métamorphose de l’homme de lettres en « philosophe ». Elle lui apprend la diplomatie, freine son ardeur désordonnée. Ils vont connaître dix années de bonheur et de vie commune. La passion se refroidit ensuite. Les infidélités sont réciproques (la nièce de Voltaire, Mme Denis, devient sa maitresse fin 1745, secret bien gardé de son vivant ; Mme du Châtelet s’éprend passionnément de Saint-Lambert en 1748), mais ils ne se sépareront pas pour autant, l’entente entre les deux esprits demeurant la plus forte. À sa mort, en 1749, elle ne sera jamais remplacée. Mme Denis, que Voltaire aimera tendrement, va régner sur son ménage (ce dont ne se souciait pas Mme du Châtelet), mais elle ne sera jamais la confidente et la conseillère de ses travaux. Émilie est une véritable femme de sciences. L’étendue de ses connaissances en mathématiques et en physique en fait une exception dans le siècle. C’est aussi une femme du monde qui mène une vie mondaine assez frénétique en dehors de ses études. Elle aime l’amour (elle a déjà eu plusieurs amants, dont le duc de Richelieu ; elle devient en 1734 la maîtresse de son professeur de mathématiques, Maupertuis, que lui a présenté Voltaire) et le jeu, où elle perd beaucoup d’argent. Elle cherche un homme à sa mesure pour asseoir sa réussite intellectuelle: Voltaire est un écrivain de tout premier plan, de réputation européenne, avide de réussite lui aussi. 1734 est l’année de la publication clandestine des Lettres philosophiques, le « manifeste des Lumières », grand reportage intellectuel et polémique sur la modernité anglaise, publié dans toute l’Europe à 20 000 exemplaires, selon l’estimation de René Pomeau, chiffre particulièrement élevé à l’époque. L’éloge de la liberté et de la tolérance anglaise est perçu à Paris comme une attaque contre le gouvernement et la religion. Le livre est condamné par le Parlement à majorité janséniste et brulé au bas du grand escalier du Palais. Une lettre de cachet est lancée contre Voltaire qui s’enfuit à Cirey, le château champenois que possèdent les Châtelet. Un an plus tard, après une lettre de désaveu où il « proteste de sa soumission entière à la religion de ses pères », il sera autorisé à revenir à Paris si nécessaire, mais la lettre de cachet ne sera pas révoquée. Pendant les dix années suivantes passées pour l’essentiel à Cirey, Voltaire va jouer un double jeu: rassurer ses adversaires pour éviter la Bastille, tout en continuant son œuvre philosophique pour gagner les hésitants. Tous les moyens sont bons: publications clandestines désavouées, manuscrits dont on fait savoir qu’il s’agit de fantaisies privées non destinées à la publication et qu’on lit aux amis et visiteurs qui en répandent les passages les plus féroces (exemple La Pucelle qui ridiculise Jeanne d’Arc). Son engagement est inséparable d’un combat antireligieux. L’intolérance religieuse, qu’il rend responsable de retard en matière de civilisation, est pour lui l’un des archaïsmes dont il voudrait purger la France. Voltaire restaure Cirey grâce à son argent. Les journées sont studieuses: discussions, lectures et travaux en communs, travaux personnels, portant sur la science et la religion. Voltaire fait des expériences scientifiques dans le laboratoire d’Émilie pour le concours de l’Académie des sciences. Aidé par Émilie du Châtelet, il est l’un des premiers à vulgariser en France les idées de Newton sur la gravitation universelle en publiant l’Épitre sur Newton (1736) et les Éléments de la philosophie de Newton (1738). Il commence La Pucelle (pour s’amuser dit-il) et Le Siècle de Louis XIV (pour convaincre son amie qui n’aime pas l’histoire), prépare L’Essai sur les mœurs, histoire générale de l’Occident chrétien où il dénombre les horreurs engendrées par le fanatisme. Toujours du théâtre avec Alzire (qui fait « perdre la respiration » au jeune Rousseau) et Mérope qui est un grand succès. Un poème, où il fait l’apologie du luxe (« Le superflu, chose très nécessaire »), Le Mondain, et évoque la vie d’Adam, scandalise à Paris les milieux jansénistes. Prévenu, il s’enfuit en Hollande par crainte des représailles. En 1742, sa pièce Mahomet est applaudie à Paris. Mais les mêmes milieux accusent Voltaire de taxer d’imposture, à travers l’islam, le christianisme lui-même. Ils obtiennent du pouvoir royal plutôt réticent l’interdiction de fait de la pièce, que Voltaire, toujours sous le coup de la lettre de cachet de 1734, doit retirer après la 3e représentation. Elle ne sera reprise qu’en 1751. Voltaire apparaît de plus en plus comme un adversaire de la religion. En 1736, Voltaire reçoit la première lettre du futur roi de Prusse. Commence alors une correspondance qui durera jusqu’à la mort de Voltaire (interrompue en 1754, après l’avanie de Francfort, elle reprendra en 1757). « Continuez, Monsieur, à éclairer le monde. Le flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains », lui écrit Frédéric qui veut l’attacher à sa cour par tous les moyens. Voltaire lui rend plusieurs fois visite, mais refuse de s’installer à Berlin du vivant de Mme du Châtelet qui se méfie du roi-philosophe. Pour cette raison peut-être, Madame du Châtelet pousse Voltaire à chercher un retour en grâce auprès de Louis XV. De son côté, Voltaire ne conçoit d’avenir pour ses idées sans l’accord du roi. En 1744, il est aidé par la conjoncture: le nouveau ministre des Affaires étrangères est d’Argenson, son ancien condisciple de Louis-le-Grand, et surtout il a le soutien de la nouvelle favorite Mme de Pompadour, qui l’admire. Son amitié avec le roi de Prusse est un atout. Il se rêve en artisan d’une alliance entre les deux rois et accepte une mission diplomatique, qui échoue. Grâce à ses appuis, il obtient la place d’historiographe de France, le titre de « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi » et les entrées de sa chambre. Dans le cadre de ses fonctions, il compose un poème lyrique, La Bataille de Fontenoy et un opéra, avec Rameau, à la gloire du roi. Mais Louis XV ne l’aime pas et Voltaire ne sera jamais un courtisan. De même, la conquête de l’Académie française lui paraît « absolument nécessaire ». Il veut se protéger de ses adversaires et y faire rentrer ses amis (à sa mort, elle sera majoritairement voltairienne et aura à sa tête d’Alembert qui lui est tout dévoué). Après deux échecs et beaucoup d’hypocrisies (un éloge des Jésuites et le canular de la bénédiction papale), il réussit à se faire élire le 2 mai 1746. La même année, Zadig, un petit livre publié clandestinement à Amsterdam est désavoué par Voltaire: « Je serais très fâché de passer pour l’auteur de Zadig qu’on ose accuser de contenir des dogmes téméraires contre notre sainte religion ». Outre ses aspects philosophiques, Zadig apparaît comme un bilan autocritique qu’établit Voltaire à 50 ans, estime Pierre Lepape. La gloire ne s’obtient qu’au prix du ridicule et de la honte du métier de courtisan, le bonheur est saccagé par les persécutions qu’il faut subir, l’amour est un échec, la science une manière de se cacher l’absurdité de la vie. L’histoire de l’humanité est celle d’un cheminement de la conscience malgré les obstacles: ignorance, superstition, intolérance, injustice, déraison. Zadig est celui qui lutte contre cette obscurité de la conscience: « Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à s’obscurcir ». En septembre 1749, Mme du Châtelet, enceinte de Saint-Lambert, officier de la cour du roi Stanislas et poète, meurt dans les jours qui suivent son accouchement. À la mort de Madame du Châtelet, avec laquelle il avait cru faire sa vie jusqu’à la fin de ses jours malgré leurs querelles et infidélités réciproques, Voltaire est désemparé et souffre de dépression (« la seule vraie souffrance de ma vie », dira-t-il). Il a 56 ans. Il ne reste que six mois à Paris. L’hostilité de Louis XV et l’échec de sa tragédie Oreste le poussent à accepter les invitations réitérées de Frédéric II. La maturité (1749-1768) Le voyage à Berlin (1749-1753) Il part en juin 1750 pour la cour de Prusse. Le 27 juillet, il est à Berlin. C’est l’enchantement. Magnifiquement logé dans l’appartement du maréchal de Saxe, il travaille deux heures par jour avec le roi qu’il aide à mettre au point ses œuvres. Le soir, des soupers délicieux avec la petite cour très francisée de Potsdam où il retrouve Maupertuis, président de l’Académie des sciences de Berlin, La Mettrie, d’Argens. Il a sa chambre au château de Sans-Souci et un appartement dans la ville au palais de la Résidence. En août, il reçoit la dignité de chambellan, avec l’ordre du Mérite. Voltaire va passer plus de deux ans et demi en Prusse (il y termine Le Siècle de Louis XIV et écrit Micromégas). Mais après l’euphorie des débuts, ses relations avec Frédéric se détériorent, les brouilles se font plus fréquentes, parfois provoquées par les imprudences de Voltaire (affaire Hirschel). Un pamphlet de Voltaire contre Maupertuis (ce dernier avait commis, en tant que président de l’Académie des sciences, un abus de pouvoir contre l’ancien précepteur de Mme du Châtelet, König, académicien lui aussi) provoque la rupture. Le pamphlet, La Diatribe du docteur Akakia, est imprimé par Voltaire sans l’accord du roi et en utilisant une permission accordée pour un autre ouvrage. Se sentant berné, furieux que l’on attaque son Académie, Frédéric fait saisir les exemplaires qui sont brûlés sur la place publique par le bourreau. Voltaire demande son congé. Il quitte la Prusse le 26 mars 1753 avec la permission du roi. Il ne se dirige pas tout de suite vers la France, faisant des arrêts prolongés à Leipzig, Gotha et Kassel où il est fêté, mais à Francfort, ville libre d’empire, Frédéric le fait arrêter le 31 mai par son résident le baron von Freytag, pour récupérer un livre de poésies écrit par lui et donné à Voltaire, dont il craint que ce dernier ne fasse mauvais usage (Voltaire en fait dans son récit de l’évènement « l’œuvre de poéshie du roi mon maitre »). Pendant plus d’un mois, Voltaire, en compagnie de Mme Denis venue le rejoindre, est humilié, séquestré, menacé et rançonné dans une série de scènes absurdes et ubuesques. Enfin libéré, il peut quitter Francfort le 8 juillet. À la frontière de la France (1753-1755) Jusqu’à la fin de l’année, il attend à Colmar la permission de revenir à Paris, mais le 27 janvier 1754, l’interdiction d’approcher de la capitale lui est notifiée. Il se dirige alors, par Lyon, vers Genève. Il pense trouver un havre de liberté dans cette république calviniste de notables et de banquiers cultivés parmi lesquels il compte de nombreux admirateurs et partisans. Grâce à son ami François Tronchin, Voltaire achète sous un prête-nom (les catholiques ne peuvent pas être propriétaires à Genève) la belle maison des Délices et en loue une autre dans le canton de Vaud pour passer la saison d’hiver. Les Délices annoncent Ferney. Voltaire embellit la maison, y mène grand train, reçoit beaucoup (la visite du grand homme, au cœur de la propagande voltairienne, devient à la mode), donne en privé des pièces de théâtre (le théâtre est toujours interdit dans la ville de Calvin). Très vite, les pasteurs genevois lui « conseillent » de ne rien publier contre la religion tant qu’il habite parmi eux. Le tremblement de terre et Candide (1755-1759) Il travaille aussi beaucoup: théâtre, préparation de Candide, sept volumes de l’Essai sur les mœurs tiré à 7 000 exemplaires, Poème sur le désastre de Lisbonne, révision des dix premiers volumes de ses Œuvres complètes chez Gabriel Cramer, son nouvel éditeur, qui a un réseau de correspondants européens permettant de diffuser les livres interdits. Voltaire collabore aussi à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (125 auteurs recensés). Ce grand dictionnaire vendu dans toute l’Europe (la souscription coûte une fortune) défend aussi la liberté de penser et d’écrire, la séparation des pouvoirs et attaque la monarchie de droit divin. Voltaire rédige une trentaine d’articles, mais il est en désaccord sur la tactique (« Je voudrais bien savoir quel mal peut faire un livre qui coûte cent écus. Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre »). Il voudrait imposer sa marque, faire de l’Encyclopédie l’organe du combat antichrétien, l’imprimer hors de France, mais, s’il possède en d’Alembert un allié de poids, il ne peut gagner Diderot à ses vues. Largement inspiré par Voltaire, l’article « Genève » de d’Alembert paru dans le volume VII en 1757 fait scandale auprès du clergé genevois. En France, après l’attentat de Damiens contre Louis XV, une offensive antiphilosophique se déclenche: après le livre d’Helvétius, De l’Esprit, interdit en août 1758, l’Encyclopédie est interdite à son tour le 8 mars 1759, par décret royal. Pour mieux assurer son indépendance et échapper aux tracasseries des pasteurs de Genève, Voltaire achète le château de Ferney (et celui de Tourney qui forme avec le précédent un vaste ensemble d’un seul tenant) et s’y installe en octobre 1758. Ferney est dans le Pays de Gex, en territoire français, mais loin de Versailles et à quatre kilomètres de la république genevoise où il peut trouver refuge et où se situe son éditeur Cramer et bon nombre de ses partisans dans les milieux dirigeants. Le Vignoble de la vérité (1759-1763) Ferney est la période la plus active de la vie de Voltaire. Il va y résider vingt ans jusqu’à son retour à Paris. C’est à Ferney qu’il va acquérir une nouvelle stature, celle d’un champion de la justice et de l’humanité et livrer ses grandes batailles. Il a 64 ans, un âge au XVIIIe siècle où la vie approche de son terme. Voltaire est devenu riche et en est fier: « Je suis né assez pauvre, j’ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau, et cependant me voilà maintenant avec deux châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d’argent comptant », écrit-il à son banquier en 1761. Sa fortune lui permet de reconstruire le château, d’en embellir les abords, d’y construire un théâtre, de faire de son vivant du village misérable de Ferney une petite ville prospère et aussi de tenir table et porte ouvertes, jusqu’à ce que l’afflux de visiteurs et la fatigue l’obligent à restreindre l’accueil. C’est la nièce et compagne de Voltaire, Madame Denis, qui reçoit comme maitresse de maison dont le poète Florian. Lui ne se montre qu’aux repas, se réservant d’apparaître à l’improviste si cela lui convient, car il se ménage de longues heures de travail (« J’ai quelquefois 50 personnes à table. Je les laisse avec Mme Denis qui fait les honneurs, et je m’enferme »). Ses visiteurs, qui l’attendent impatiemment, sont en général frappés par le charme de sa conversation, la vivacité de son regard, sa maigreur, son accoutrement (habituellement Voltaire ne « s’habille » pas). Il aime conduire ses hôtes dans son jardin et leur faire admirer le paysage. Les grandes heures sont celles du théâtre (« Rien n’anime plus la société, rien ne donne plus de grâce au corps et à l’esprit, rien ne forme plus le goût », dit-il). Installé à côté du château, il peut contenir 300 personnes. Voltaire et Mme Denis y jouent eux-mêmes leurs rôles préférés. Lutte contre l’injustice: Calas, Sirven et La Barre (1761-1765) Le 22 mars 1761, Voltaire est informé que, par ordre du parlement de Toulouse, un vieux commerçant protestant, nommé Calas, vient d’être roué, puis étranglé et brulé. Il aurait assassiné son fils, qui voulait se convertir au catholicisme. Voltaire apprend bientôt qu’en réalité Calas a été condamné sans preuves. Des témoignages le persuadent de son innocence. Convaincu qu’il s’agit d’une tragédie de l’intolérance, que les juges ont été influencés par le fanatisme ambiant, il entreprend la réhabilitation du supplicié et l’acquittement des autres Calas qui restent inculpés. Pendant trois ans (1762-1765), il mène une intense campagne: écrits, lettres, mettent en mouvement tout ce qui a de l’influence en France et en Europe. C’est à partir de l’affaire Calas que le mot d’ordre « Écrasez l’Infâme » (chez Voltaire, la superstition, le fanatisme et l’intolérance), abrégé à l’usage en Ecr.linf., apparaît dans sa correspondance à la fin de ses lettres. Il élève le débat par un Traité sur la tolérance (1763). Une sentence d’un parlement n’étant pas susceptible d’appel, le seul recours est le Conseil du royaume, présidé par le roi. Seul Voltaire a assez de prestige pour saisir une telle instance. De Ferney, n’ayant que son écritoire et son papier, il parvient à faire casser l’arrêt du Parlement et à faire indemniser la famille. « Par lui – par lui seul – le procès Calas deviendra l’affaire Calas, une de ces affaires qui marquent la conscience des hommes », écrit René Pomeau. Il réussit de même à faire réhabiliter Sirven, un autre protestant condamné par contumace le 20 mars 1764 à être pendu, avec sa femme, pour le meurtre de leur fille que l’on savait folle et qu’on trouva noyée dans un puits. On accusait son père et sa mère de l’avoir assassinée pour l’empêcher de se convertir. Les deux parents vont solliciter Voltaire qui obtient leur acquittement après un long procès. L’affaire La Barre surpasse en horreur celles de Calas et de Sirven. À Abbeville, le 9 août 1765, on découvre en pleine ville, sur le Pont-Neuf, un crucifix de bois mutilé. Une enquête est ouverte. Les soupçons se portent sur un groupe de jeunes gens qui se sont fait remarquer en ne se découvrant pas devant la procession du Saint-Sacrement, en chantant des chansons obscènes et en affectant de lire le Dictionnaire philosophique de Voltaire. Deux s’enfuient. Le chevalier de La Barre, âgé de 19 ans, est condamné à avoir la langue coupée, puis à être décapité et brulé. Le Parlement de Paris confirme la sentence. L’exécution a lieu le 1er juillet 1766. Le Dictionnaire philosophique est brulé en même temps que le corps et la tête du condamné. Voltaire rédige l’exposé détaillé de l’affaire, fait ressortir le scandale, provoque un revirement de l’opinion. Le juge d’Abbeville est révoqué, les coïnculpés acquittés. « Ce sang innocent crie, et moi je crierai aussi ; et je crierai jusqu’à ma mort » écrit Voltaire à d’Argental. Son engagement pour combattre l’injustice va durer jusqu’à sa mort (réhabilitation posthume de Lally-Tollendal, affaires Morangiés, Monbailli, serfs du Mont-Jura). « Il faut dans cette vie combattre jusqu’au dernier moment », déclare-t-il en 1775. Le Dictionnaire portatif (1764-1768) À Ferney, Voltaire va s’affirmer comme le champion de la « philosophie », cette pensée des Lumières portée par de très nombreux individus—mais dispersés et constamment engagés entre eux en d’âpres discussions. Sa production imprimée pendant ces années va être considérable. « J’écris pour agir », affirme-t-il. Il veut gagner ses lecteurs à la cause des Lumières. Il choisit pour sa propagande des œuvres « utiles et courtes ». Contrairement à L’Encyclopédie, avec ses gros volumes facilement bloqués chez l’éditeur, il privilégie les brochures de quelques pages qui se dissimulent aisément, échappent aux perquisitions de la douane et de la police et se vendent pour quelques sous. À Paris, il peut compter sur une équipe de fidèles, en premier lieu d’Alembert, futur secrétaire de l’Académie française, dont les relations mondaines et littéraires lui sont de précieux atouts, et qui n’hésite pas à le mettre en garde ou à corriger ses erreurs, mais aussi Grimm, Mme d’Épinay, Helvétius, Marmontel, Mme du Deffand, et aussi sur des appuis politiques comme Richelieu ou Choiseul (qui ne sont ni philosophes, ni libéraux, mais à qui Voltaire plaît). Quand il s’installe à Ferney, la diffusion clandestine de Candide, son chef-d’œuvre, a commencé. « Jamais Voltaire n’a aussi bien exprimé le monde tel que le voit son humeur: vision désolée et gaie, décapante mais tonique » écrit René Pomeau, qui calcule qu’il a dû se vendre en 1759 environ 20 000 Candide, chiffre énorme à l’époque où L’Encyclopédie même ne dépasse pas 4 000 exemplaires. En France, le pouvoir et les milieux conservateurs ont lancé une campagne contre les idées nouvelles: interdiction de L’Encyclopédie, discours de Le Franc de Pompignan à l’Académie, comédie de Palissot contre les philosophes au Théâtre-Français, attaques de Fréron, grand journaliste et polémiste redoutable. De Ferney, Voltaire organise la contre-offensive: articles, brochures, petits vers (l’épigramme contre Fréron est restée célèbre: L’autre jour au fond d’un vallon, /Un serpent piqua Jean Fréron ;/Que croyez-vous qu’il arriva ?/Ce fut le serpent qui creva.), comédies, pièces, tout est bon pour faire taire les ennemis des philosophes. En 1764, le Dictionnaire philosophique portatif, bilan de la réflexion philosophique de Voltaire, en même temps qu’outil pédagogique destiné au public cultivé, se répand, toujours clandestinement, en Europe. Considéré comme impie, il est condamné en France par le Parlement le 19 mars 1765 (Louis XV, après avoir pris connaissance du livre aurait demandé: « Est-ce qu’on ne peut pas faire taire cet homme-là ? »), mais aussi à Genève et à Berne où il est brûlé. Manifeste des Lumières (Voltaire en donne quatre nouvelles éditions de 1764 à 1769 chaque fois enrichies d’articles nouveaux), le Dictionnaire est composé de textes brefs et vifs, rangés dans l’ordre alphabétique. « Ce livre n’exige pas une lecture suivie », écrit Voltaire en tête de volume, « mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir ». De 1770 à 1774, le Dictionnaire... est prolongé et considérablement enrichi sous le titre Questions sur l’Encyclopédie. Dernières années (1768-1778) Le déiste toujours en lutte (1768-1769) « J’ai été pendant 14 ans l’aubergiste de l’Europe », écrit-il à Madame du Deffand. Ferney se trouve sur l’axe de communication de l’Europe du Nord vers l’Italie, itinéraire du Grand Tour de l’aristocratie européenne au XVIIIe siècle. Les visiteurs affluent pour le voir et l’entendre. Les plus nombreux sont les Anglais qui savent que le philosophe aime l’Angleterre (trois ou quatre cents affirme Voltaire), mais il y a aussi des Français, des Allemands, des Italiens, des Russes. Leurs témoignages permettent de connaître la vie quotidienne à Ferney. À Ferney, l’artiste genevois Jean Huber, devenu un familier de la maison, a fait d’innombrables croquis et aquarelles de Voltaire, à la fois comique et familier, dans l’ordinaire de sa vie quotidienne. En 1768, l’impératrice Catherine II lui commande un cycle de peintures voltairiennes dont neuf toiles sont conservées au musée de l’Ermitage. Les capitaux que Voltaire investit tirent Ferney de la misère. Dès son arrivée, il améliore la production agricole, draine les marécages, plante des arbres, achète une nouveauté dont il est fier, la charrue à semoir et donne l’exemple en labourant lui-même chaque année un de ses champs. Il fait construire des maisons pour accueillir de nouveaux habitants, développe des activités économiques, soieries, horlogerie surtout. « Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1 200 personnes utiles », peut-il écrire en 1777. À la fin des années 1990, l’État français a acheté le château de Ferney-Voltaire qui est administré par le Centre des monuments nationaux. En cours de restauration, seuls le parc et l’orangerie sont ouverts à la visite durant les travaux. La réouverture du château est prévue au printemps 2018. Dans l’expectative (1769-1773) Bien avant la mort de Louis XV, Voltaire souhaite revenir à Paris après une absence de près de 28 ans. Le dernier combat (1773-1776) Depuis le début de février 1773, Voltaire souffre d’un cancer de la prostate (diagnostic rétrospectif établi de nos jours grâce au rapport de l’autopsie pratiquée le lendemain de son décès). La dysurie est majeure, les accès de fièvre fréquents ainsi que les pertes de connaissance. Les jambes gonflées font parler d’hydropisie (affection dont son probable père biologique serait mort en 1719). Le 8 mai, il informe d’Alembert: « Je vois la mort au bout de mon nez ». Les mictions sont difficiles. L’été 1773, des forces reviennent, mais la crise de rétention aiguë d’urines de février 1773, le reprend en mars 1774. En mai 1774, il perd sa plus jeune nièce de tuberculose, Élisabeth, marquise de Florian (ex Mme de Fontaine, née Mignot). Suit, moins triste pour Voltaire, la mort de Louis XV de petite vérole le 10 mai 1774. Le dernier acte (1776-1778) Les nouvelles autorités font comprendre à ses amis qu’on fermerait les yeux s’il se rendait aux répétitions parisiennes de sa dernière tragédie. Après beaucoup d’hésitations, il décide de rallier la capitale en février 1778 à l’occasion de la création d’Irène à la Comédie-Française. Il arrive le 10 février et s’installe dans un bel appartement de l’hôtel du marquis de Villette (qui a épousé en 1777 sa fille adoptive, Mlle de Varicourt surnommée « Belle et Bonne ») au coin de la rue de Beaune et du quai des Théatins (aujourd’hui quai Voltaire). Dès le lendemain de son arrivée, Voltaire a la surprise de voir des dizaines de visiteurs envahir la demeure du marquis de Villette qui va devenir pendant tout son séjour le lieu de rendez-vous du Tout-Paris « philosophe ». Le 30 mars 1778 est le jour de son triomphe à l’Académie, à la Comédie-Française et dans les rues de Paris. Sur son parcours, une foule énorme l’entoure et l’applaudit. L’Académie en corps vient l’accueillir dans la première salle. Il assiste à la séance, assis à la place du directeur. À la sortie, la même foule immense l’attend et suit le carrosse. On monte sur la voiture, on veut le voir, le toucher. À la Comédie-Française, l’enthousiasme redouble. Le public est venu pour l’auteur, non pour la pièce. La représentation d’Irène est constamment interrompue par des cris. À la fin, on lui apporte une couronne de laurier dans sa loge et son buste est placé sur un piédestal au milieu de la scène. À la sortie, il est retenu longtemps à la porte par la foule qui réclame des flambeaux pour mieux le voir. On s’exclame: « Vive le défenseur des Calas! ». Voltaire peut mesurer ce soir-là l’indéniable portée de son action, même si la cour, le clergé et l’opinion antiphilosophique lui restent hostiles et se déchaînent contre lui et ses amis philosophes, ennemis de la religion, des « bonnes » mœurs et de la monarchie. La maladie (mars-mai 1778) Voltaire a 83 ans. Atteint d’un mal qui progresse insidieusement pour entrer dans sa phase finale le 10 mai 1778, Voltaire se comporte comme s’il était indestructible. Son état de santé et son humeur changent pourtant d’un jour à l’autre. Il envisage son retour à Ferney pour Pâques, mais il se sent si bien à Paris qu’il pense sérieusement à s’y fixer. Madame Denis, ravie, part à la recherche d’une maison. Il veut se prémunir contre un refus de sépulture. Dès le 2 mars, il fait venir un obscur prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice, l’abbé Gaultier, à qui il remet une confession de foi minimale (qui sera rendue publique dès le 11 mars) en échange de son absolution. Le 28 mars, il écrit à son secrétaire Wagnière les deux lignes célèbres: « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, et en détestant la superstition ». À partir du 10 mai 1778, malgré l’assistance du docteur Théodore Tronchin, ses souffrances deviennent intolérables. Pour calmer ses douleurs, il prend de fortes doses d’opium qui le font sombrer dans une somnolence entrecoupée de phases de délire. Mais une fois passée l’action de l’opium, le mal se réveille pire que jamais. La conversion de Voltaire, au sommet de sa gloire, aurait constitué une grande victoire de l’Église sur la « secte philosophique ». Le curé de Saint-Sulpice et l’archevêque de Paris, désavouant l’abbé Gaultier, font savoir que le mourant doit signer une rétractation franche s’il veut obtenir une inhumation en terre chrétienne. Mais Voltaire refuse de se renier. Des tractations commencent entre la famille et les autorités soucieuses d’éviter un scandale. Un arrangement est trouvé. Dès la mort de Voltaire on le transportera « comme malade » à Ferney. S’il décède pendant le voyage, son corps sera conduit à destination. Voltaire meurt le 30 mai dans l’hôtel de son ami le marquis de Villette, « dans de grandes douleurs, excepté les quatre derniers jours, où il a fini comme une chandelle », écrit Mme Denis. Le 31 mai, selon sa volonté, M. Try, chirurgien, assisté d’un M. Burard, procède à l’autopsie. Le corps est ensuite embaumé par M. Mitouart, l’apothicaire voisin qui obtient de garder le cerveau, le cœur revenant à Villèle (voir en Informations complémentaires l’histoire de ces deux organes). Le neveu de Voltaire, l’abbé Mignot, ne veut pas courir le risque d’un transport à Ferney. Il a l’idée de l’enterrer provisoirement dans la petite abbaye de Sellières près de Romilly-sur-Seine, dont il est abbé commendataire. Le 31 mai, le corps de Voltaire embaumé est installé assis, tout habillé et bien ficelé, avec un serviteur, dans un carrosse qui arrive à Scellières le lendemain après-midi. Grâce au billet de confession signé de l’abbé Gaultier, il est inhumé religieusement dans un caveau de l’église avant que l’évêque de Troyes, averti par l’archevêque de Paris Christophe de Beaumont, n’ait eu le temps d’ordonner au prieur de Scellières de surseoir à l’enterrement. Le Panthéon Après la mort de Voltaire, Mme Denis, légataire universelle, vend Ferney à Villette (la bibliothèque, acquise par Catherine II, est convoyée jusqu’à Saint-Pétersbourg par Wagnière). Villette, s’apercevant que le domaine est lourdement déficitaire, le revend en 1785. Le transfert de la sépulture à Ferney devient impossible. L’abbé Mignot veut commander un mausolée pour orner la dalle anonyme sous laquelle repose Voltaire, mais les autorités s’y opposent. En 1789, l’Assemblée constituante vote la nationalisation des biens du clergé. L’abbaye de Sellières va être mise en vente. Il faut trouver une solution. Villette fait campagne pour le transfert à Paris des restes du grand homme (il a déjà débaptisé de sa propre autorité le quai des Théatins en y apposant une plaque: « Quai Voltaire »). C’est lui qui lance le nom de Panthéon et désigne le lieu, la basilique de Sainte-Geneviève. Le 30 mai 1791, jour anniversaire de sa mort, l’Assemblée, malgré de fortes oppositions (les membres du clergé constituent le quart des députés) décide le transfert. Le 4 avril, après la mort de Mirabeau survenue le 2, l’Assemblée décrète que « le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes ». Mirabeau est le premier « panthéonisé ». Voltaire le suit le 11 juillet. Comme le corps de Mirabeau fut retiré de ce monument des suites de la découverte de l’armoire de fer, Voltaire est devenu le plus ancien hôte du Panthéon. Le cortège comprend des formations militaires, puis des délégations d’enfants. Derrière une statue de Voltaire d’après Houdon, portée par des élèves des beaux-arts costumés à l’antique, viennent les académiciens et gens de lettres, accompagnés des 70 volumes de l’édition de Kehl, offerts par Beaumarchais. Sur le sarcophage se lit une inscription: « Il vengea Calas, La Barre, Sirven et Monbailli. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l’esprit humain, et nous a préparés à être libres ». L’œuvre de Voltaire Œuvres complètes de Voltaire, Paris, édition Garnier, 50 volumes, 1877 (Wikisource) La production littéraire de Voltaire inclut le théâtre, l’histoire, la philosophie, la poésie, des contes, de nombreux textes polémiques, et une grande correspondance. De son vivant, ses Œuvres complètes comptent 40 volumes in-8° (édition de Genève de 1775). Après sa mort, l’édition de Kehl commanditée par Beaumarchais et éditée entre 1784 et 1789, inclut sa correspondance qui rajoute 30 volumes in-8° (malgré le fait que de nombreux détenteurs de lettres ont refusé de les communiquer). L’édition en cours de publication à Oxford en comptera près de 200[réf. nécessaire]. Les contes philosophiques Voltaire n’attribuait à ses contes qu’une faible importance, mais c’est sans doute aujourd’hui la partie de son œuvre la plus éditée et la plus lue. « C’est là que l’on retrouve, aussi libre que dans sa correspondance, l’esprit de Voltaire » écrit René Pomeau. Ils font partie des textes incontournables du XVIIIe siècle et occupent une place de choix au sein de la culture française. Ce sont, entre autres, le Songe de Platon, Micromégas, Le Monde comme il va, Zadig, Les Deux Consolés, Candide, l’Histoire d’un bon bramin, Jeannot et Colin, L’Ingénu, L’Homme aux quarante écus, Le Taureau blanc, Les Dialogues d’Evhémère. La correspondance Exilé à Ferney, Voltaire correspond avec tout ce qui compte en Europe. L’abondance de sa correspondance (de l’ordre de 23 000 lettres retrouvées, 13 tomes dans la bibliothèque de la Pléiade) rend nécessaire la publication de lettres choisies. Citons, entre autres, la correspondance suivie avec Madame du Deffand, âgée et aveugle, sceptique désabusée et lucide qui réunit dans son salon tout le grand monde parisien (« avec Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette époque » selon Sainte-Beuve). « Le pessimisme de Mme du Deffand est tellement absolu », écrit Benedetta Craveri, « qu’il oblige son correspondant à se prononcer sur le destin de l’homme, avec une précision qu’on ne retrouve pas dans le reste de son œuvre ». « C’est dans ses lettres qu’il faut chercher l’expression la plus intime de la philosophie de Voltaire ; sa manière d’accepter la vie et d’affronter la mort, ses idées métaphysiques et son scepticisme, ses luttes passionnées au nom de l’humanité et ses accès de résignation mystiques ». Les écrits philosophiques Voltaire n’apporte pas de réponses rassurantes, mais enseigne à douter, parce que c’est par le doute que l’on apprend à penser. La partie philosophique de son œuvre est toujours actuelle: Les Lettres philosophiques, le Traité sur la tolérance, le Dictionnaire philosophique portatif, les Questions sur l’Encyclopédie. Le théâtre Le théâtre de Voltaire, qui a fait sa gloire et passionné ses contemporains, est aujourd’hui largement oublié. Voltaire a cependant été le plus grand auteur dramatique du XVIIIe siècle et a régné sur la scène de la Comédie-Française de 1718 à sa mort. Il a écrit une cinquantaine de tragédies qui, selon l’estimation de René Pomeau, ont été applaudies, rarement sifflées, par environ deux millions de spectateurs. À Paris, ses plus grands succès sont, dans l’ordre, Zaïre (1732), Alzire, (1736), Mérope (1743), Sémiramis (1748), Œdipe (1718), Tancrède (1760), L’Orphelin de la Chine (1755) et Mahomet (1741). L’œuvre poétique La versification, pratiquée dès l’enfance, était devenue pour Voltaire un mode d’écrire naturel. Sa production poétique a été évaluée à 250 000 vers. Il n’avait pas son pareil pour manier l’alexandrin. Longtemps il sera pour ses contemporains l’auteur de La Henriade que Beaumarchais place au même niveau que l’Iliade et qui connaitra encore 67 éditions entre 1789 et 1830 avant d’être rejetée dans l’oubli par le Romantisme. Cette œuvre versifiée (La Pucelle d’Orléans, Le Mondain, le Poème sur le désastre de Lisbonne) est moins lisible pour nous aujourd’hui, mais il existe, en particulier à travers ses épitres, un Voltaire poète de la gaîté et du sourire, à la verve inventive, inspiré souvent par l’esprit satirique. L’œuvre historique Elle ne survit (Le Siècle de Louis XIV, Histoire de Charles XII, Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand), comme celle de Michelet, que parce qu’elle est l’œuvre d’un écrivain, même si sa perspective de l’histoire « philosophique » (Essai sur les mœurs et l’esprit des nations), consistant à suivre les efforts des hommes en société pour sortir de l’état primitif, reste valable. L’œuvre scientifique Elle est périmée même si Voltaire fut l’un des pionniers du newtonisme avec ses Éléments de la philosophie de Newton (1738). La morale de Voltaire Le libéralisme Dans la pensée du philosophe anglais John Locke, Voltaire trouve une doctrine qui s’adapte parfaitement à son idéal positif et utilitaire. John Locke apparaît comme le défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social ne supprime pas les droits naturels des individus. En outre, c’est l’expérience seule qui nous instruit ; tout ce qui la dépasse n’est qu’hypothèse ; le champ du certain coïncide avec celui de l’utile et du vérifiable. Voltaire tire de cette doctrine la ligne directrice de sa morale: la tâche de l’homme est de prendre en main sa destinée, d’améliorer sa condition, d’assurer, d’embellir sa vie par la science, l’industrie, les arts et par une bonne « police » des sociétés. Ainsi, la vie en commun ne serait pas possible sans une convention où chacun trouve son compte. Bien que s’exprimant par des lois particulières à chaque pays, la justice, qui assure cette convention, est universelle. Tous les hommes sont capables d’en concevoir l’idée, d’abord parce que tous sont des êtres plus ou moins raisonnables, ensuite parce qu’ils sont tous capables de comprendre que ce qui est utile à la société est utile à chacun. La vertu, « commerce de bienfaits, leur est dictée à la fois par le sentiment et par l’intérêt. Le rôle de la morale, selon Voltaire, est de nous enseigner les principes de cette « police » et de nous accoutumer à les respecter. Cependant, la conception oligarchique et hiérarchisée de la société de Voltaire ne nous permet pas de le situer clairement parmi les philosophes du libéralisme démocratique: il affirme également dans Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations: « Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace ; elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains: l’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne. Certainement cet esprit de la nation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit sur la terre ». Le déisme Étranger à tout dogmatisme religieux, Voltaire se refuse toutefois à l’athéisme d’un Diderot ou d’un d’Holbach. Il ne cessa de répéter son fameux distique: Ainsi, selon Voltaire, l’ordre de l’univers peut-il nous amener à constater l’existence d’un « éternel géomètre ». C’est pour lui une évidence rationnelle: un effet ne peut exister sans qu’il y ait aussi une cause préalable, de même que la lumière naturelle ne peut exister sans tirer son origine du soleil – ou qu’une bougie ne peut être allumée sans qu’un « athée » ait auparavant décidé d’enflammer sa mèche ; ce que Voltaire nomme « Dieu », c’est la Cause ultime, absolue qui ordonne éternellement et présentement tous les desseins cosmiques: le soleil est ainsi « fait pour éclairer notre portion d’univers ». Sa vision de Dieu correspond à un panthéisme, proche de Giordano Bruno et de Baruch Spinoza ; dans Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche, Voltaire écrit: « Une cause sans effet est une chimère, une absurdité, aussi bien qu’un effet sans cause. Il y a donc éternellement, et il y aura toujours des effets de cette cause universelle. Ces effets ne peuvent venir de rien ; ils sont donc des émanations éternelles de cette cause éternelle. La matière de l’univers appartient donc à Dieu tout autant que les idées, et les idées tout autant que la matière. Dire que quelque chose est hors de lui, ce serait dire qu’il y a quelque chose hors de l’infini. Dieu étant le principe universel de toutes les choses, toutes existent en lui et par lui.(...) On ne fait point Dieu l’universalité des choses: nous disons que l’universalité des choses émane de lui ; et pour nous servir (...) de l’indigne comparaison du soleil et de ses rayons, nous disons qu’un trait de lumière lancé du globe du soleil, et absorbé dans le plus infect des cloaques, ne peut laisser aucune souillure dans cet astre. Ce cloaque n’empêche pas que le soleil ne vivifie toute la nature dans notre globe.(...) Nous pourrions dire encore qu’un trait de lumière, pénétrant dans la fange, ne se mêle point avec elle, et qu’elle y conserve son essence invisible ; mais il vaut mieux avouer que la lumière la plus pure ne peut représenter Dieu. La lumière émane du soleil, et tout émane de Dieu. Nous ne savons pas comment ; mais nous pouvons (...) concevoir Dieu comme l’Être nécessaire de qui tout émane. [Note: « nécessaire » signifie philosophiquement: « qui ne peut pas ne pas être – ni être autrement »]. » Mais, au-delà, il ne voit qu’incertitudes: « J’ai contemplé le divin ouvrage, et je n’ai point vu l’ouvrier ; j’ai interrogé la nature, elle est demeurée muette ». Il conclut: « Il m’est impossible de nier l’existence de ce Dieu », ajoutant qu’il est « impossible de le connaître ». Il rejette toute incarnation, « tous ces prétendus fils de Dieu ». Ce sont « des contes de sorciers ». « Un Dieu se joindre à la nature humaine! J’aimerais autant dire que les éléphants ont fait l’amour à des puces, et en ont eu de la race: ce serait bien moins impertinent ». S’il reste attaché au déisme, qui correspond à un théisme philosophique, il dénonce comme dérisoire le providentialisme (dans Candide par exemple) et repose cette question formulée dès saint Augustin dont la réponse est inaccessible à la logique humaine parfaitement limitée: « Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon ? ». Voltaire n’apporte à ce sujet que cette précision: « La terre est couverte de crimes (...) ; cela empêche-t-il qu’il y ait une cause universelle ? (...) Il y a une suite infinie de vérités, et l’Être infini peut seul comprendre cette suite. (...) Demander pourquoi il y a du mal sur terre, c’est demander pourquoi nous ne vivons pas autant que les chênes. (...) Le grand Être est fort ; mais les émanations sont nécessairement faibles. Servons-nous (...) de la comparaison du soleil. Ses rayons réunis fondent les métaux ; mais quand vous réunissez ceux qu’il a dardés sur le disque de la lune, ils n’excitent pas la plus légère chaleur. Nous sommes aussi nécessairement bornés que le grand Être est nécessairement immense. » —Voltaire, Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche. Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique, affirme que l’authentique miracle est l’ordre du monde, que l’apparition divine en ce monde est la nature des choses et non ce qui semble « surnaturel »: « Un miracle, selon l’énergie du mot, est une chose admirable. En ce cas, tout est miracle. L’ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d’un million de soleils, l’activité de la lumière, la vie des animaux sont des miracles perpétuels. Selon les idées reçues, nous appelons miracle la violation de ces lois divines et éternelles. (…) Plusieurs physiciens soutiennent qu’en ce sens il n’y a point de miracles ; (…) un miracle est la violation des lois mathématiques divines, immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une contradiction dans les termes. Une loi ne peut être à la fois immuable et violée. Mais, une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue par son auteur ? Ils ont la hardiesse de répondre que non. » Enfin, pour Voltaire, la croyance en un Dieu est utile sur le plan moral et social. Il est l’auteur du célèbre alexandrin: On lui attribue aussi cette phrase: « Nous pouvons, si vous le désirez, parler de l’existence de Dieu, mais comme je n’ai pas envie d’être volé ni égorgé dans mon sommeil, souffrez que je donne au préalable congé à mes domestiques ». L’humanisme Dès La Henriade en 1723, toute l’œuvre de Voltaire est un combat contre le fanatisme et l’intolérance: « On entend aujourd’hui par fanatisme une folie religieuse, sombre et cruelle. C’est une maladie qui se gagne comme la petite vérole. » Dictionnaire philosophique, 1764, article « Fanatisme ». Il a en tout cas lutté contre le fanatisme, celui de l’Église catholique romaine comme celui du protestantisme, symboles à ses yeux d’intolérance et d’injustice. Tracts, pamphlets, tout fut bon pour mobiliser l’opinion publique européenne. Il a aussi misé sur le rire pour susciter l’indignation: l’humour, l’ironie deviennent des armes contre la folie meurtrière qui rend les hommes malheureux. Les ennemis de Voltaire avaient d’ailleurs tout à craindre de son persiflage, mais parfois les idées nouvelles aussi. Quand en 1755, il reçoit le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, qui désapprouve l’ouvrage, répond en une lettre aussi habile qu’ironique: « J’ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. […] On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. […] » (Lettre à Rousseau, 30 août 1755) Le « patriarche de Ferney » représente éminemment l’humanisme militant du XVIIIe siècle. Selon Sainte-Beuve, « […] tant qu’un souffle de vie l’anima, il eut en lui ce que j’appelle le bon démon: l’indignation et l’ardeur. Apôtre de la raison jusqu’au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant ». Sa correspondance compte plus de 23 000 lettres connues ainsi qu’un gigantesque Dictionnaire philosophique qui reprend les axes principaux de son œuvre, une trentaine de contes philosophiques et des articles publiés dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Cependant, son théâtre, qui l’avait propulsé au premier rang de la scène littéraire (Mérope, Zaïre et d’autres), ainsi que sa poésie (La Henriade, considérée comme la seule épopée française au XVIIIe siècle) sont oubliés. C’est à Voltaire, avant tout autre, que s’applique ce que Condorcet disait des philosophes du XVIIIe siècle, qu’ils avaient « pour cri de guerre: raison, tolérance, humanité ». La justice Voltaire s’est passionné pour plusieurs affaires et s’est démené afin que justice soit rendue. L’affaire Calas (1762) L’affaire Sirven (1764) L’affaire du chevalier de La Barre (1766) L’affaire Lally-Tollendal (1776) La liberté d’expression L’attachement de Voltaire à la liberté d’expression serait illustré par la très célèbre citation qu’on lui attribue à tort: « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Certains commentateurs (Norbert Guterman, A Book of French Quotations, 1963), prétendent que cette citation est extraite d’une lettre du 6 février 1770 à un abbé Le Riche où Voltaire écrirait: « Monsieur l’abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire ». En fait, cette lettre existe, mais la phrase n’y figure pas, ni même l’idée. (Voir le texte complet de cette lettre à l’article Tolérance). Le Traité de la tolérance auquel est parfois rattachée la citation ne la contient pas non plus. De fait, la citation est absolument apocryphe (elle n’apparaît nulle part dans son œuvre publiée) et trouve sa source en 1906, non dans une citation erronée, mais dans un commentaire de l’auteure britannique Evelyn Hall, dans son ouvrage The Friends of Voltaire, où, pensant résumer la posture de Voltaire à propos de l’auteur d’un ouvrage publié en 1758 condamné par les autorités religieuses et civiles, elle écrivait « “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” was his attitude now » (« “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire” était désormais son attitude »). Les guillemets maladroitement utilisés par Evelyn Hall ont été interprétés comme permettant d’attribuer la déclaration à Voltaire. En 1935, elle déclara « I did not intend to imply that Voltaire used these words verbatim, and should be much surprised if they are found in any of his works » (« Je n’ai pas eu l’intention de suggérer que Voltaire avait utilisé exactement ces mots, et serais extrêmement surprise s’ils se trouvaient dans ses œuvres »),. L’affaire à propos de laquelle Evelyn Hall écrivait concernait la publication par Helvétius en 1758 de De l’Esprit, livre condamné par les autorités civiles et religieuses et brulé. Voici ce que Voltaire écrivait dans l’article « Homme » des Questions sur l’Encyclopédie: « J’aimais l’auteur du livre De l’Esprit. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n’ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu’il débite avec emphase. J’ai pris son parti hautement, quand des hommes absurdes l’ont condamné pour ces vérités mêmes. » Autre passage pertinent: « En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n’en connais point qui aient fait de mal réel. […] Mais paraît-il parmi vous quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous ayez des idées), ou dont l’auteur soit d’un parti contraire à votre faction, ou, qui pis est, dont l’auteur ne soit d’aucun parti: alors vous criez au feu ; c’est un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà un homme abominable, qui a imprimé que si nous n’avions point de mains, nous ne pourrions faire des bas ni des souliers [Helvétius, De l’Esprit, I, 1]: quel blasphème! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s’assemblent, les alarmes se multiplient de collège en collège, de maison en maison ; des corps entiers sont en mouvement et pourquoi ? Pour cinq ou six pages dont il n’est plus question au bout de trois mois. Un livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez pas ». Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, article « Liberté d’imprimer ». La laïcité Même s’il n’utilise pas le mot « laïcité » en tant que tel, Voltaire est, néanmoins, non seulement par ses écrits mais aussi par ses démarches visant à rétablir une justice impartiale dénuée d’intérêt communautaire, un des instigateurs d’un civisme équidistant envers toutes les attitudes religieuses et opinions métaphysiques (athéisme compris), civisme qui allait de pair avec son combat pour la liberté d’expression. À l’époque de Voltaire, en France, critiquer la religion, spécialement le christianisme, reste encore un exercice risqué, car la séparation entre l’Église et de l’État n’existe pas – et que l’Église demeure très puissante. Face à l’idéalisme aveugle et fanatique, Voltaire oppose la figure de l’homme laïc, nommé « Citoyen », vu comme l’ami de tous et du bien public, policé et ne manquant jamais d’humour pour faire valoir le droit commun à s’entre-tolérer au sein d’un État qui défend la culture philosophique et poétique – tout en refusant de promouvoir telle ou telle profession de foi: « Je suis citoyen et par conséquent l’ami de tous ces messieurs [de différentes confessions]. Je ne disputerai avec aucun d’eux ; je souhaite seulement qu’ils soient tous unis dans le dessein de s’aider mutuellement, de s’aimer et de se rendre heureux les uns les autres, autant que des hommes d’opinions si diverses peuvent s’aimer, et autant qu’ils peuvent contribuer à leur bonheur ; ce qui est aussi difficile que nécessaire. Pour cet effet, je leur conseille d’abord de jeter dans le feu (...) la Gazette ecclésiastique, et tous autres libelles qui ne sont que l’aliment de la guerre civile des sots. Ensuite chacun de nos frères, soit théiste, soit turc, soit païen, soit chrétien grec, ou chrétien latin, ou anglican, ou scandinave, soit juif, soit athée, lira attentivement quelques pages des Offices de Cicéron, ou de Montaigne, et quelques fables de La Fontaine. Cette lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde (...). On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission de courir dans le kaaba autour de la pierre noire, ni l’agrément de s’endurcir les genoux devant la Notre-Dame de Lorette, qui est plus noire encore. Dans toutes les disputes qui surviendront, il est interdit de se traiter de chien, quelque colère qu’on soit ; à moins qu’on ne traite d’hommes les chiens, quand ils nous emporteront notre dîner et qu’ils nous morderont, etc., etc., etc. » —Voltaire, Il faut prendre un parti, XXV Discours d’un Citoyen. Voltaire est par conséquent convaincu que les hommes (non parce que formant un groupe homogène, mais parce que liés entre eux par le civisme) peuvent s’allier un minimum pour œuvrer ensemble à la constitution d’une société équilibrée et équitable, même s’ils sont différents, de tous les bords culturels ; Voltaire conçoit donc une morale « civique » ou éthique « citoyenne », universelle et respectant la Liberté. Au doute de Blaise Pascal considérant, dans ses Pensées, qu’il est impossible que les hommes puissent se respecter entre eux hors de la sphère du christianisme (« Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau ; mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? »), Voltaire répond très simplement: « Dans cette seule maxime reçue de toutes les nations: « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. » » (Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, XLII) Théiste, Voltaire n’en condamne pas moins fermement – toujours dans le cadre de sa philosophie laïque – les idéalismes dogmatiques dévalorisant (pour le profit d’une quelconque abstraction ou « Dieu » illusoire) les existences, la vie, la nature et les relations sociales et familiales: « Pensées de Blaise Pascal: « S’il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures. » [Réponse de Voltaire:] Il faut aimer, et très tendrement, les créatures ; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants ; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu’à faire de barbares raisonneurs. » —Voltaire, Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, X. Le végétarisme Voltaire refusait de voir les êtres humains comme supérieurs, de par leur essence, aux autres espèces animales ; cela correspond à son rejet des religions abrahamiques (où l’animal est le plus souvent considéré comme inférieur à l’homme) et de la doctrine des « animaux-machines » du Discours de la méthode de René Descartes – qu’il déteste, et considère comme étant la « vaine excuse de la barbarie » permettant de dédouaner l’homme de tout sentiment de compassion face à la détresse animale. Voltaire commence à s’intéresser avec constance au végétarisme, et à sa défense, vers 1761-1762 environ ; diverses lectures sont en lien avec cette affirmation « pythagoricienne » de la part du philosophe (le terme de « végétarisme » n’existait pas à l’époque): le testament de Jean Meslier, l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, le Traité de Porphyre, touchant l’abstinence de la chair des animaux, ainsi que de nombreux ouvrages sur l’hindouisme (œuvres brahmaniques qui commencent à être traduites en français et étudiées dans les milieux intellectuels européens). Dans ses lettres, Voltaire déclare qu’il « ne mange plus de viande » « ni poisson », se définissant encore plus « pythagoricien » que Philippe de Sainte-Aldegonde, un végétarien qu’il reçut à Ferney, à côté de Genève. Chez Voltaire, le végétarisme n’est jamais justifié selon une logique liée à la santé, mais toujours pour des raisons éthiques: le végétarisme est une « doctrine humaine » et une « admirable loi par laquelle il est défendu de manger les animaux nos semblables ». Prenant comme exemple Isaac Newton, la compassion pour les animaux se révèle pour lui une solide base pour une « vraie charité » envers les hommes, et Voltaire affirme qu’on ne mérite « guère le nom de philosophe » si on ne possède point cette « humanité, vertu qui comprend toutes les vertus ». Dans Le Dialogue du chapon et de la poularde, Voltaire fait dire aux animaux que les hommes qui les mangent sont des « monstres », « monstres » humains qui, d’ailleurs, s’entretuent cruellement, aussi ; le chapon y fait l’éloge de l’Inde où « les hommes ont une loi sainte qui depuis des milliers de siècles leur défend de nous manger » ainsi que des philosophes antiques européens: « Les plus grands philosophes de l’Antiquité ne nous mettaient jamais à la broche. Ils tâchaient d’apprendre notre langage, et de découvrir nos propriétés si supérieures à celle de l’espèce humaine. Nous étions en sûreté comme à l’âge d’or. Les sages ne tuent point les animaux, dit Porphyre ; il n’y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. » —Voltaire, Le Dialogue du chapon et de la poularde. Dans La Princesse de Babylone, Voltaire fait dire à un oiseau que les animaux ont « une âme », tout comme les hommes. Et dans le Traité sur la tolérance (note du chapitre XII), Voltaire rappelle que la consommation de chair animale et de traiter les animaux comme de stricts objets ne sont point des pratiques universelles et qu’« il y a une contradiction manifeste à convenir que Dieu a donné aux bêtes tous les organes du sentiment, et à soutenir qu’il ne leur a point donné de sentiment. Il me paraît encore qu’il faut n’avoir jamais observé les animaux pour ne pas distinguer chez eux les différentes voix du besoin, de la souffrance, de la joie, de la crainte, de l’amour, de la colère, et de toutes les affections ». Dans l’Article « Viande » du Dictionnaire philosophique, Voltaire montre que Porphyre regardait « les animaux comme nos frères, parce qu’ils sont animés comme nous, qu’ils ont les mêmes principes de vie, qu’ils ont ainsi que nous des idées, du sentiment, de la mémoire, de l’industrie. » Le végétarisme de Voltaire s’affirme donc comme une posture philosophique opposée à toute attitude anthropocentrique. Le philosophe ne croit pas que l’humanité soit le centre de la création ou le sommet de la chaîne alimentaire – et que les animaux soient en dessous des nations humaines et comme uniquement « prédestinés » à servir de nourriture aux hommes: « Les moutons n’ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits et mangés, puisque plusieurs nations s’abstiennent de cette horreur ». Dans La Philosophie de l’histoire (chapitre XVII, « de l’Inde »), Voltaire défend la doctrine de la réincarnation des âmes (« métempsychose ») qui prévaut chez les Indiens (ou « Hindous »), dans les terres « vers le Gange », et qui est selon lui un « système de philosophie qui tient aux mœurs » inspirant « une horreur pour le meurtre et pour toute violence ». Cette considération voltairienne se retrouve aussi dans Les Lettres d’Amabed (« Seconde lettre d’Amabed à Shastadid »), où un jeune hindou de Bénarès, élève d’un missionnaire chrétien jésuite qui veut l’évangéliser et lui faire abjurer la foi de ses ancêtres, se désole de voir les Européens, colonisant l’Inde et commettant « des cruautés épouvantables pour du poivre », tuer des petits poulets. Cette posture morale végétarienne est pour Voltaire une occasion de relativiser les certitudes occidentales issues du christianisme, par une universalisation des références niant tout ethnocentrisme et tout anthropocentrisme. C’est aussi une occasion de louer les « Païens » et leur philosophie antique (grecque ou indienne) et de se moquer ouvertement du clergé chrétien et des institutions ecclésiastiques – convaincus de leur exemplarité –, qui font grand cas de détails dogmatiques infimes concernant les croyances à reconnaître ou à condamner (rappel de la haine entre Catholiques, Juifs et Protestants), mais qui refusent d’éduquer les masses à la clémence envers les animaux, sont incapables de promouvoir le végétarisme: « Je ne vois aucun moraliste parmi nous, aucun de nos loquaces prédicateurs, aucun même de nos tartufes, qui ait fait la moindre réflexion sur cette habitude affreuse [« se nourrir continuellement de cadavres » selon Voltaire]. Il faut remonter jusqu’au pieux Porphyre, et aux compatissants pythagoriciens pour trouver quelqu’un qui nous fasse honte de notre sanglante gloutonnerie, ou bien il faut voyager chez les brahmanes ; car, (...) ni parmi les moines, ni dans le concile de Trente, ni dans nos assemblées du clergé, ni dans nos académies, on ne s’est encore avisé de donner le nom de mal à cette boucherie universelle. » —Voltaire, Il faut prendre un parti (Du mal, et en premier lieu de la destruction des bêtes). Opposition à la vivisection Voltaire s’insurgea contre les pratiques de vivisection de son temps (l’expérimentation sur des animaux se généralisant avec le dogme des « animaux-machines » de Descartes, ainsi que dans les séminaires jansénistes): « Des barbares saisissent ce chien, qui l’emporte prodigieusement sur l’homme en amitié ; ils le clouent sur une table, et ils le dissèquent vivant pour te montrer les veines mézaraïques. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste ; la nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu’il ne sente pas ? A-t-il des nerfs pour être impassible ? Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature. » À propos de Voltaire et Rousseau « Le public a toujours pris plaisir à faire aller de pair ces deux hommes à jamais célèbres. Tous les deux, avec de si grands moyens, se sont proposé le même but, le bonheur du genre humain », écrit dès 1818 Bernardin de Saint-Pierre, l’ami de Rousseau, dans son Parallèle de Voltaire et de J.-J. Rousseau, premier d’une suite innombrable. Tout oppose les deux grandes figures des Lumières que la Révolution française a installé l’un à côté de l’autre au Panthéon, Voltaire en 1791, Rousseau en 1794. Voltaire est un fils de bourgeois parisien, sujet d’une monarchie absolue. Il reçoit une éducation classique dans le meilleur collège de la capitale. Son esprit se forme dans la fréquentation de la société du Temple et de la cour de Sceaux. Il aime l’argent, le luxe, le monde, le théâtre. Il fréquente les princes et les rois. Persuadé que la liberté d’esprit est inséparable de l’aisance matérielle, il devient riche et mène à Ferney une vie de seigneur. Il se pense en chef de parti, en responsable du clan philosophique. Son objectif est de faire pénétrer peu à peu les Lumières au sommet de l’État. C’est un écrivain engagé. Il est pessimiste mais d’humeur gaie. Déiste, il hait la religion chrétienne. Extraverti, il a horreur de l’introspection et parle peu de lui dans ses Mémoires. Esprit précis et positif, son arme est l’ironie et c’est à l’esprit qu’il s’adresse. Rousseau est un fils d’horloger genevois, citoyen d’une république. Il est autodidacte et campagnard. Il aime la vie simple, le travail humble, la solitude, la nature. S’il bénéficie, comme beaucoup de gens de lettres, de la protection des grands (prince de Conti, maréchal de Luxembourg), il ne veut pas des bienfaits dont la société est prête à l’accabler. Il reste pauvre, persuadé qu’il se met moralement du bon côté et gagne son pain en copiant de la musique. Chez lui, tout est adhésion individuelle à une doctrine élaborée par un individu unique. Ce n’est pas un écrivain engagé. Il est foncièrement optimiste mais d’humeur ombrageuse. Protestant de Genève, il reste toujours chrétien par le cœur, sinon par le dogme et la conduite. Égotiste, il se livre intimement dans ses Confessions. Il a l’âme poétique, rêveuse, aisément émue. Son arme, c’est l’éloquence, et c’est au sentiment qu’il parle. Les deux hommes ont entretenu longtemps des relations courtoises avant leur rupture en 1760. Rousseau, qui admire Voltaire, lui envoie en 1755 son Discours sur l’inégalité qui fait suite à son Discours sur les sciences et les arts de 1750. Il lui rend « l’hommage que nous vous devons tous comme à notre chef ». La critique de la civilisation, la dénonciation du « luxe », de l’inégalité sociale et de la propriété, l’exaltation du primitivisme de Rousseau ne peuvent que rencontrer l’incompréhension de Voltaire. Mais Rousseau participe au combat philosophique, c’est un ami de Diderot et d’Alembert, un collaborateur de l’Encyclopédie. Voltaire lui répond ironiquement: « J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie (…) On n’a jamais tant employé d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre ». Rousseau répond sans acrimonie. Leur échange de lettres est publié dans le Mercure de 1755. En 1756, lorsque Voltaire envoie à Rousseau son Poème sur le désastre de Lisbonne, l’incompréhension est cette fois du côté de ce dernier. Il répond: « Rassasié de gloire et désabusé des vaines grandeurs, vous vivez libre au sein de l’abondance: vous ne trouvez pourtant que mal sur terre ; et moi, homme obscur, pauvre, tourmenté d’un mal sans remède, je médite avec plaisir dans ma retraite et trouve que tout est bien. D’où viennent ces contradictions apparentes ? Vous l’avez-vous-même expliqué: vous jouissez, moi j’espère, et l’espérance adoucit tout ». Voltaire ne répond pas sur le fond. Dans les Confessions, Rousseau dit que la véritable réponse lui fut donnée avec Candide (1759). En 1758, à la suite de la parution de l’article de D’Alembert, « Genève », dans l’Encyclopédie, Rousseau publie sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Il rompt à cette occasion avec Diderot, l’ami de ses débuts et avec les Encyclopédistes. Visant Voltaire qui milite pour faire autoriser la comédie à Genève (elle le sera en 1783), il reprend la thèse de son premier Discours: le théâtre à Genève favoriserait le luxe, accroîtrait l’inégalité, altérerait la liberté et affaiblirait le civisme. Pour Voltaire, nier la valeur morale et humaine du théâtre, c’est nier l’évidence. Mais il ne veut pas répondre. « Moi », écrit-il à d’Alembert, « je fais comme celui qui pour toute réponse à des arguments contre le mouvement se mit à marcher. Jean-Jacques démontre qu’un théâtre ne peut convenir à Genève, et moi j’en bâtis un (Il s’agit de l’ouverture d’une salle de spectacle dans son château de Tourney en 1760) ». L’affrontement est cependant resté courtois jusqu’à la véritable déclaration de guerre (publiée plus tard dans les Confessions, livre X) que Rousseau adresse à Voltaire le 17 juin 1760: « Je ne vous aime point, Monsieur ; vous m’avez fait tous les maux qui pouvaient m’être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève, pour le prix de l’asile que vous y avez reçu ; vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux ; c’est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable ; c’est vous qui me ferez mourir en terre étrangère (…) Je vous hais, enfin, puisque vous l’avez voulu ; mais je vous hais en homme plus digne de vous aimer si vous l’aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous il n’y reste que l’admiration qu’on ne peut refuser à votre beau génie, et l’amour de vos écrits ». Cette fois, Voltaire est ulcéré: « Une telle lettre de la part d’un homme avec qui je ne suis pas en commerce me paraît merveilleusement folle, absurde et offensante », écrit-il à Mme du Deffand, « Comment un homme qui a fait des comédies peut-il me reprocher d’avoir fait des spectacles chez moi en France ? Pourquoi me fait-il l’outrage de me dire que Genève m’a donné un asile ? Je n’ai pas assurément besoin d’asile, et j’en donne quelquefois (…) il imprime que je suis le plus adroit et le plus violent de ses persécuteurs. Je ne crois pas qu’on puisse faire à un homme injure plus atroce que de l’appeler persécuteur ». À la parution en 1761 du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloise (l’un des grands succès d’édition du siècle), il se venge dans un pamphlet, trouvant « sot, bourgeois, impudent, ennuyeux » ce récit en six tomes qui ne contient que « trois à quatre pages de faits et environ mille de discours moraux ». Les choses sérieuses commencent en 1762, lorsque, Rousseau décrété de prise de corps après la publication de ses grands ouvrages, le Contrat social et l’Émile, doit s’enfuir de France. À Genève, l’auteur est menacé d’arrestation s’il vient dans la ville et ses livres sont brulés. Pour Rousseau, malade, déprimé, ces persécutions sont le résultat, direct ou indirect, de l’influence dont jouit Voltaire à Genève comme à Paris. Dans les Lettres sur la Montagne, il accuse Voltaire d’être l’auteur du Sermon des cinquante, libelle anonyme profondément antichrétien paru en 1762, d’être complice de ses persécuteurs, de préférer au raisonnement la plaisanterie, de publier des ouvrages abominables et de ne pas croire en Dieu. Voltaire répond par un libelle anonyme (Rousseau n’a jamais su qu’il en était l’auteur), le Sentiment des Citoyens où il suggère l’exécution de Rousseau, révélant que l’auteur de l’Émile a fait porter et déposer ses cinq enfants (qu’il a eus avec Thérèse Levasseur) aux Enfants-trouvés: « si on châtie légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vil séditieux ». Il tient Rousseau pour un « déguisé en saltimbanque » misérable et estime justifiées les plus basses attaques (les problèmes urinaires de Rousseau sont le fruit de ses « débauches »), au point de perdre tout sens de la mesure (ainsi dans le poème burlesque La Guerre civile de Genève où il s’acharne particulièrement contre Rousseau et sa compagne). Animé par la rage, il le poursuit jusque dans son exil en Angleterre, faisant paraître anonymement dans les journaux de Londres la Lettre au Docteur Jean-Jacques Pansophe (1760) pour le brouiller avec ses hôtes. Désormais, Voltaire va mener contre Rousseau une campagne d’insultes et de railleries, même s’il écrit en 1767: « Pour moi, je ne le regarde pas comme un fou. Je le crois malheureux à proportion de son orgueil: c’est-à-dire qu’il est l’homme du monde le plus à plaindre ». Voltaire et les femmes La vie et l’œuvre de Voltaire dévoilent une place intéressante accordée aux femmes. Plusieurs de ses pièces sont entièrement dédiées aux vies exceptionnelles de femmes de pouvoir de civilisations orientales. Cette vision des femmes au pouvoir peut éclairer l’attachement de Voltaire à une femme savante comme Émilie du Châtelet. En 1713, jeune secrétaire d’ambassade à La Haye, Voltaire s’éprend d’Olympe Dunoyer (ou du Noyer), alias Pimpette. C’est très vite le grand amour. La mère de cette jeune fille, une huguenote française exilée en Hollande, haïssant la monarchie française, va porter plainte à l’ambassadeur. Furieux, craignant un scandale, celui-ci renvoie Voltaire en France. C’est largement grâce aux femmes que Voltaire se faufile dans la haute société de la Régence. Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine réunissait dans son château de Sceaux une coterie littéraire qui complotait contre le duc Philippe d’Orléans (1674-1723). On y poussa Voltaire à exercer sa verve railleuse contre le Régent, ce qui valut à l’auteur un début de notoriété, et onze mois de Bastille. Les fréquentations féminines de Voltaire ne sont pas toutes de nature littéraire: c’est surtout pour favoriser ses affaires qu’il séduit l’épouse d’un président à mortier au parlement de Rouen, le marquis de Bernières, qu’il associe à ses spéculations, et aux ruses coûteuses déployées pour éditer La Henriade en dépit de la censure royale. Grâce au succès de sa première tragédie Œdipe, Voltaire fait la connaissance de la duchesse de Villars, dont il s’éprend, mais sans que la réciproque soit vraie ; reste, là aussi, l’introduction dans le cercle aristocratique éclairé gravitant autour de Charles Louis Hector, maréchal de Villars, qui recevait en son château de Vaux (Vaux-le-Vicomte). Quant à l’amour, Voltaire s’en dit « guéri », au profit de l’amitié, qu’il cultivera effectivement toute sa vie. Voltaire a des liaisons éphémères avec quelques actrices, notamment Suzanne de Livry et Adrienne Lecouvreur, mais de santé précaire, il s’est toujours préservé des excès, y compris amoureux. La relation avec Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet-Lomont est en revanche plus sérieuse. La traductrice de Newton est très douée pour les lettres autant que pour les sciences ou la philosophie. Elle est mariée, mais le marquis du Châtelet est un éternel absent, et Émilie, que tout passionne, tombe amoureuse sans mesure du prestigieux poète, qui lui est présenté en 1733, et qu’elle aimera jusqu’à sa mort, seize ans plus tard. Cirey (Cirey-sur-Blaise), le château de famille des Châtelet abrite leurs amours ; Voltaire en entreprend la restauration et l’agrandissement à ses frais. Leur vie est quasi maritale, mais des plus mouvementée ; les échanges intellectuels intenses: Voltaire qui, jusque-là s’était consacré au « grand genre », la tragédie et le poème épique, opte résolument pour ce qui fera la particularité de son œuvre: le combat politique et philosophique contre l’intolérance. Une relation fusionnelle, donc, autant que studieuse et féconde. C’est par une tromperie philosophique que s’engagera la fin d’une l’idylle de dix ans: la marquise renonce au matérialisme newtonien pour lui préférer le déterminisme optimiste de Leibniz, ce à quoi Voltaire ne saurait consentir. Moins sentimentale désormais, l’alliance persiste malgré tout. La marquise sauve plusieurs fois Voltaire des conséquences de ses insolences, et Voltaire éponge parfois les colossales dettes de jeu d’Émilie. La situation se complique singulièrement lorsque Mme du Châtelet s’éprend du marquis de Saint-Lambert (Jean-François de Saint-Lambert). Émilie est enceinte, et Voltaire concocte un stratagème pour que le mari de la marquise se croie le père de l’enfant. Émilie meurt peu après l’accouchement, laissant Voltaire désespéré: il devait à Émilie du Châtelet ses années les plus heureuses. En 1745, Voltaire devient, à cinquante ans, l’amant de sa nièce (l’une des deux filles de sa sœur aînée) Marie-Louise Denis. Voltaire a soigneusement dissimulé cette passion incestueuse et « adultère » (il est toujours l’amant en titre de la très jalouse Mme du Châtelet). Mme Denis n’est du reste pas des plus fidèles, et ne dédaigne pas de profiter de la fortune (considérable) du poète. Le couple ne cohabite vraiment qu’à la mort de Mme du Châtelet en 1749. Sauf pendant l’épisode prussien, Voltaire et sa nièce ne se sépareront plus. Marie-Louise Denis va régner sur le ménage de Voltaire jusqu’à sa mort. Bourgeoise, elle sait conduire une maisonnée, ce dont ne se souciait pas Mme du Châtelet. Mais elle ne sera jamais, comme elle, la confidente et la conseillère de ses travaux. Mme d’Épinay a fait de Mme Denis un portrait caricatural lors de sa visite aux Délices en novembre 1757: « La nièce de M. de Voltaire est à mourir de rire, c’est une petite grosse femme, toute ronde, d’environ cinquante ans, femme comme on ne l’est point, laide et bonne, menteuse sans le vouloir et sans méchanceté ; n’ayant pas d’esprit et en paraissant avoir ; criant, décidant, politiquant, versifiant, déraisonnant, et tout cela sans trop de prétention et surtout sans choquer personne, ayant par-dessus tout un petit vernis d’amour masculin qui perce à travers la retenue qu’elle s’est imposée. Elle adore son oncle, en tant qu’oncle et en tant qu’homme. Voltaire la chérit, s’en moque, la révère: en un mot cette maison est le refuge de l’assemblage des contraires et un spectacle charmant pour les spectateurs ». Mais le portrait qu’a laissé d’elle Van Loo montre un visage bien dessiné, un regard agréable et une certaine sensualité. « Prenez soin de maman… » aurait été l’une des dernières paroles de Voltaire mourant. Voltaire et l’homosexualité Dans le Dictionnaire Philosophique, Voltaire qualifie l’homosexualité d’« attentat infâme contre la nature » (encore faut-il lire la phrase entière, « Comment s’est-il pu faire qu’un vice, destructeur du genre humain s’il était général ; qu’un attentat infâme contre la nature, soit pourtant si naturel ? »), d’« abomination dégoûtante », ou encore de « turpitude ». Il écrit notamment: « Sextus Empiricus & d’autres, ont beau dire que la pédérastie était recommandée par les loix de la Perse ; qu’ils citent le texte de la loi, qu’ils montrent le Code des Persans ; & s’ils le montrent, je ne le croirai pas encor, je dirai que la chose n’est pas vraye, par la raison qu’elle est impossible ; non, il n’est pas dans la nature humaine de faire une loi qui contredit, & qui outrage la nature, une loi qui anéantirait le genre humain si elle était observée à la lettre ». Voltaire refuse donc que l’homosexualité (ou plus précisément: la « pédérastie ») soit une norme sociale « observée à la lettre » et généralisée: on ne peut pas en faire une loi naturelle – puisqu’elle n’est pas universellement partagée entre les êtres humains – et que l’hétérosexualité est de toute évidence majoritaire et nécessaire au renouvellement de l’espèce. À noter cependant dans le Traité de Métaphysique, 1735, chapitre IX, cette phrase: « L’adultère et l’amour des garçons seront permis chez beaucoup de nations: mais vous n’en trouverez aucune dans laquelle il soit permis de manquer à sa parole ; parce que la société peut bien subsister entre des adultères et des garçons qui s’aiment, mais non pas entre des gens qui se feraient une gloire de se tromper les uns les autres ». Daniel Borrillo et Dominique Colas, dans leur ouvrage L’Homosexualité de Platon à Foucault, estiment que « Voltaire aborde la question dans son dictionnaire philosophique sous le chapitre Amour nommé socratique d’une manière si légère et si violente qu’il semble avoir été écrit par un théologien du Moyen Âge plutôt que par un philosophe de la Raison ». Voltaire ne fait toutefois aucune référence à la Bible, à la différence de l’article « Sodomie » de l’Encyclopédie paru en 1765 et lui, très « théologique ». Par ailleurs, l’article du Dictionnaire philosophique a été très développé dans les Questions sur l’Encyclopédie (à partir de 1770). Selon Roger-Pol Droit, « Pareil acharnement est d’autant plus curieux qu’il est difficile de l’imputer au climat de l’époque (…). La plupart des philosophes des Lumières sont d’ailleurs plus que tolérants envers les partenaires de même sexe. Au contraire, Voltaire n’a cessé de juger ces mœurs contre nature, dangereuses, infâmes ». Mais c’est surtout l’homosexualité – conçue comme « pédérastie » qui est vivement condamnée par Voltaire, le philosophe craignant des abus sexuels sur mineurs – si les références à l’Antiquité gréco-romaine viennent à justifier, à tort et à travers, des « amours socratiques » où un pédagogue a des relations sexuelles avec les jeunes adolescents qui sont ses élèves ; en effet: « Je ne peux souffrir qu’on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. On cite le législateur Solon, parce qu’il a dit en deux mauvais vers, Tu chériras un beau garçon,/ Tant qu’il n’aura barbe au menton. (...) Sextus Empiricus qui doutait de tout, devait bien douter de cette jurisprudence. S’il vivait de nos jours, & qu’il vît deux ou trois jeunes Jésuites abuser de quelques écoliers, aurait-il droit de dire que ce jeu leur est permis par les constitutions d’Ignace de Loyola ? » —Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, Amour nommé socratique. Voltaire et l’esclavagisme Voltaire était fondamentalement opposé à l’image du « bon sauvage » des pays équatoriaux ou que l’homme est « bon » à l’état de nature, image promue par Jean-Jacques Rousseau ou Denis Diderot – avec, par exemple, son Supplément au voyage de Bougainville (« innocence » du « primitif » rappelant d’ailleurs l’image biblique du Jardin d’Eden, lorsqu’Adam et Eve n’ont point encore goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal). Voltaire considère que les hommes noirs, des pays équatoriaux, sont des « animaux humains » comme le sont aussi les hommes blancs, et que, si les Africains sont victimes de l’Européen, ce n’est pas parce que l’Européen est corrompu par la société – tandis que les Africains ne le sont point, comme vierges de toute culpabilité, mais bien parce que les chefs nègres collaborent activement avec les marchands européens pour leur vendre des esclaves africains ; ainsi, Voltaire ne cherche pas à dédouaner de leur responsabilité les peuples africains dans la traite négrière (en les infantilisant ou en clamant qu’ils sont trop naïfs pour ne pas savoir ce qu’ils font, comme incapables de distinguer le bien et le mal), et écrit, dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations: « Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l’acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » Ce refus de faire des Africains un peuple essentiellement « irresponsable », démontre que Voltaire s’écarte de tout discours justifiant une essence humaine, discours permettant de soutenir qu’il y a des hommes qui, par leur seule naissance, sont destinés à être dominés et oppressés, et d’autres – à dominer et à oppresser: pour Voltaire, c’est parce que les Africains noirs n’ont pas pitié des leurs – et ne les protègent pas des abus, que les Européens peuvent les asservir sans problème par l’esclavage, et non parce que les hommes noirs sont par leur nature même « naïfs » – abusés malgré eux, comme le prétendent les Européens croyant au « bon sauvage ». Voltaire a fermement condamné l’esclavagisme. Le texte le plus célèbre est la dénonciation des mutilations de l’esclave de Surinam dans Candide mais son corpus comporte plusieurs autres passages intéressants. Dans le « Commentaire sur l’Esprit des lois » (1777), il félicite Montesquieu d’avoir jeté l’opprobre sur cette odieuse pratique. Il s’est également enthousiasmé pour la libération de leurs esclaves par les quakers de Pennsylvanie en 1769. De la même manière le fait qu’il considère en 1771 que « de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste », guerre que des esclaves ont menée contre leurs oppresseurs, plaide assurément en faveur de la thèse d’un Voltaire antiesclavagiste. Lors des dernières années de sa vie, en compagnie de son avocat et ami Christin, il a lutté pour la libération des « esclaves » du Jura qui constituaient les derniers serfs présents en France et qui, en vertu du privilège de la main-morte, étaient soumis aux moines du chapitre de Saint-Claude (Jura). C’est un des rares combats politiques qu’il ait perdu ; les serfs ne furent affranchis que lors de la Révolution française, dont Voltaire inspira certains des principes. À tort, on a souvent prétendu que Voltaire s’était enrichi en ayant participé à la traite des Noirs. On invoque à l’appui de cette thèse une lettre qu’il aurait écrite à un négrier de Nantes pour le remercier de lui avoir fait gagner 600 000 livres par ce biais. En fait, cette prétendue lettre est un faux. Voltaire, le racisme et l’antisémitisme Pour Christian Delacampagne, « Voltaire, il faut s’y résoudre, est à la fois polygéniste, raciste et antisémite », car, animé par ce qu’il considère comme l’obscurantisme religieux, « il poursuit d’une même haine le christianisme et le judaïsme. Et comme il lui faut à tout prix se démarquer des doctrines défendues par ces deux religions, il se croit obligé d’attaquer avec vigueur le monogénisme » (selon quoi Adam et Ève sont le couple humain unique et originel). Ainsi, dans l’introduction de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, Voltaire écrit: « Il n’est permis qu’à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Hottentots, les Chinois, les Américains, soient des races entièrement différentes… Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent point cette différence à leur climat, c’est que les nègres et les négresses, transplantés dans des pays les plus froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce… » [non neutre]Cet extrait doit être lu avec les références du XVIIIe siècle: le mot « race » à cette époque n’a pas du tout le sens que lui a donné le XIXe siècle – et n’a aucune connotation péjorative (du fait que l’eugénisme scientifique n’est pas encore présent au XVIIIe siècle), ainsi que le terme « intelligence ». « Race » désigne davantage un ca-RAC-tère, un genre, un type, et « intelligence » les qualités intellectuelles propres. [non neutre]Bien avant Darwin et sa théorie de l’évolution, Voltaire remet donc totalement en question le dogme abrahamique consistant à affirmer que l’espèce humaine, en son intégralité, vient d’un seul couple originel (Adam et Ève) créé par Jéhovah, mais considère, au contraire, que l’humanité – à la manière de toutes les autres espèces animales –, est issue de différentes branches distinctes qui ont évolué de manière multiple, en lien étroit avec la géographie et leur hérédité physique particulière (c’est ce que défend aussi Montesquieu, qui prétend, dans son Esprit des lois, que les cultures humaines se constituent différemment selon le climat et la géographie où elles s’épanouissent). D’après la revue catholique traditionaliste, La Nef, l’attitude de Voltaire envers les Juifs, notamment dans certains passages du Dictionnaire Philosophique ou des « Essais sur les Mœurs » pose la question de son antisémitisme, exprimé à de nombreuses reprises. Dans l’article « Tolérance », il écrit: « Il est certain que la nation juive est la plus singulière qui jamais ait été dans le monde. Quoiqu’elle soit la plus méprisable aux yeux de la politique, elle est, à bien des égards, considérable aux yeux de la philosophie.. » Il écrit aussi: « Si ces Ismaélites [les Arabes, qui, selon la Bible, descendent d’Ismaël] ressemblaient aux Juifs par l’enthousiasme et la soif du pillage, ils étaient prodigieusement supérieurs par le courage, par la grandeur d’âme, par la magnanimité […] Ces traits caractérisent une nation. On ne voit au contraire, dans toutes les annales du peuple hébreu, aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l’hospitalité, ni la libéralité, ni la clémence. Leur souverain bonheur est d’exercer l’usure avec les étrangers ; et cet esprit d’usure, principe de toute lâcheté, est tellement enracinée dans leurs cœurs, que c’est l’objet continuel des figures qu’ils emploient dans l’espèce d’éloquence qui leur est propre. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages dont ils peuvent s’emparer. Ils égorgent les vieillards et les enfants ; ils ne réservent que les filles nubiles ; ils assassinent leurs maitres quand ils sont esclaves ; ils ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs: ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle science, nul art perfectionné dans aucun temps, chez cette nation atroce. » —Essais sur les Mœurs, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. 6-De l’Arabie et de Mahomet, p. 231.[réf. nécessaire]Voltaire méprise le judaïsme qu’il conçoit comme un idéalisme fanatique et dogmatique – source du christianisme et de l’islam. Mais il évacue toute idée de détestation raciale ou de haine perverse. Voltaire tolère, mais Voltaire combat par les idées. Pour Bernard Lazare (+ 1903), « si Voltaire fut un ardent judéophobe, les idées que lui et les encyclopédistes représentaient n’étaient pas hostiles aux Juifs, puisque c’étaient des idées de liberté et d’égalité universelle ». L’historien de la Shoah, Léon Poliakov fait de Voltaire, « le pire antisémite français du XVIIIe siècle ». Selon lui, ce sentiment se serait aggravé dans les quinze dernières années de la vie de Voltaire. Il paraîtrait alors lié au combat du philosophe contre l’Église. Certes, Voltaire déteste les Hébreux de l’Ancien Testament qui prétendent être le peuple élu: nul peuple n’est tel pour lui. Mais Voltaire n’appelle pas sur les juifs la persécution raciale à la différence des antisémites du XIXe siècle et du XXe siècle. Au contraire, les critiques de Voltaire envers le judaïsme (ou envers le christianisme, l’islam, le manichéisme, le polythéisme et l’athéisme) servent de point d’appui pour glorifier une éthique universelle, la tolérance et le respect au-delà des doctrines métaphysiques: « Vous [les Israélites] me paraissez les plus fous de la bande [hommes se disputant pour leurs opinions religieuses respectives, athées compris]. Les Cafres, les Hottentots, les nègres de Guinée sont des êtres beaucoup plus raisonnables et plus honnêtes que vos Juifs les ancêtres. Vous l’avez emporté sur toutes les nations en fables impertinentes, en mauvaise conduite, et en barbarie. (...) Pourquoi seriez-vous une puissance ? (...) Continuez surtout à être tolérants ; c’est le vrai moyen de plaire à l’Être des êtres, qui est également le père des Turcs et des Russes, des Chinois et des Japonais [deux couples de nations voisines souvent en conflit], des nègres, des tannés et des jaunes, et de la nature entière. » —Voltaire, Il faut prendre un parti ; XXIV Discours d’un théiste. Pour Pierre-André Taguieff, « Les admirateurs inconditionnels de la « philosophie des Lumières », s’ils prennent la peine de lire le troisième tome (De Voltaire à Wagner) de l’Histoire de l’antisémitisme, paru en 1968, ne peuvent que nuancer leurs jugements sur des penseurs comme Voltaire ou le baron d’Holbach, qui ont reformulé l’antijudaïsme dans le code culturel « progressiste » de la lutte contre les préjugés et les superstitions ». D’autres notent que l’existence de passages contradictoires dans l’œuvre de Voltaire ne permet pas de conclure péremptoirement au racisme ou à l’antisémitisme du philosophe. « L’antisémitisme n’a jamais cherché sa doctrine chez Voltaire », indique ainsi Roland Desné, qui écrit: « Il est non moins vrai que ce n’est pas d’abord chez Voltaire qu’on trouve des raisons pour combattre l’antisémitisme. Pour ce combat, il y a d’abord l’expérience et les raisons de notre temps. Ce qui ne signifie pas que Voltaire, en compagnie de quelques autres, n’ait pas sa place dans la lointaine genèse de l’histoire de ces raisons-là ». Voltaire et l’islam Déiste, Voltaire était attiré par la rationalité apparente de l’islam, religion sans clergé, sans miracle et sans mystères. Reprenant la thèse déiste de Henri de Boulainvilliers, il apercevait dans le monothéisme musulman une conception plus rationnelle que celle de la Trinité chrétienne. Dans sa tragédie Le Fanatisme ou Mahomet, Voltaire considère Mahomet comme un « imposteur », un « faux prophète », un « fanatique » et un « hypocrite »,. Toutefois selon Pierre Milza, la pièce a surtout été « un prétexte à dénoncer l’intolérance des chrétiens – catholiques de stricte observance, jansénistes, protestants – et les horreurs perpétrées au nom du Christ ». Pour Voltaire, Mahomet « n’est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main ». Voltaire écrira en 1742 dans une lettre à M. de Missy: « Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet, le prieur des Jacobins mettant le poignard à la main de Jacques Clément ». Plus tard, après avoir lu Henri de Boulainvilliers et Georges Sale, il reparle de Mahomet et de l’islam dans un article « De l’Alcoran et de Mahomet » publié en 1748 à la suite de sa tragédie. Dans cet article, Voltaire maintient que Mahomet fut un « charlatan », mais « sublime et hardi » et écrit qu’il n’était en outre pas un illettré. Puisant aussi des renseignements complémentaires dans la Bibliothèque orientale d’Herbelot, Voltaire, selon René Pomeau, porte un « jugement assez favorable sur le Coran » où il trouve, malgré « les contradictions, les absurdités, les anachronismes », une « bonne morale » et « une idée juste de la puissance divine » et y « admire surtout la définition de Dieu ». Ainsi, il « concède désormais » que « si son livre est mauvais pour notre temps et pour nous, il était fort bon pour ses contemporains, et sa religion encore meilleure. Il faut avouer qu’il retira presque toute l’Asie de l’idolâtrie » et qu’« il était bien difficile qu’une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre ». Il considère que « ses lois civiles sont bonnes ; son dogme est admirable en ce qu’il a de conforme avec le nôtre » mais que « les moyens sont affreux ; c’est la fourberie et le meurtre ». Après avoir estimé plus tard qu’il avait fait dans sa pièce Mahomet « un peu plus méchant qu’il n’était », c’est dans la biographie de Mahomet rédigée par Henri de Boulainvilliers que Voltaire puise et emprunte, selon René Pomeau, « les traits qui révèlent en Mahomet le grand homme ». Dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations dans lequel il consacre, en historien cette fois, plusieurs chapitres à l’islam,, Voltaire « porte un jugement presque entièrement favorable » sur Mahomet qu’il qualifie de « poète », de « grand homme » qui a « changé la face d’une partie du monde », tout en nuançant la sincérité de Mahomet qui imposa sa foi par « des fourberies nécessaires ». Il considère que si « le législateur des musulmans, homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses armes », sa religion devint cependant « indulgente et tolérante ». Cependant, Voltaire est fondamentalement déiste et dénonce clairement l’Islam et les religions abrahamiques en général. Profitant de la définition du théisme dans son Dictionnaire philosophique, il jette dos à dos Islam et Christianisme: « [le théiste] croit que la religion ne consiste ni dans les opinions d’une métaphysique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans l’adoration et dans la justice. Faire le bien, voilà son culte ; être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le mahométan lui crie: « Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage à La Mecque! » « Malheur à toi, lui dit un récollet, si tu ne fais pas un voyage à Notre-Dame de Lorette! » Il rit de Lorette et de La Mecque ; mais il secourt l’indigent et il défend l’opprimé. » Néanmoins, dans un contexte français marqué par l’emprise liberticide du catholicisme sur la société française, Voltaire nuance parfois son jugement sur l’Islam, comprenant qu’il peut s’agir d’une arme redoutable contre le clergé catholique. Ses propos sur Mahomet lui valent d’ailleurs les foudres des jésuites et notamment de l’abbé Claude-Adrien Nonnotte,. Dans l’Essai sur les mœurs, Voltaire se montre également « plein d’éloges pour la civilisation musulmane et pour l’islam en tant que règle de vie ». Il compare ainsi le « génie du peuple arabe » au « génie des anciens Romains » et écrit que « dans nos siècles de barbarie et d’ignorance, qui suivirent la décadence et le déchirement de l’Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes: astronomie, chimie, médecine », et que « dès le second siècle de Mahomet, il fallut que les chrétiens d’Occident s’instruisissent chez les musulmans ». Il y a donc deux représentations de Mahomet chez Voltaire, l’une religieuse selon laquelle Mahomet est un prophète comme les autres qui exploite la naïveté des gens et répand la superstition et le fanatisme, mais qui prêche l’unicité de Dieu et l’autre, politique, selon laquelle Mahomet est un grand homme d’État comme Alexandre le Grand et un grand législateur qui a fait sortir ses contemporains de l’idolâtrie. Ainsi selon Diego Venturino la figure de Mahomet est ambivalente chez Voltaire, qui admire le législateur, mais déteste le conquérant et le pontife, qui a établi sa religion par la violence. Pour Dirk van der Cruysse l’image plus nuancée de Mahomet dans l’Essai sur les mœurs est nourrie en partie par « l’antipathie que Voltaire éprouvait à l’égard du peuple juif ». Selon lui, les « inefficacités de la révélation judéo-chrétienne » comparées au « dynamisme de l’islam » soulève chez Voltaire une « admiration sincère mais suspecte ». Van der Cruysse considère le discours voltairien sur Mahomet comme un « tissu d’admiration et de mauvaise foi mal dissimulé » qui vise moins le prophète lui-même que les spectres combattus par Voltaire à savoir le « fanatisme et l’intolérance du christianisme et du judaïsme ». Ce qu’il ne faut donc pas perdre de vue, c’est que Voltaire admire le Mahomet conquérant, réformateur et législateur, qu’il apprécie des caractéristiques du dogme mais seulement quand il les compare à d’autres, et qu’enfin il exècre l’Islam en tant que religion, et, dans les textes qui montrent l’éloge à Mahomet, on lit aussi une dénonciation virulente de la barbarie, du fanatisme, et de l’obscurantisme. Voltaire et le christianisme Le christianisme, dont il souhaite la disparition, n’est pour Voltaire que superstition et fanatisme. C’est dans ses lettres qu’il est le plus explicite: en 1767, il écrit à Frédéric II: « Tant qu’il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde, et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde »; et au Marquis d’Argence: le christianisme est "la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre",. Toute sa vie, Voltaire a répandu des écrits anti-chrétiens, tout en affirmant qu’il était étranger à ces publications (ce qui en général ne trompait personne, mais lui évitait des poursuites personnelles) et en feignant à Ferney la pratique religieuse, par exemple en faisant ses pâques en 1768 (ses bons paysans seraient « effrayés », explique-t-il dans ses lettres, s’ils le voyaient agir autrement qu’eux, s’ils pouvaient imaginer qu’il pense différemment). Ses attaques contre la croyance et les pratiques du christianisme, ses railleries sur la Bible, surtout l’Ancien Testament (dont il est un lecteur assidu), sont le propre de ce qu’on a appelé « l’esprit voltairien » et ont suscité contre lui des haines profondes. Elles se font en effet toujours sous une forme particulièrement moqueuse envers les croyants, ainsi dans Le Dîner du comte de Boulainvilliers (1767), son réquisitoire contre la messe et la communion: « Un gueux qu’on aura fait prêtre, un moine sortant des bras d’une prostituée, vient pour douze sous, revêtu d’un habit de comédien, me marmotter dans une langue étrangère ce que vous appelez une messe, fendre l’air en quatre avec trois doigts, se courber, se redresser, tourner à droite et à gauche, par devant et par derrière, et faire autant de dieux qu’il lui plaît, les boire et les manger, et les rendre ensuite à son pot de chambre! » Mais Voltaire peut être plus clément dans sa critique du christianisme, en écrivant par exemple dans sa Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, que « le christianisme n’enseigne que la simplicité, l’humanité, la charité ; vouloir le réduire à la métaphysique, c’est en faire une source d’erreurs ». La condamnation du christianisme chez Voltaire porte donc davantage sur l’idéalisme exclusif et l’aspect rituel (ou superstitieux) qui peut s’en emparer (et le desservir) – que sur les enseignements de Jésus-Christ en eux-mêmes. Voltaire préfère prendre le parti des opprimés et cultiver une philosophie à contre-courant de toutes idées et comportements préconçus – pour permettre à la Raison sensible de s’épanouir librement, plutôt que défendre et établir des systèmes de pensées abstraits sans lien avec la réalité vécue: un philosophe ne doit pas devenir un « chef de parti » enfermant son intellect dans une doctrine, même s’il prend parti. C’est surtout l’absurdité conceptualisée et érigée en dogme – et l’absence d’empathie des hommes, qui pousse Voltaire à dénoncer le christianisme et à se moquer des chrétiens et à tout ce qui leur apparaît « normal » ; dans son Dialogue du chapon et de la poularde, Voltaire en vient ainsi à faire dire au chapon, s’adressant à la poularde, que l’abstinence de viande, deux jours par semaine, dans le christianisme, est une loi « très barbare [qui] ordonne que ces jours-là on mangera les habitants des eaux. Ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils dévorent des créatures dont une seule coûte souvent plus de la valeur de cent chapons: ils appellent cela jeûner, se mortifier. Enfin je ne crois pas qu’il soit possible d’imaginer une espèce plus ridicule à la fois plus abominable, plus extravagante et plus sanguinaire ». Globalement, le lien fait entre le fanatisme sanguinaire et les références abrahamiques est chez Voltaire une constante, qui participe beaucoup à son rejet du christianisme. Dans La Bible enfin expliquée, Voltaire écrit: « C’est le propre des fanatiques qui lisent les Ecritures saintes, de se dire à eux-mêmes: Dieu a tué, donc il faut que je tue ; Abraham a menti, Jacob a trompé, Rachel a volé, donc je dois voler, tromper, mentir. Mais, malheureux! tu n’es ni Rachel, ni Jacob, ni Abraham, ni Dieu: tu n’es qu’un fou furieux, & les Papes qui défendirent la lecture de la Bible furent très sages. » Voltaire et le protestantisme L’engagement de Voltaire pour la liberté religieuse est célèbre, et un des épisodes les plus connus en est l’affaire Calas. Ce protestant, injustement accusé d’avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme est mort roué en 1762. En 1763, Voltaire publie son Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas qui bien qu’interdit aura un retentissement extraordinaire et amènera à la réhabilitation de Calas deux ans plus tard. Au départ, il n’éprouvait pas pour lui de sympathies particulières, au point d’écrire le 22 mars 1762, dans une lettre privée au conseiller Le Bault: « Nous ne valons pas grand’chose, mais les huguenots sont pires que nous, et de plus ils déclament contre la comédie ». Il venait alors d’apprendre l’exécution de Calas et, encore mal informé, il croyait à sa culpabilité. Mais des renseignements lui parviennent et, le 4 avril, il écrit à Damilaville: « Il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Presque tout le Languedoc en gémit avec horreur. Les nations étrangères, qui nous haïssent et qui nous battent, sont saisies d’indignation. Jamais, depuis le jour de la Saint-Barthélemy, rien n’a tant déshonoré la nature humaine. Criez, et qu’on crie ». Et il se lance dans le combat pour la réhabilitation. En 1765, Voltaire prend fait et cause pour la famille Sirven, dans une affaire très similaire ; cette fois-ci il réussira à éviter la mort aux parents. Cependant, bien qu’impressionné par la théologie des Quakers, et révolté par le massacre de la Saint-Barthélemy (Voltaire était pris de malaises tous les 24 août), Voltaire n’a pas de sympathie particulière pour le protestantisme établi. Dans sa lettre du 26 juillet 1769 à la duchesse de Choiseul, il dit bien crûment: « Il y a dans le royaume des Francs environ trois cent mille fous qui sont cruellement traités par d’autres fous depuis longtemps ». Voltaire et l’hindouisme Très critique envers les religions abrahamiques, Voltaire avait en revanche une vision positive de l’hindouisme (mais rejetant toute forme de superstition qui aurait dégradé l’origine première des enseignements brahmaniques) ; l’autorité sacrée des brahmanes, le Véda, a ainsi été commenté par le philosophe en ces termes: « Le Véda est le plus précieux don de l’Orient, et l’Occident lui en sera à jamais redevable. » Et dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (chapitre 4): « Si l’Inde, de qui toute la terre a besoin, et qui seule n’a besoin de personne, doit être par cela même la contrée la plus anciennement policée, elle doit conséquemment avoir eu la plus ancienne forme de religion. » Dans ce même chapitre, Voltaire voit le peuple hindou comme étant « un peuple simple et paisible » – « étonné » de voir des « hommes ardents », venus « des extrémités occidentales de la terre », s’entretuer mutuellement sur le sous-continent indien – pour le piller et le convertir à leur religion respective et ennemie: l’islam ou les différentes branches du christianisme. Voltaire se sert aussi des histoires et textes antiques de l’hindouisme pour ridiculiser et renier les revendications et affirmations bibliques (temps linéaire très court de la Bible, face au temps cyclique et infiniment long dans l’hindouisme, etc.), et considère que la bienveillance hindoue envers les animaux est un choix qui rend complètement honteux la malveillance générale soutenue par l’impérialisme européen, colonial et esclavagiste. Informations complémentaires À la mort de Voltaire, son corps avait été, selon sa volonté, autopsié. Le marquis de Villette s’était approprié le cœur, l’apothicaire ayant procédé à l’embaumement, M. Mitouard, avait obtenu de garder le cerveau. Villette, ayant fait l’acquisition de Ferney, décida de faire de la chambre de l’écrivain un sanctuaire. Il y dressa un petit mausolée abritant un coffret de vermeil contenant la relique. Une plaque indiquait en lettres d’or: « Son esprit est partout et son cœur est ici ». Quand il dut vendre Ferney en 1785, le marquis rapporta le cœur rue de Beaune à Paris. Il échut à son héritier, qui était devenu sous la Restauration un royaliste ultra et qui légua, à sa mort en 1859, tous ses biens au « comte de Chambord ». D’autres héritiers des Villette, en pleine querelle testamentaire, tentèrent alors de s’opposer à ce que le cœur du philosophe devint la propriété du prétendant légitimiste au trône de France. Ils perdirent leur procès en première instance et en appel, mais l’emportèrent en cassation. Ils décidèrent d’en faire don en 1864 à l’empereur Napoléon III. Le cœur de Voltaire fut déposé à la Bibliothèque nationale dans le socle du plâtre original du « Voltaire assis » de Jean-Antoine Houdon où l’on peut lire l’inscription: « Cœur de Voltaire donné par les héritiers du marquis de Villette ». Cette cérémonie de remise du 16 décembre 1864 se fit en présence de Victor Duruy, ministre de l’Instruction, qui déclara le cœur de Voltaire bien national. Le cerveau de Voltaire fut exposé dans l’officine de Mitouart pendant plusieurs années. Son fils voulut en faire don en 1799 à la Bibliothèque nationale. Le Directoire refusa. De nouvelles propositions furent faites en 1830 et 1858, suivies de nouveaux refus. Il échoua en 1924 à la Comédie française (il aurait été cédé par une descendante des Mitouart contre deux fauteuils d’orchestre) et fut placé dans le socle d’une autre statue de Houdon où il se trouve encore. On qualifia Voltaire de « franc-maçon sans tablier », car il s’était tenu à l’écart de cette confrérie, bien qu’il eût des conceptions voisines. En 1778, il accepta pourtant d’entrer dans la loge des Neuf Sœurs (que fréquentait aussi Benjamin Franklin). On le dispensa vu son âge des habituelles épreuves ainsi que du rite du bandeau sur les yeux, celui-ci semblant déplacé sur un homme qui avait été considéré par beaucoup comme l’un des plus clairvoyants de son époque. Il revêtit à cette unique occasion le tablier de Claude-Adrien Helvétius, qu’il embrassa avec respect. Les honneurs funèbres lui furent rendus en loge le 28 novembre de cette même année,. Il est courant d’entendre que Voltaire disait à propos de Marivaux et d’autres: « Grands compositeurs de rien, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toiles d’araignées ». Or, s’il est exact que cette expression se rencontre effectivement chez Voltaire, elle ne vise nullement Marivaux. On la trouve dans sa lettre du 27 avril 1761 à l’abbé Trublet où il écrit: « Je me souviens que mes rivaux et moi, quand j’étais à Paris, nous étions tous fort peu de chose, de pauvres écoliers du siècle de Louis XIV, les uns en vers, les autres en prose, quelques-uns moitié prose, moitié vers, du nombre desquels j’avais l’honneur d’être ; infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toile d’araignée ». Quant au nom de l’auteur du Jeu de l’amour et du hasard, il ne se trouve pas une seule fois dans la lettre. Voltaire a la réputation d’avoir été un grand amateur de café, et il fréquentait souvent le Procope. Il aurait eu l’habitude de consommer entre 40 et 72 tasses par jour,. Le billet de banque 10 francs Voltaire a été émis en janvier 1964. Le romancier Frédéric Lenormand fait de Voltaire le héros de sa série de livres Voltaire mène l’enquête. En mai 2016, six livres dans cette collection sont sortis. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire


Louise Colet, née Révoil de Servannes à Aix-en-Provence le 15 septembre 1810 et morte à Paris le 8 mars 1876, est une poétesse et écrivaine française. Biographie Âgée d’une vingtaine d’années, Louise Révoil2 épouse Hippolyte-Raymond Colet, un musicien académique, en partie afin d’échapper à la vie provinciale et de résider à Paris. À son arrivée à Paris, Louise Colet commence à publier ses poèmes et obtient bientôt le prix de l’Académie française d'un montant de deux mille francs, le premier de quatre prix de l’Académie qu’elle obtiendra. Dans son salon littéraire du no 2 rue Bréda elle a fréquenté nombre de ses contemporains du monde littéraire parisien, tels que Victor Hugo, Musset, Vigny, Baudelaire, ainsi que de nombreux peintres et des politiciens. En 1840 elle met au monde sa fille Henriette, mais ni son mari Hippolyte Colet, ni son amant Victor Cousin n’acceptent d’en reconnaître la paternité. Le journaliste Alphonse Karr révèle dans un pamphlet la liaison adultère. Furieuse, Louise Colet l'agresse avec un couteau de cuisine qu'elle lui plante dans le dos. Karr s'en tire avec une égratignure, et avec élégance renonce à porter plainte au grand soulagement de Victor Cousin. Elle devient ensuite la maîtresse de Gustave Flaubert (encore inconnu du public), d'Alfred de Vigny, d’Alfred de Musset et d’Abel Villemain. En 1844, Louise Colet publie une traduction des Œuvres choisies de Tommaso Campanella. Dans les années 1840 et 1850, ses œuvres sont plusieurs fois couronnées par de nombreux prix littéraires prestigieux, notamment le Prix de l'Académie française. Après la mort de son mari à Paris, le 21 avril 1851, Louise Colet et sa fille subsistent grâce à ses écrits et à l'aide de Victor Cousin. Elle est inhumée à Verneuil-sur-Avre (Eure).


Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théoricien d’art qui serait né sujet polonais de l’Empire russe, le 26 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre. Considéré comme l’un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle, il est l’auteur de poèmes tels Zone, La Chanson du mal-aimé, Le Pont Mirabeau, ayant fait l’objet de plusieurs adaptations en chanson au cours du siècle. La part érotique de son œuvre– dont principalement trois romans (dont un perdu), de nombreux poèmes et des introductions à des auteurs licencieux– est également passée à la postérité. Il expérimenta un temps la pratique du calligramme (terme de son invention, quoiqu’il ne soit pas l’inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en forme de dessins et non de forme classique en vers et strophes). Il fut le chantre de nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme et de l’orphisme à la gestation desquels il participa en tant que poète et théoricien de l’Esprit nouveau. Précurseur du surréalisme, avec son drame Les Mamelles de Tirésias (1917), il en forgea le nom. Biographie Jeunesse Guillaume Apollinaire est né à Rome sous le nom de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, en polonais Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary Kostrowicki, herb. Wąż. Apollinaire est en réalité—jusqu’à sa naturalisation en 1916—le 5e prénom de Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky. Sa mère, Angelika Kostrowicka (clan Wąż, ou Angelica de Wąż-Kostrowicky), née à Nowogródek dans le grand-duché de Lituanie, appartenant à l’Empire russe (aujourd’hui Navahrudak en Biélorussie), dans une famille de la petite noblesse polonaise, demeure, après la mort de son père, camérier honorifique de cape et d’épée du pape, à Rome où elle devient la maîtresse d’un noble et a une grossesse non désirée. Son fils est déclaré à la mairie comme étant né le 26 août 1880 d’un père inconnu et d’une mère voulant rester anonyme, de sorte que l’administration l’affubla d’un nom de famille d’emprunt : Dulcigny. Angelika le reconnaît quelques mois plus tard devant notaire comme son fils, sous le nom de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandroi Apollinare de Kostrowitzky. Selon l’hypothèse la plus probable, son père serait un officier italien, Francesco Flugi d’Aspermont. En 1882, elle lui donne un demi-frère, Alberto Eugenio Giovanni. En 1887 elle s’installe à Monaco avec ses fils sous le nom d’Olga de Kostrowitzky. Très vite elle y est arrêtée et fichée par la police comme femme galante, gagnant probablement sa vie comme entraîneuse dans le nouveau casino. Guillaume, placé en pension au collège Saint Charles, dirigé par les frères Maristes, y fait ses études de 1887 à 1895, et se révèle l’un des meilleurs élèves. Puis il est inscrit au lycée Stanislas de Cannes et ensuite au lycée Masséna de Nice où il échoue à son premier baccalauréat et ne se représente pas. Durant les trois mois de l’été 1899, sa mère l’a installé, avec son frère, dans une pension de la petite bourgade wallonne de Stavelot, pension qu’ils quittent, le 6 octobre, à « la cloche de bois » : leur mère ne leur ayant envoyé que l’argent du train, ils ne peuvent payer la note de l’hôtel, et doivent fuir en secret, une fois tout le monde endormi. L’épisode wallon féconde durablement son imagination et sa création. Ainsi, de cette époque date le souvenir des danses festives de cette contrée (« C’est la maclotte qui sautille... »), dans Marie, celui des Hautes Fagnes, ainsi que l’emprunt au dialecte wallon. La mère d’Apollinaire Journal de Paul Léautaud au 20 janvier 1919 : « Je vois entrer une dame [la mère d’Apollinaire, dans le bureau de Léautaud au Mercure de France] assez grande, élégante, d’une allure un peu à part. Grande ressemblance de visage avec Apollinaire, ou plutôt d’Apollinaire avec elle, le nez, un peu les yeux, surtout la bouche et les expressions de la bouche dans le rire et dans le sourire. / Elle me paraît fort originale. Exubérante. Une de ces femmes dont on dit qu’elles sont un peu « hors cadre ». En une demi-heure, elle me raconte sa vie : russe, jamais mariée, nombreux voyages, toute l’Europe ou presque. (Apollinaire m’apparaît soudain ayant hérité en imagination de ce vagabondage.) Apollinaire né à Rome. Elle ne me dit rien du père. / Elle me parle de l’homme avec lequel elle vit depuis vingt-cinq ans, son ami, un Alsacien, grand joueur, tantôt plein d’argent, tantôt sans un sou . Elle ne manque de rien. Dîners chez Paillard, Prunier, Café de la Paix, etc. / Elle me dit qu’elle a plusieurs fois « installé » Apollinaire, l’avoir comblé d’argent. En parlant de lui, elle dit toujours : Wilhelm. / Sentiments féroces à l’égard de la femme d’Apollinaire. / [...] Elle me dépeint Apollinaire comme un fils peu tendre, intéressé, souvent emporté, toujours à demander de l’argent, et peu disposé à en donner quand il en avait. / Elle ne m’a pas caché son âge : 52 ans. Fort bien conservée pour cet âge, surtout élancée et démarche légère, aisée. » À Paris En 1900, il s’installe à Paris, centre des arts et de la littérature européenne à l’époque. Vivant dans la précarité, sa mère lui demande, pour gagner sa vie, de passer un diplôme de sténographie et il devient employé de banque comme son demi-frère Alberto Eugenio Giovanni. L’avocat Esnard l’engage un mois comme nègre pour écrire le roman-feuilleton Que faire ? dans Le Matin, mais refuse de le payer. Pour se venger, il séduit sa jeune maîtresse. En juillet 1901, il écrit son premier article pour Tabarin, hebdomadaire satirique dirigé par Ernest Gaillet, puis en septembre 1901 ses premiers poèmes paraissent dans la revue La Grande France sous son nom Wilhelm Kostrowiztky. De mai 1901 au 21 août 1902, il est le précepteur de la fille d’Élinor Hölterhoff, vicomtesse de Milhau, d’origine allemande et veuve d’un comte français. Il tombe amoureux de la gouvernante anglaise de la petite fille, Annie Playden, qui refuse ses avances. C’est alors la période « rhénane » dont ses recueils portent la trace (La Lorelei, Schinderhannes). De retour à Paris en août 1902, il garde le contact avec Annie et se rend auprès d’elle à deux reprises à Londres. Mais en 1905, elle part pour l’Amérique. Le poète célèbre la douleur de l’éconduit dans Annie, La Chanson du mal-aimé, L’Émigrant de Landor Road, Rhénanes. Entre 1902 et 1907, il travaille pour divers organismes boursiers et parallèlement publie contes et poèmes dans des revues. Il prend à cette époque pour pseudonyme Apollinaire d’après le prénom de son grand-père maternel, Apollinaris, qui rappelle Apollon, dieu de la poésie. En novembre 1903, il crée[réf. nécessaire] un mensuel dont il est rédacteur en chef, Le festin d’Ésope, revue des belles lettres dans lequel il publie quelques poèmes ; on y trouve également des textes de ses amis André Salmon, Alfred Jarry, Mécislas Golberg, entre autres. En 1907, il rencontre l’artiste peintre Marie Laurencin. Ils entretiendront une relation chaotique et orageuse durant sept ans. À cette même époque, il commence à vivre de sa plume et se lie d’amitié avec Pablo Picasso, Antonio de La Gandara, Jean Metzinger, Paul Gordeaux, André Derain, Edmond-Marie Poullain, Maurice de Vlaminck et le Douanier Rousseau, se fait un nom de poète et de journaliste, de conférencier et de critique d’art à L’Intransigeant. En 1909, L’Enchanteur pourrissant, son œuvre ornée de reproductions de bois gravés d’André Derain est publiée par le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler . Le 7 septembre 1911, accusé de complicité de vol de La Joconde parce qu’une de ses relations avait dérobé des statuettes au Louvre, il est emprisonné durant une semaine à la prison de la Santé ; cette expérience le marque. Cette année-là, il publie Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée ornée des gravures de Raoul Dufy. En 1913, les éditions du Mercure de France éditent Alcools, somme de son travail poétique depuis 1898. La guerre En août 1914, il tente de s’engager dans l’armée française, mais le conseil de révision ajourne sa demande car il n’a pas la nationalité française. Lou et Madeleine Il part pour Nice où sa seconde demande, en décembre 1914, sera acceptée, ce qui lancera sa procédure de naturalisation. Peu après son arrivée, un ami lui présente Louise de Coligny-Châtillon, lors d’un déjeuner dans un restaurant niçois. Divorcée, elle demeure chez son ex-belle-sœur à la Villa Baratier, dans les environs de Nice, et mène une vie très libre. Guillaume Apollinaire s’éprend aussitôt d’elle, la surnomme Lou et la courtise d’abord en vain. Puis elle lui accorde ses faveurs, les lui retire et quand il est envoyé faire ses classes à Nîmes après l’acceptation de sa demande d’engagement, elle l’y rejoint pendant une semaine, mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu’elle surnommait Toutou. Une correspondance naît de leur relation ; au dos des lettres qu’Apollinaire envoyait au début au rythme d’une par jour ou tous les deux jours, puis de plus en plus espacées, se trouvent des poèmes qui furent rassemblés plus tard sous le titre de Ombre de mon amour puis de Poèmes à Lou. Sa déclaration d’amour, dans une lettre datée du 28 septembre 1914, commençait en ces termes : « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d’hier soir, j’éprouve maintenant moins de gêne à vous l’écrire. Je l’avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m’avaient tant troublé que je m’en étais allé aussi tôt que possible afin d’éviter le vertige qu’ils me donnaient. » Mais la jeune femme ne l’aimera jamais comme il l’aurait voulu ; elle refuse de quitter Toutou et à la veille du départ d’Apollinaire pour le front, en mars 1915, ils rompent en se promettant de rester amis. Il part avec le 38e régiment d’artillerie de campagne pour le front de Champagne le 4 avril 1915. Malgré les vicissitudes de l’existence en temps de guerre, il écrit dès qu’il le peut pour garder le moral et rester poète (Case d’Armons), et une abondante correspondance avec Lou, ses nombreux amis, et une jeune fille, Madeleine Pagès, qu’il avait rencontrée dans le train, le 2 janvier 1915, au retour d’un rendez-vous avec Lou. Une fois sur le front, il lui envoie une carte, elle lui répond et ainsi, débute une correspondance vite enflammée qui débouche en août et toujours par correspondance, à une demande en mariage. En novembre 1915, dans le but de devenir officier, Wilhelm de Kostrowitzky est transféré à sa demande dans l’infanterie dont les rangs sont décimés. Il entre au 96e régiment d’infanterie avec le grade de sous-lieutenant puis à Noël, il part pour Oran retrouver sa fiancée pour sa première permission. Il commence aussi, en juillet 1915, une correspondance avec la poétesse Jeanne Burgues-Brun, qui devient sa marraine de guerre. Ces lettres seront publiées en 1948 par les éditions Pour les fils de roi, puis à partir de 1951 par les éditions Gallimard. Le 9 mars 1916, il obtient sa naturalisation française mais quelques jours plus tard, le 17 mars 1916, il est blessé à la tempe par un éclat d’obus. Il lisait alors le Mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Paris, il y sera finalement trépané le 10 mai 1916 puis entame une longue convalescence au cours de laquelle il cesse d’écrire à Madeleine. Fin octobre, son recueil de contes, Le Poète Assassiné est publié et la parution est couronnée, le 31 décembre, par un mémorable banquet organisé par ses amis dans l’Ancien Palais d’Orléans. Dernières années En mars 1917, il crée le terme de surréalisme qui apparaît dans une de ses lettres à Paul Dermée et dans le programme du ballet Parade qu’il rédigea pour la représentation du 18 mai. Le 11 mai, il est déclaré définitivement inapte à faire campagne aux armées par la commission médicale et reclassé dans un service auxiliaire. Le 19 juin 1917, il est rattaché au ministère de la guerre qui l’affecte à la Censure. Le 24 juin, il fait jouer sa pièce Les Mamelles de Tirésias (sous-titrée Drame surréaliste en deux actes et un prologue) dans la salle du conservatoire Renée Maubel, aujourd’hui théâtre Galabru. Le 26 novembre, il se dit souffrant et fait prononcer par le comédien Pierre Bertin, sa fameuse conférence L’Esprit Nouveau au théâtre du Vieux Colombier. En 1918, les Éditions Sic publient sa pièce Les Mamelles de Tirésias. Son poème, La jolie rousse, dédié à sa nouvelle compagne, paraît en mars dans la revue L’Éventail. En avril, le Mercure de France publie son nouveau recueil de poésies, Calligrammes. Le 2 mai, il épouse Jacqueline (la « jolie rousse » du poème), à qui l’on doit de nombreuses publications posthumes des œuvres d’Apollinaire. Il a pour témoins Picasso, Gabrièle Buffet et le célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. Affecté le 21 mai au bureau de presse du Ministère des Colonies, il est promu lieutenant le 28 juillet. Après une permission de trois semaines auprès de Jacqueline, à Kervoyal (à Damgan, dans le Morbihan), il retourne à son bureau du ministère et continue parallèlement à travailler à des articles, à un scénario pour le cinéma, et aux répétitions de sa nouvelle pièce, Couleur du temps. Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt chez lui au 202 boulevard Saint-Germain le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, « grippe intestinale compliquée de congestion pulmonaire » ainsi que l’écrit Paul Léautaud dans son journal du 11 novembre 1918. Alors qu’il agonise par asphyxie, les Parisiens défilent sous ses fenêtres en criant « À mort Guillaume ! », faisant référence non au poète mais à l’empereur Guillaume II d’Allemagne qui a abdiqué le même jour . Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Histoire de son monument funéraire En mai 1921, ses compagnons et intimes constituent un comité afin de collecter des fonds pour l’exécution, par Picasso, du monument funéraire de sa tombe. Soixante cinq artistes offrent des œuvres dont la vente aux enchères à la Galerie Paul Guillaume, les 16 et 18 juin 1924, rapporte 30 450 francs. En 1927 et 1928, Picasso propose deux projets mais aucun n’est retenu. Le premier est jugé obscène par le comité. Pour le second – une construction de tiges en métal – Picasso s’est inspiré du « monument en vide » créé par l’oiseau du Bénin pour Croniamantal dans Le Poète assassiné. À l’automne 1928, il réalise quatre constructions avec l’aide de son ami Julio Gonzalez, peintre, orfèvre et ferronnier d’art, que le comité refuse ; trois sont conservés au Musée Picasso à Paris, la quatrième appartient à une collection privée. Finalement c’est l’ami d’Apollinaire, le peintre Serge Férat qui dessine le monument-menhir en granit surmontant la tombe au cimetière du Père-Lachaise, division 86. La tombe porte également une double épitaphe extraite du recueil Calligrammes, trois strophes discontinues de Colline, qui évoquent son projet poétique et sa mort, et un calligramme de tessons verts et blancs en forme de cœur qui se lit « mon cœur pareil à une flamme renversée ». Regards sur l’œuvre Influencé par la poésie symboliste dans sa jeunesse, admiré de son vivant par les jeunes poètes qui formèrent plus tard le noyau du groupe surréaliste (Breton, Aragon, Soupault– Apollinaire est l’inventeur du terme « surréalisme »), il révéla très tôt une originalité qui l’affranchit de toute influence d’école et qui fit de lui un des précurseurs de la révolution littéraire de la première moitié du XXe siècle. Son art n’est fondé sur aucune théorie, mais sur un principe simple : l’acte de créer doit venir de l’imagination, de l’intuition, car il doit se rapprocher le plus de la vie, de la nature. Cette dernière est pour lui « une source pure à laquelle on peut boire sans crainte de s’empoisonner » (Œuvres en prose complètes, Gallimard, 1977, p. 49). Mais l’artiste ne doit pas l’imiter, il doit la faire apparaître selon son propre point de vue, de cette façon, Apollon, Ades et Zeus se battirent, mais ce fut Athéna qui gagna parle d’un nouveau lyrisme. L’art doit alors s’affranchir de la réflexion pour pouvoir être poétique. « Je suis partisan acharné d’exclure l’intervention de l’intelligence, c’est-à-dire de la philosophie et de la logique dans les manifestations de l’art. L’art doit avoir pour fondement la sincérité de l’émotion et la spontanéité de l’expression : l’une et l’autre sont en relation directe avec la vie qu’elles s’efforcent de magnifier esthétiquement » dit Apollinaire (entretien avec Perez-Jorba dans La Publicidad). L’œuvre artistique est fausse en ceci qu’elle n’imite pas la nature, mais elle est douée d’une réalité propre, qui fait sa vérité. Apollinaire se caractérise par un jeu subtil entre modernité et tradition. Il ne s’agit pas pour lui de se tourner vers le passé ou vers le futur, mais de suivre le mouvement du temps. Il utilise pour cela beaucoup le présent, le temps du discours dans ses poèmes notamment dans le recueil Alcools. Il situe ses poèmes soit dans le passé, soit dans le présent mais s’adresse toujours à des hommes d’un autre temps, souvent de l’avenir. D’ailleurs, « On ne peut transporter partout avec soi le cadavre de son père, on l’abandonne en compagnie des autres morts. Et l’on se souvient, on le regrette, on en parle avec admiration. Et si on devient père, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un de nos enfants veuille se doubler pour la vie de notre cadavre. Mais nos pieds ne se détachent qu’en vain du sol qui contient les morts » (Méditations esthétiques, Partie I : Sur la peinture). C’est ainsi que le calligramme substitue la linéarité à la simultanéité et constitue une création poétique visuelle qui unit la singularité du geste d’écriture à la reproductibilité de la page imprimée. Apollinaire prône un renouvellement formel constant (vers libre, monostiche, création lexicale, syncrétisme mythologique). Enfin, la poésie et l’art en général sont un moyen pour l’artiste de communiquer son expérience aux autres. C’est ainsi qu’en cherchant à exprimer ce qui lui est particulier, il réussit à accéder à l’universel. Enfin, Apollinaire rêve de former un mouvement poétique global, sans écoles, celui du début de XXe siècle, période de renouveau pour les arts et l’écriture, avec l’émergence du cubisme dans les années 1900, du futurisme italien en 1909 et du dadaïsme en 1916. Il donnera par ailleurs à la peinture de Robert Delaunay et Sonia Delaunay le terme d’orphisme, toujours référence dans l’histoire de l’art. Apollinaire entretient des liens d’amitié avec nombre d’artistes et les soutient dans leur parcours artistique (voir la conférence « La phalange nouvelle »), tels les peintres Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse et Henri Rousseau. Son poème Zone a influencé le poète italien contemporain Carlo Bordini et le courant dit de “ Poésie narrative ”. Derrière l’œuvre du poète, on oublie souvent l’œuvre de conteur, en prose, avec des récits tels que Le Poète assassiné ou La Femme assise, qui montrent son éclectisme et sa volonté de donner un genre nouveau à la prose, en opposition au réalisme et au naturalisme en vogue à son époque. À sa mort, on a retrouvé de nombreuses esquisses de romans ou de contes, qu’il n’a jamais eu le temps de traiter jusqu’au bout. Œuvres Poésie * Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, illustré de gravures par Raoul Dufy, Deplanche, 1911. Réédité dans son format original par les éditions Prairial, 2017. Cet ouvrage a également été illustré de lithographies en couleurs par Jean Picart Le Doux. * Alcools, recueil de poèmes composés entre 1898 et 1913, Mercure de France, 1913. * Vitam impendere amori, illustré par André Rouveyre, Mercure de France, 1917. * Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, Mercure de France, 1918. * Aquarelliste * Il y a..., recueil posthume, Albert Messein, 1925. * Ombre de mon amour, poèmes adressés à Louise de Coligny-Châtillon, Cailler, 1947. * Poèmes secrets à Madeleine, édition pirate, 1949. * Le Guetteur mélancolique, recueil posthume de poèmes inédits, Gallimard, 1952. * Poèmes à Lou, Cailler, recueils de poèmes pour Louise de Coligny-Châtillon, 1955. * Soldes, poèmes inédits, Fata Morgana, 1985 * Et moi aussi je suis peintre, album d’idéogrammes lyriques coloriés, resté à l’état d’épreuve. Les idéogrammes seront insérés dans le recueil Calligrammes, Le temps qu’il fait, 2006. Romans et contes * Mirely ou le Petit Trou pas cher, roman érotique écrit sous pseudonyme pour un libraire de la rue Saint-Roch à Paris, 1900 (ouvrage perdu). * Que faire ?, roman-feuilleton paru dans le journal Le Matin, signé Esnard, auquel G.A. sert de nègre. * Les Onze Mille Verges ou les Amours d’un hospodar, roman érotique publié sous couverture muette, 1907. * L’Enchanteur pourrissant, illustré de gravures d’André Derain, Kahnweiler, 1909. * L’Hérésiarque et Cie, contes, Stock, 1910. * Les Exploits d’un jeune Don Juan, roman érotique, publié sous couverture muette, 1911. Le roman a été adapté au cinéma en 1987 par Gianfranco Mingozzi sous le même titre. * La Rome des Borgia, qui est en fait de la main de René Dalize, Bibliothèque des Curieux, 1914. * La Fin de Babylone– L’Histoire romanesque 1/3, Bibliothèque des Curieux, 1914. * Les Trois Don Juan– L’Histoire romanesque 2/3, Bibliothèque de Curieux, 1915. * Le Poète assassiné, contes, L’Édition, Bibliothèque de Curieux, 1916. * La Femme assise, inachevé, édition posthume, Gallimard, 1920. Version digitale chez Gallica * Les Épingles, contes, 1928. * Le Corps et l’Esprit (Inventeurs, médecins & savants fous), Bibliogs, Collection Sérendipité, 2016. Contient les contes : « Chirurgie esthétique » et « Traitement thyroïdien » publiés en 1918. Ouvrages critiques et chroniques * La Phalange nouvelle, conférence, 1909. * L’Œuvre du Marquis de Sade, pages choisies, introduction, essai bibliographique et notes, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1909, première anthologie publiée en France sur le marquis de Sade. * Les Poèmes de l’année, conférence, 1909. * Les Poètes d’aujourd’hui, conférence, 1909. * Le Théâtre italien, encyclopédie littéraire illustrée, 1910 * Pages d’histoire, chronique des grands siècles de France, chronique historique, 1912 * La Peinture moderne, 1913. * Les Peintres cubistes. Méditations esthétiques, Eugène Figuière & Cie, Éditeurs, 1913, Collection « Tous les Arts » ; réédition Hermann, 1965 (ISBN 978-2-7056-5916-5) * L’Antitradition futuriste, manifeste synthèse, 1913. * L’Enfer de la Bibliothèque nationale avec Fernand Fleuret et Louis Perceau, Mercure de France, Paris, 1913 (2e édit. en 1919). * Le Flâneur des deux rives, chroniques, Éditions de la Sirène, 1918. * L’Œuvre poétique de Charles Baudelaire, introduction et notes à l’édition des Maîtres de l’amour, Collection des Classiques Galants, Paris, 1924. * Anecdotiques, notes de 1911 à 1918, édité post mortem chez Stock en 1926 * Les Diables amoureux, recueil des travaux pour les Maîtres de l’Amour et le Coffret du bibliophile, Gallimard, 1964.Références : * Œuvres en prose complètes. Tomes II et III, Gallimard, " Bibliothèque de la Pléiade ", 1991 et 1993. * Petites merveilles du quotidien, textes retrouvés, Fata Morgana, 1979. * Petites flâneries d’art, textes retrouvés, Fata Morgana, 1980. Théâtre et cinéma * Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en deux actes et un prologue, 1917. * La Bréhatine, scénario de cinéma écrit en collaboration avec André Billy, 1917. * Couleur du temps, 1918, réédition 1949. * Casanova, Comédie parodique (préf. Robert Mallet), Paris, Gallimard, 1952, 122 p. (OCLC 5524823) Correspondance * Lettres à sa marraine 1915–1918, 1948. * Tendre comme le souvenir, lettres à Madeleine Pagès, 1952. * Lettres à Lou, édition de Michel Décaudin, Gallimard, 1969. * Lettres à Madeleine. Tendre comme le souvenir, édition revue et augmentée par Laurence Campa, Gallimard, 2005. * Correspondance avec les artistes, Gallimard, 2009. * Correspondance générale, éditée par Victor Martin-Schmets. 5 volumes, Honoré Champion, 2015. Journal * Journal intime (1898-1918), édition de Michel Décaudin, fac-similé d’un cahier inédit d’Apollinaire, 1991. Postérité * En 1941, un prix Guillaume-Apollinaire fut créé par Henri de Lescoët et était à l’origine destiné à permettre à des poètes de partir en vacances. En 1951, la partie occidentale de la rue de l’Abbaye dans le 6e arrondissement de Paris est rebaptisée en hommage rue Guillaume-Apollinaire. * Un timbre postal, d’une valeur de 0,50 + 0,15 franc a été émis le 22 mai 1961 à l’effigie de Guillaume Apollinaire. L’oblitération « Premier jour » eut lieu à Paris le 20 mai. * En 1999, Rahmi Akdas publie une traduction en turc des Onze mille verges, sous le titre On Bir Bin Kirbaç. Il a été condamné à une forte amende « pour publication obscène ou immorale, de nature à exciter et à exploiter le désir sexuel de la population » et l’ouvrage a été saisi et détruit. * Son nom est cité sur les plaques commémoratives du Panthéon de Paris dans la liste des écrivains morts sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. * La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède la bibliothèque personnelle de Guillaume Apollinaire, acquise par la ville en 1990, qui regroupe environ 5 000 ouvrages d’une très grande variété. Le don de Pierre-Marcel Adéma, premier biographe véritable d’Apollinaire ainsi que celui de Michel Décaudin, spécialiste de l’écrivain, qui offrit sa bibliothèque de travail, ont permis d’agrandir le fonds Guillaume Apollinaire. * Ce n’est que le 29 septembre 2013 que l’œuvre de Guillaume Apollinaire est entrée dans le domaine public, soit après 94 ans et 272 jours,. * La vente d’une centaine de souvenirs dont plusieurs sculptures africaines, provenant de son ancien appartement du 202, boulevard Saint-Germain à Paris, a eu lieu à Corbeil le 24 juin 2017. Adaptations de ses œuvres Au cinéma * Les Onze Mille Verges, film français de Éric Lipmann, 1975. * Les Exploits d’un jeune Don Juan (L’Iniziazione), adaptation cinématographique de Gianfranco Mingozzi, production franco-italienne, 1987. En albums illustrés * Le Apollinaire, textes de Apollinaire, illustré par Aurélia Grandin, Mango, collection Dada, 2000 (ISBN 978-2740410455) * Les Onze Mille Verges, roman illustré par Tanino Liberatore, Drugstore, 2011 (ISBN 978-2723480635) * Il y a, poème illustré par Laurent Corvaisier, Paris, éditions Rue du monde, 2013 (ISBN 978-2355042768) En musique * Antoine Tomé a mis cinq de ses poèmes en musique dans son album Antoine Tomé chante Ronsard & Apollinaire. * Dimitri Chostakovitch a mis six de ses poèmes en musique dans sa symphonie no 14 op. 135 (1969) * Guillaume, poèmes d’Apollinaire mis en musique par Desireless et Operation of the sun. Sortie de l’album en 2015 ; Création du spectacle en 2016. Bibliographie Essais * Claude Bonnefoy, Apollinaire, Classiques du XXe siècle, 1969. * Pierre-Marcel Adéma et Michel Décaudin, Album Apollinaire, iconographie commentée, coll. « Les albums de la Pléiade » no 10, Paris, Gallimard, 1971, (ISBN 2070800016). * Franck Balandier, Les Prisons d’Apollinaire, L’Harmattan, 2001. * Laurence Campa, Apollinaire, Gallimard, NRF biographie, juin 2013 (ISBN 2070775046). * Laurent Grison, Apologie du poète, contribution au projet du 18e Printemps des Poètes (2016) sur le thème : Le Grand XXe siècle– Cent ans de poésie. Texte sur Guillaume Apollinaire, 2015. * Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018. Bande dessinée * Julie Birmant (texte), Clément Oubrerie (dessin), Pablo, tome 2 : Guillaume Apollinaire, Paris, Dargaud, 2012 (ISBN 978-2-205-07017-0) Autres * Bernard Bastide (dir.), Laurence Campa et al. (préf. Christian Giudicelli), Balade dans le Gard : sur les pas des écrivains, Paris, Alexandrines, coll. « Les écrivains vagabondent » (réimpr. 2014) (1re éd. 2008), 255 p. (ISBN 978-2-370890-01-6, présentation en ligne), « Guillaume Apollinaire entre avenir et souvenir », p. 134-139. * Serge Velay (dir.), Michel Boissard et Catherine Bernié-Boissard, Petit dictionnaire des écrivains du Gard, Nîmes, Alcide, 2009, 255 p. (présentation en ligne), p. 18. * Jacques Ibanes, L’Année d’Apollinaire : 1915, l’amour, la guerre, Paris, Fauves Editions, 2016 (ISBN 979-1-030-20025-6 et 978-9-791-03020-5, OCLC 951783881). * Raphaël Jérusalmy, Les obus jouaient à pigeon vole, Paris, Éditions Bruno Doucey, coll. « Sur le fil », 2016, 177 p. (ISBN 978-2-362-29094-7, OCLC 936577432). * Laurence des Cars (dir.), Apollinaire : le regard du poète, Paris, Musées d’Orsay et de l’Orangerie ; Gallimard, 2016, 318 p. (ISBN 978-2-070-17915-2, OCLC 971143350). Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire


Auguste Angellier, né le 1er juillet 1848 à Dunkerque et mort le 28 février 1911 à Boulogne-sur-Mer est un poète et universitaire français, qui fut le premier professeur de langue et littérature anglaises de la Faculté des lettres de Lille, avant d'en être son doyen de 1897 à 1900. Critique et historien de la littérature, il fit sensation à la Sorbonne en attaquant les théories d'Hippolyte Taine dans sa thèse sur Robert Burns en 1893. Biographie Né le 1er juillet 1848 à Dunkerque (Nord), d'un père maître-plafonnier et d'une mère secrétaire, Auguste Angellier fut scolarisé à Boulogne-sur-Mer où sa mère l'emmène après s'être séparée de son mari en 1853. Son attachement à cette ville ne se démentit jamais. Jeune homme, il prépare le concours de l'École normale supérieure au Lycée Louis-le-Grand de Paris en 1866. Entre l'écrit et l'oral du concours, il est expulsé du lycée par le censeur qui le considère, à tort selon certains, comme le chef d'un mouvement de révolte concernant la mauvaise qualité de la nourriture à la cantine. Cet épisode catastrophique de sa vie scolaire le pousse à partir, par manque de moyens financiers, pour l'Angleterre où on lui offre un emploi d'enseignant dans un petit pensionnat. Engagé volontaire au cours de la guerre de 1870, il se retrouve à Lyon puis à Bordeaux. Une infection respiratoire grave le fait rentrer à Paris, pendant la Commune, et, la guerre terminée, il est nommé répétiteur en 1871 au Lycée Louis-Descartes (il avait été enfin autorisé à rentrer dans le giron de l’Instruction publique). Il décroche sa licence peu après. Reçu au certificat d’aptitude à l’enseignement de l’anglais, deux ans plus tard, il professe en tant que « maître-répétiteur » pendant trois ans, période exigée à l’époque avant de pouvoir s’inscrire à l’agrégation. Il obtient ce concours à 28 ans, et enseigne aussitôt au lycée Charlemagne, jusqu’à son départ en Angleterre en 1878. Angellier cultive de nombreuses amitiés littéraires, et développe sa sensibilité de poète (sa notoriété lui viendra davantage de son travail universitaire que de son œuvre poétique). Jusqu’à cette période, il hésite entre le journalisme et l’enseignement, mais le congé qui vient de lui être accordé lui permet de s’intéresser au projet de réforme des études de langues vivantes en France (à travers l’étude du fonctionnement des universités anglaises). C’est avec plaisir qu’il s’éloigne un moment de la lourdeur administrative qui lui pèse tant dans sa fonction d’enseignant. En 1881, un poste de maître de conférences, à Douai, lui ouvre une brillante carrière de professeur d’anglais (la faculté des Lettres de Douai va être transférée à Lille en 1887). Douze années plus tard, il soutient ses deux thèses, chacune consacrée à un poète : la « majeure » à l’Écossais Robert Burns, et la thèse complémentaire à John Keats, thèse rédigée en latin ! Le titre de cette dernière : De Johannis Keatsii, vita et Carminibus ; son auteur : Augustus Angellier, literarum doctor in Universitate Insulensi Professor. Même les citations des poèmes de Keats sont en latin (et l’université dont il est question n’est autre que celle de Lille : Universitate Insulensi). Dès lors, Angellier porte le titre de Professeur. De plus, il assure la fonction de président du jury d’agrégation d’anglais de 1890 à 1904 ; et dès février 1897, il assume la tâche de doyen, et les lourdes responsabilités administratives qui s’y attachent. En 1902, détachement (sur un poste de maître de conférences) à l’École normale supérieure, puis retour à Lille en 1904. Auguste Angellier est mort à 62 ans, le 28 février 1911, à Boulogne-sur-Mer. Œuvres En 1896, Angellier le poète a publié À l’amie perdue (178 sonnets inspirés par le chagrin de son histoire d'amour cachée avec Thérèse Fontaine1), et en 1903, Le chemin des saisons. D’autres œuvres suivent : Dans la lumière antique, deux livres de Dialogues et deux d’Épisodes. Curiosité Le compositeur polonais Henryk Opieński (1870-1942) qui dirigeait à Morges (Suisse) l'ensemble Motet et Madrigal a écrit une œuvre pour chœur à 4 voix d'hommes sur le texte poétique La Fuite de l'Hiver qui fait partie du recueil Le chemin des saisons d'Auguste Angellier. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Angellier


Manuel José Quintana y Lorenzo (Madrid; 11 de abril de 1772 - ídem; 11 de marzo de 1857), poeta español de la Ilustración y una de las figuras más importantes en la etapa de transición al Romanticismo. Hijo de padres extremeños, estudió en Madrid primeras letras y después latinidad en Córdoba con Manuel de Salas. Después vuelve a Madrid, donde ya el 14 de julio de 1787 recita una oda en la Academia de San Fernando. Pasó a estudiar Derecho en Salamanca, donde se llevó muy bien con el rector liberal Diego Muñoz-Torrero, pero no con quien le sucedió, Tejerizo, quien lo expulsó en 1793, aunque fue readmitido al año siguiente. Sus maestros salmantinos, en derecho y poesía, fueron los neoclásicos Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala, Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Gaspar Melchor de Jovellanos.


Rémy Belleau, né à Nogent-le-Rotrou en 1528, mort à Paris le 6 mars 1577, est un poète français de la Pléiade. Biographie Belleau a commencé ses études chez les moines de l’abbaye Saint-Denis à Nogent-le-Rotrou avant de les poursuivre, vers 1553, à Paris où il complète une formation dominée par l’amour de la poésie grecque. Intelligent sans surcharge d’érudition, il était avant tout un homme qui plaisait[réf. nécessaire]. Il rejoint bientôt le groupe du collège de Coqueret (Pierre de Ronsard, Antoine de Baïf, Joachim du Bellay), puis la Pléiade en 1554, avec qui il prend part à la Pompe du bouc. Il publie en 1556 une traduction des Odes d’Anacréon: le succès de ce lyrisme léger est considérable. Bien qu’un peu sèche selon Ronsard, cette traduction vient enrichir la «Brigade» d’un nouveau style; elle a pour elle la fidélité et l’exactitude qui en firent le succès[réf. nécessaire]. On lui doit également la traduction du Cantique des Cantiques et de l’Ode à l’Aimée de Sappho. De fait, Belleau est le premier traducteur français de la poétesse de Lesbos. La même année, Belleau célèbre dans les Petites Inventions fleurs, fruits, pierres précieuses, animaux et feront plus tard écho à la rage de l’expression de Francis Ponge. Ses poèmes personnels manquaient encore d’originalité[réf. nécessaire] et il fallut attendre 1565 pour découvrir sa Bergerie, chef-d’œuvre de la poésie pastorale dont l’Avril dévoile un érotisme à fleur de sein. En 1576, paraissent Les Amours et Nouveaux Eschanges des pierres précieuses, vertus et propriétés d’icelles. Cette œuvre, décrite comme une «épopée minérale» par R. Sabatier, raconte les propriétés des pierres, leur histoire, le mythe de leur origine en associant la symbolique des pierres aux interprétations philosophiques et scientifiques. Selon certains le moins lyrique des poètes de la Pléiade, le plus pudique au dire d’autres, Rémy Belleau ne déborde certainement pas d’imagination et il imita plus qu’il ne créa, mais il demeure un orfèvre du verbe[réf. nécessaire]. Son talent élégant et facile le fit surnommer par ses contemporains le gentil Belleau. Après avoir initialement penché pour la Réforme, l’auteur se rallie au parti des Guise, ses protecteurs, notamment René II de Lorraine-Guise. Précepteur à Paris de Charles de Lorraine, il résidera jusqu’à sa mort (1577) à l’hôtel de Guise. Pierre de Ronsard qui faisait grand cas de Belleau, et l’appelait le Peintre de la nature, a rédigé son épitaphe: Ne taillez, mains industrieuses Des pierres pour couvrir Belleau, Lui-même a basti son tombeau Dedans ses Pierres Précieuses. Œuvre Œuvres poétiques Il a publié en 1565 un poème, la Bergerie, dans le genre pastoral et les Amours et nouveaux échanges de pierres précieuses en 1576, un recueil qui associe la symbolique des pierres aux interprétations philosophiques et scientifiques. Certain de ses poèmes furent mis en musique par Pierre Cléreau. Ses Œuvres ont été réunies à Rouen en 1604, 2 volumes in-12. Rémy Belleau, La bergerie (Texte en moyen français), Paris, G. Gilles, 1565, 127 p.; in-8 (notice BnF no FRBNF30079761)La bergerie disponible sur Gallica Rémy Belleau, Chant pastoral de la paix, Paris, A. Wechel, 1559, 10 f.; in-4 (notice BnF no FRBNF30079763)Chant pastoral de la paix disponible sur Gallica Rémy Belleau, Épithalame sur le mariage de Monseigneur le duc de Lorraine et de Madame Claude, fille du roy, chanté par les nymphes de Seine et de Meuse, Paris, A. Wechel, 1559, 15 p.; in-4 (notice BnF no FRBNF30079764)Épithalame sur le mariage de Monseigneur le duc de Lorraine disponible sur Gallica Rémy Belleau (trad. Florent Chrestien), Sylva cui titulus Veritas fugiens ex R. Bellaquei gallicis versibus latina facta a Florente Christiano, Lutetiæ, ex officina R. Stephani, 1561, In-4°, 12 p. (notice BnF no FRBNF30079773)Sylva cui titulus Veritas fugiens disponible sur Gallica Les Amours et nouveaux échanges des pierres précieuses, Paris, M. Patisson, 1576; Œuvres poétiques, éd. Ch. Marty-Laveaux, A. Lemerre, 1878, t. II. l’Eschole de Salerne en vers burlesques et poema macaroanicvm de bello Hvgvenortica, traduit par Louis Martin en 166o,à Rouen chez Clement Malassis.( source Bnf: data.bnf.fr) Traductions Rémy Belleau a traduit en vers: Les odes d’Anacréon: traduites de grec en françois, par Rémy Belleau, ensemble de quelques petites hymnes de son invention (trad. Rémy Belleau), Paris, A. Wechel, 1556, 1 vol.; in-8 (notice BnF no FRBNF30017685)Les odes d’Anacréon disponible sur Gallica L’ Ecclésiaste Le Cantique des cantiques. Œuvres dramatiques Il jouait dans les pièces de son ami Jodelle, et il a lui-même fait une comédie intitulée la Reconnue. La Reconnue, comédie. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9my_Belleau

Casimir Jean François Delavigne, né le 4 avril 1793 au Havre et mort 11 décembre 1843 à Lyon, est un poète et dramaturge français. Delavigne connaît la célébrité lorsque, après la défaite de Waterloo, il publie ses Premières Messéniennes. « Les pleurs qu’il répandit sur les généreuses victimes de Waterloo, l’anathème qu’il prononça contre les spoliateurs de nos musées, et les sages conseils qu’il donna à ses compatriotes sur le besoin de s’unir contre l’étranger, tous ces sentiments exprimés en vers énergiques, trouvèrent en France des milliers d’échos et rendirent le nom de l’auteur aussi populaire que s’il s’était signalé depuis longtemps »[réf. nécessaire]. Ses origines Son père, Louis-Augustin-Anselme Delavigne, était arpenteur géographe des forêts du Roi. La chute de Louis XVI entraîne aussi celle d’Anselme, fonctionnaire royal. En 1793, la famille prend la route du Havre, où Anselme Delavigne devient armateur avec ses deux frères, Jean-Fortuné et César-Casimir. À cette époque se crée une importante liaison maritime, l’Angleterre recevant son lot d’émigrés. Lorsque la Révolution vacille sur ses arrières, quelques-uns de ceux-ci repassent la Manche pour aller rejoindre Bonchamps et La Rochejaquelein en Vendée. À ce petit jeu fort profitable (il en coûte des fortunes aux passagers), Anselme risque gros. On l’arrête et le 5 avril 1793, jour de la naissance de Casimir Delavigne, son père est au fond d’un cachot. Dans ce monde de bourgeoisie havraise, son épouse trouve une demoiselle Devienne, poétesse, artiste dramatique et confidente des Delavigne pour s’entremettre et intervenir auprès de Robespierre. Anselme se sort discrètement de ce mauvais pas et devient ce négociant estimé de ses concitoyens comme le rapporte la chronique du temps, Le Mercure de Londres, paru en 1834. Après cette entreprise, en 1808, Anselme se lance dans la faïencerie, il fabrique dans son entreprise des assiettes et des plats décoratifs mais, en 1816, les affaires sont si désastreuses qu’il ferme la fabrique. Les années d’enfance Son biographe et frère a écrit : « Il naquit au Havre le 5 avril 1793, au numéro 27 du quai Sollier dans le vieux quartier Saint-François. Il était fils d’un négociant justement considéré, son enfance ne présentait rien de remarquable. Malgré son esprit vif, il ne triompha qu’avec peine de ses premières études ». Il apprend à lire et à compter dans sa ville du Havre auprès de l’abbé Trupel puis en 1801 Casimir rejoint son frère au lycée Henri-IV, il n’a alors que 8 ans. On trouve aujourd’hui un buste de Casimir Delavigne au lycée Henri-IV. Dans ces années, il se fait remarquer—note son frère—par la bonté de son caractère et son application à l’étude. C’est à quatorze ans que ses facultés se développent. Bon écolier, son goût pour la poésie se révèle. Sur les bancs du collège il se lie d’une rare amitié avec Eugène Scribe. Ensemble ils forment des plans d’avenir. Casimir veut être poète. Scribe se destine au barreau ; il deviendra un célèbre auteur dramatique et compositeur d’opérettes aujourd’hui oubliées. En l’absence de sa famille havraise, jeune homme, Casimir est reçu, les jours de liberté, par son oncle Andrieux, avoué à Paris, un ami de Crébillon qui aime et cultive les belles lettres. Casimir lui ayant soumis ses premiers vers, il lui prédit les plus amers désappointements et l’encourage surtout à « se disposer à faire son droit ». Poème pour la naissance du roi de Rome Alors qu’il est encore élève, la naissance du roi de Rome lui offre l’occasion de se faire remarquer. Il compose un « dithyrambe, renfermant des beautés poétiques de l’ordre le plus élevé, écrit son frère. Son oncle Andrieux, juge si bien la chose qu’il lui promet alors une carrière et de véritables succès. Cet encenseur de Napoléon Ier, n’est pourtant pas un foudre de guerre. Il est dispensé de service militaire, réformé, en raison d’une légère surdité qui par la suite disparaîtra complètement. Ce poème fameux, remarqué à la cour, par le comte Antoine Français de Nantes, alors directeur des Droits réunis (contributions indirectes), lui permet de trouver dans ses services un asile, sous couvert d’un petit emploi. Il entre dans son bureau en 1813, sa seule obligation étant de s’y présenter à chaque fin de mois. Il s’efforce de mériter cette bienveillance par ses succès. Auteur d’un poème épique Charles XII à Narva, l’Académie lui remarque un esprit sage, de brillantes qualités, et lui accorde une mention honorable. Rue des Rosiers, au coin de la rue Pavée, la colonie Delavigne est réunie. Germain, son frère et Casimir sont devenus soutiens de famille. Leur père Anselme est ruiné, son épouse (Meyotte), sa fille Louise et le petit Fortuné, étudiant au lycée Napoléon, l’accompagnent. En outre, la tante Aupoix, sœur d’Anselme accompagnée de ses deux serviteurs noirs, Rose et César, qui l’ont accompagnée depuis Saint-Domingue, a trouvé, elle aussi, refuge chez ses neveux. Même la nourrice du poète, la vieille Babet, a suivi la famille depuis le Havre. La découverte de la vaccine L’année suivante, en 1814, le sujet académique imposé est « La découverte de la Vaccine ». Il tente une nouvelle fois la fortune. Il rencontre chez le comte Français le docteur Parisot, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine. Parisot, qui fait lui-même de bons vers, lui donne les explications les plus précises et ils vont même de compagnie vacciner dans les campagnes proches de Paris. Quelques vers techniques consciencieux donnent avec un rare bonheur les effets de ces vaccins. Ces vers seront alors extrêmement appréciés et dans les livres scolaires de littérature choisie, ces vers étaient encore présents jusqu’en 1950. Voici 14 des 218 vers que contient le poème : « Par le fer délicat dont le docteur arme ses doigts, Le bras d’un jeune enfant est effleuré trois fois. Des utiles poisons d’une mamelle impure, Il infecte avec art cette triple piqûre. Autour d’elle s’allume un cercle fugitif, Le remède nouveau dort longtemps inactif. Le quatrième jour a commencé d’éclore, Et la chair par degrés se gonfle et se colore. La tumeur en croissant de pourpre se revêt, S’arrondit à la base, et se creuse au sommet. Un cercle, plus vermeil de ses feux l’environne ; D’une écaille d’argent l’épaisseur la couronne ; Plus mûre, elle est dorée ; elle s’ouvre, et soudain Délivre la liqueur captive dans son sein ».Le ton, considéré comme trop didactique, l’empêche d’avoir le prix, mais d’un suffrage unanime, l’Académie lui décerne un accessit. Les trois premières Messéniennes Cependant les désastres de l’Empire avaient commencé et c’est avec une profonde douleur qu’il assiste à la chute de l’empereur et à l’invasion de la France. Après la funeste bataille de Waterloo, en juillet 1815, il publie ses premières Messéniennes : Waterloo, Les Malheurs de la guerre, puis Jeanne d’Arc et La Mort de Jeanne d’Arc. Les armées étrangères occupaient la France, les bons citoyens déploraient que leur pays fût ainsi mis hors de combat après 25 années de victoires. Le poète prend sa lyre et chante les vaincus. Il se fait courtisan des braves de la Vieille Garde. Dès lors, il mérite d’être appelé le poète national, le poète de la patrie. Il exprime, avec verve et enthousiasme, les regrets qui sont au fond des cœurs. Il fait acte de courage en se déclarant contre les vainqueurs. Quand il voit le musée du Louvre dévasté par les envahisseurs étrangers, ses statues emportées comme butins de guerre, il proteste avec éloquence contre ces abus de la victoire et adresse de touchants adieux à ces merveilles des arts. Comme citoyen, il rappelle fièrement aux étrangers que s’ils pouvaient emporter des statues, ils n’emporteraient pas nos titres de gloire. Bientôt les armées étrangères quittent le pays mais les rivalités de partis, l’avidité des faux serviteurs menacent les libertés renaissantes, alors celui qui avait rendu hommage aux morts de Waterloo fait un appel à l’union, celui qui sortait des bancs universitaires gourmande les partis avec une sagesse précoce. Son dernier adieu aux armées qui évacuent le sol français est un hymne à la concorde qui rend les peuples invincibles. Les livres second et troisième des Messéniennes confortent la popularité de l’écrivain, ils abordent l’histoire de la Grèce antique, Christophe Colomb, et des événements qui relatent la vie de ce début du XIXe siècle. La chute de l’empereur que Casimir Delavigne avait résumé ainsi : « Napoléon a oublié ses origines. Fils de la Liberté (1789) tu détrônas ta mère ». Le comte français est naturellement éloigné des affaires et Casimir perd son « emploi ». Le baron Pasquier, alors garde des Sceaux et chancelier de France, lit avec émotion le poème sur l’exil de Napoléon Ier, et le fait lire au roi qui le trouve très beau. Il fait appeler l’auteur et crée pour lui la place de bibliothécaire de la chancellerie. Les Vêpres siciliennes Libre de son temps et sécurisé par son emploi, toujours dans le genre héroïque, Casimir écrit en 1818 les Vêpres siciliennes, dont il sollicite la lecture au Théâtre-Français. Après deux ans d’attente, l’ouvrage est enfin écouté avec la défiance et la défaveur qu’accueille, ordinairement le coup d’essai d’un jeune homme. Un seul comédien, Thénard, trouve l’ouvrage intéressant et déclare : « J’y trouve la preuve que l’auteur un jour écrira très bien la Comédie ». La pièce est reçue mais à correction. Un an plus tard cette prédiction se réalise, bien que Casimir ait réclamé ensuite et obtenu une seconde lecture dont le résultat sera le refus définitif. L’aréopage appelé à se prononcer sur le mérite de la tragédie ne l’admet qu’à condition que l’auteur n’exige jamais qu’elle soit jouée. Une des dames qui siège au nombre des juges se montrera plus sévère que les autres, elle donne pour raison de son refus qu’il serait scandaleux de mettre le mot vêpres sur une affiche de spectacle. C’est à cette époque que Victor Hugo écrit dans la Gazette du Théâtre : « Casimir Delavigne – Comme auteur tragique, il a du mouvement et manque de sensibilité. Comme auteur comique a de l’esprit et point de gaieté ». Jugement sévère. Trois mois plus tard, Les Comédiens sont écrits, la plus vive et la plus gaie des comédies de l’époque. Elle sera jouée jusqu’en 1861. En 1818, l’Odéon ayant brûlé, le duc d’Orléans, le futur roi des Français (Louis-Philippe) fait reconstruire la salle et lui accorde le privilège de Second Théâtre-Français. Un comité de lecture de gens de lettres reçoit alors avec la plus grande ferveur les Vêpres siciliennes et l’on décide, que parmi tous les ouvrages reçus, celui-ci serait le premier joué au théâtre de l’Odéon. La première représentation a lieu le 23 octobre 1819, c’est un triomphe, la pièce attire une affluence considérable durant trois cents représentations successives, confirmant ainsi la qualité du poète et le choix du comité de lecture. Le théâtre encaisse plus de 400 000 francs lors des 100 premières représentations, somme considérable à cette époque. Le duc d’Orléans le fait bibliothécaire du Palais-Royal En 1821, pendant qu’il poursuivait sa carrière laborieuse avec Le Paria, les événements politiques marchaient très vite. Le ministre n’était plus le même, et comme le caractère indépendant et l’amour de la patrie du poète ne pouvaient convenir aux nouveaux agents du pouvoir, la place de bibliothécaire fut supprimée. Le duc d’Orléans, apprenant ce coup, lui offrit la place de bibliothécaire du Palais-Royal en lui écrivant : « Le tonnerre est tombé sur votre maison, je vous offre un appartement dans la mienne ». Casimir accepta avec reconnaissance. Le 15 décembre 1824, il acquiert une grande bâtisse blanche, construite une dizaine d’années auparavant, admirablement située sur une pente douce menant à la Seine, « La Madeleine », appartenant au général d’Empire Joseph François Dominique de Brémond (1773-1852). Ce bien était chargé d’histoire, car il avait appartenu au XIIe siècle au petit-fils de Richard de Vernon, Adjutor qui devint saint Adjutor, patron des mariniers. Il y fonda un lieu de prière sur lequel les moines bénédictins bâtirent un prieuré. Ce prieuré subsista jusqu’à la Révolution française. C’est sur les ruines de ce prieuré que le général de Brémond bâtit sa superbe demeure. Il y vint souvent, soit qu’il voulut trouver calme et solitude pour travailler, soit qu’il y vint chercher un lieu de repos. Scribe et son frère Germain, qui écrivaient ensemble, s’y installaient pour achever un vaudeville ou un livret d’opéra. Seul, Fortuné, le cadet fort discret n’y vint jamais, retenu par sa charge d’avoué à Paris. Bien que son amour pour la France, une grande fermeté de caractère jointe à une éloquence naturelle et une rectitude de jugement lui eussent permis de jouer un rôle utile et brillant dans les affaires du pays, il s’y refusa constamment, convaincu que les lettres, comme la politique, exigeaient un homme entier. Il refusa ainsi d’entrer à la chambre des députés, qui lui fut offert d’abord par la ville du Havre et ensuite par la ville d’Évreux. L’École des vieillards À ses yeux le plus sûr moyen de gagner les suffrages qui lui manquaient était d’écrire et de publier un titre nouveau. Ce fut L’École des vieillards, pour lequel il s’inspira de la pièce d’Alberto Nota, Les Premiers pas vers le mal. Cette pièce atteste un progrès réel de son auteur, et un critique en 1825 peut écrire dans le Mercure de Londres : « Vu du côté moral, elle offre une leçon utile à la vieillesse, sans l’immoler à la risée publique, sans acheter d’applaudissements aux dépens d’un âge qu’on ne saurait trop respecter ». Une revue des gens de lettres de 1834 la trouva moins originale que les œuvres de Béranger ou Lamartine, mais lui accorda « un talent si pur et si étendu qu’il peut se prêter avec grand succès à l’innovation littéraire ». Une réconciliation s’opéra avec les responsables du Théâtre-Français où l’École des vieillards attira un fidèle public. Au lendemain de l’École des vieillards, Casimir Delavigne est un homme célèbre que les jeunes poètes sont fiers de consulter. En 1825, l’Académie française se décida à ouvrir ses portes au poète que le public du théâtre de l’Odéon semblait avoir adopté. Elle le dédommagea de sa longue attente après les deux tentatives infructueuses. La première fois, il avait pour rival le célèbre Mgr Frayssinous, évêque d’Hermopolis. Son deuxième concurrent fut l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Lorsque des amis vinrent encore conseiller à Casimir Delavigne de se remettre sur les rangs, il repoussa leur offre, disant avec esprit : « Non, cette fois on m’opposerait le pape ». Pourtant, il finit par accepter de tenter sa chance au fauteuil du comte Ferrand. Son élection fut grandiose, obtenant 27 voix sur 28. Il ne participa que rarement à ces réunions de la société des gens de lettres. Il y soutint la candidature de Lamartine contre celle de Victor Hugo. Charles X lui accorda une pension de 1 200 francs. Mais celui-ci la refusa comme la Légion d’honneur que Monsieur de La Rochefoucault lui offrait au nom du roi, n’ayant semble-t-il pas confiance dans l’orientation politique du gouvernement mis en place, en raison d’une sévère restriction des maigres libertés accordées. Il préféra rester indépendant d’un pouvoir qu’il pouvait être amené à combattre. Voyage en Italie Un travail assidu compromit une santé déjà affaiblie. Les médecins ordonnèrent un voyage en Italie. Pendant ce périple dans le berceau des arts, il obtint un véritable triomphe tant il reçut de témoignages d’admirateurs. Pendant ces trois mois passés à Naples, il se refit une santé. Il visita Rome et Venise. C’est dans cette cité qu’il conçut la tragédie Marino Faliero. Pendant cet agréable séjour en Italie, il rédigea sept nouvelles Messéniennes. La première de Marino Faliero fut donnée au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 30 mai 1829. Il rencontra à Rome, en 1826, sa future épouse, Élise de Courtin. Élevée au pensionnat d’Écouen chez Mme Campan, elle avait été remarquée par l’empereur Napoléon Ier. Abandonnée par ses parents elle voulut s’empoisonner. La reine Hortense, mère du futur Napoléon III, elle aussi ancienne élève d’Écouen, émue par la situation de cette orpheline en fit sa protégée. Au fil des ans, la jeune fille devint sa lectrice et sa compagne préférée. Casimir entretint une correspondance assidue avec la jeune Élise d’un an plus âgée que lui. Il dut attendre trois ans le consentement de sa jolie conquête. Dès son retour à Paris, il offrit aux Parisiens une nouvelle œuvre, La Princesse Aurélie, spirituelle comédie qui ne connut qu’un bref succès. Un jeune poète que Casimir avait encouragé, écrivit maladroitement, dans un hebdomadaire, un article satirique dirigé contre Charles X. Le nommé Fonta, arrêté et jugé, fut jeté en prison. Casimir qui avait blâmé la violence de l’article fut profondément affligé par la rigueur de la peine : cinq années de prison, enfermé, avec des escrocs et des voleurs. La libération de ce garçon, fut l’occasion d’une campagne et d’une demande de Casimir auprès du ministre de l’intérieur puis du préfet « Mariguin ». Il reçut un accueil sévère. Le préfet qui l’avait écouté lui dit : « Nous sommes forts, Monsieur, nous ne craignons rien, il faut que justice se fasse ». Malgré ses efforts il ne put rien obtenir. Hymne à la gloire du peuple de Paris Quelques mois après, la Révolution de Juillet, en 1830, il prouva combien était factice la force sur laquelle le régime de Charles X s’appuyait. Cette nouvelle vint surprendre Casimir à la campagne, à « la Madeleine » de Pressagny-l’Orgueilleux. Rentré à Paris, il lui fut demandé de composer un hymne à la gloire du peuple. Il composa La Parisienne pour chanter ses concitoyens morts pour la patrie pendant la Révolution de Juillet. Ce chant populaire eut une grande vogue. Cette marche nationale favorable à la famille d’Orléans comportait sept couplets avec ce refrain : « En avant, marchons Contre les canons ; À travers le fer, le feu des bataillons, Courons à la victoire. (bis) » Il se rendit à Neuilly chez le duc d’Orléans (le châtelain de Bizy) qui avait été son protecteur, et qui était devenu lieutenant général du Royaume. Casimir Delavigne se précipitait ainsi au-devant de la réussite. Il fut d’ailleurs, toujours en excellent termes avec ses voisins de l’autre rive de la Seine, et souvent reçu aussi au château de Saint-Just qui, après avoir connu des propriétaires successifs (le chevalier Suchet, puis son frère le maréchal duc d’Albuféra) en 1831, devint le domaine d’un monsieur Lopez avec qui il sympathisa. La Révolution de 1830 accomplie, Casimir reprit sa tragédie Louis XI, interrompue depuis la mort de l’acteur Talma. Selon certains critiques, ce fut le chef-d’œuvre de Casimir Delavigne, tant les portraits des personnages sont nuancés et fidèles aux mœurs du temps. La première représentation eut lieu le 11 février 1832. Mais le public n’était plus réceptif à ce genre d’œuvre théâtrale. Victor Hugo avait triomphé avec Hernani. Il avait supplanté Casimir dans le cœur des Français. Pourtant sa tragédie Louis XI, après l’épidémie de choléra que connut Paris, connaît un nouveau succès. Son mariage Le 1er novembre 1830, Casimir Delavigne contracta mariage avec Élise de Courtin ; elle devait bientôt lui donner un fils, ce qui rendit son bonheur complet. Son frère Germain épousa le même jour Mademoiselle Letourneur. Ils se marièrent à minuit à l’église Saint-Vincent-de-Paul. « Nous nous marions tous deux jeudi soir, dirent-ils au roi. –Ah ! – À la même heure. –Ah ! –Dans la même église. –Ah ! Et avec la même femme ? » Ce fut une joie pour la reine Hortense que cette union de sa fille d’adoption avec le poète pour lequel elle avait tant de sympathie. Germain obtint, en 1832, le poste de conservateur du Mobilier de la couronne et directeur des Menus Plaisirs du roi. Cette promotion lui permit d’installer toute sa famille au no 2 de la rue Bergère. Casimir, de retour à la Madeleine en compagnie d’Élise, qui lui avait donné un fils dont l’existence est souvent évoquée dans ses tendres soucis, y travaillait abondamment. Il avait fait planter un marronnier qui reflétait pour lui les préoccupations de son épouse au travers de son feuillage plus ou moins fourni au cours des saisons. Serait-il encore identifiable dans le parc actuel ? Il écrivait alors, sur une trame due à Shakespeare Les Enfants d’Édouard. La pièce, le matin de la première, le 18 mai 1833, fit l’objet d’une interdiction. Il reçut un accueil défavorable auprès du ministre de l’Intérieur, Adolphe Thiers, mais, après une courte discussion devant le roi, l’interdiction fut levée. Louis-Philippe qui ne pouvait être présent à la représentation le félicita par un court billet qui commençait ainsi : « J’apprends avec grand plaisir, mon cher Casimir, le succès de votre pièce et je ne veux pas me coucher sans vous avoir fait mon compliment… » On comprend mieux l’attachement du poète à la réussite de Louis-Philippe. Les dernières années de sa vie La douloureuse maladie du foie, soignée au cours de son voyage en Italie recommençait à altérer les jours de Casimir. Il éprouvait de violentes douleurs. Les médecins ne jugeaient pas ce mal comme pouvant nuire à sa vitalité. Ce fut au milieu de douleurs presque continuelles qu’il écrivit Don Juan d’Autriche, comédie pleine de verve, qui ne lui fit pas moins honneur que ses grandes tragédies. La première fut donnée le 17 octobre 1835 et six mois plus tard, le 19 avril 1836, un acte en vers : Une famille au temps de Luther qui n’eut pas beaucoup de succès. Il se rendit, assez désespéré, à sa retraite charmante de Normandie, « la Madeleine », où depuis 1830 il passait tous ses étés. Il aimait beaucoup cette vaste demeure, et sa vue imprenable sur les îles de la Seine. Là, il espérait trouver un peu de soulagement. Il entreprit une œuvre qu’il préférait à tous ses ouvrages : La Popularité, comédie de mœurs en cinq actes et en vers. Après plusieurs retards, la pièce fut représentée le 1er décembre 1838. Elle ne fit que de maigres recettes ; le public était las de Casimir Delavigne. Le 20 janvier de l’année suivante paraît une nouvelle tragédie, La Fille du Cid. Elle n’eut pas un sort plus heureux, le succès fut sans durée. C’est à la fin de cette période douloureuse de l’automne 1839, qu’il dut vendre sa chère Madeleine avec tant de regrets. « Je n’ai point de fortune », écrit-il en 1833, et c’est vrai. À ses ennuis de santé, se sont ajoutés ceux d’argent et, le 9 août 1839, il est contraint d’abandonner « la Madeleine ». La propriété fut vendue 90 750 francs. Quelle tristesse pour le poète, qui écrit alors : « Adieu Madeleine chérie, Qui te réfléchis dans les eaux, Adieu ma fraîche Madeleine ! Madeleine, adieu pour jamais ! Je pars, il le faut, je cède ; Mais le cœur me saigne en partant. » Le poème complet comporte 11 strophes de 8 vers. Il a probablement été rédigé au château de Saint-Just, chez son ami Lopez. Les deux façades de ces demeures sont en vis-à-vis : la Madeleine sur la rive droite de la Seine et Saint-Just sur la rive gauche. Il rentra à Paris pour y suivre l’éducation du fils qui lui était né 9 ans auparavant, et surtout en raison de sa ruine. À cette époque, une descendante du grand Pierre Corneille, que le défaut de fortune plaçait dans de grandes difficultés, vint solliciter un prêt de 500 francs. Casimir ne les avait pas. Il ne put que la rassurer et l’adresser sur-le-champ au duc d’Orléans, « Ce prince universellement aimé et dont la disparition fut une calamité publique », écrivit son frère Germain. Le jour même, la somme demandée fut accordée. Mais ce devait être sa dernière intervention et bonne action. La dernière tragédie à laquelle il travaillait semble bien pressentir sa mort, il écrivait : « Mes jours sont pleins, et bons à moissonner. Dieu qui me les compta pouvant moins m’en donner : les reprendre est son droit… » À partir de ce moment, sa santé déjà si altérée continuait à décliner, malgré les soins empressés du docteur Horteloup. Lorsque Casimir fut surpris par la mort, quatre actes de la tragédie Mélusine étaient écrits, dans un genre tout à fait nouveau, et dont le sujet admettait toutes les richesses de la poésie. Depuis qu’il avait vendu « la Madeleine », il passait tous les ans la belle saison à Paris. Scribe, son ami de toujours, qui connaissait son goût pour la campagne et qui espérait qu’il pourrait y trouver quelques soulagements, lui offrit sa charmante maison du Montalais, à Saint-Jean-Lespinasse dans le Lot. Casimir s’y établit et trouva là quelques douceurs pendant trois mois. Quand il revint à Paris, il sentit qu’il ne pourrait résister à la saison, et il retourna chercher un climat plus doux dans le midi. Il se décida à partir malgré sa faiblesse, accompagné de sa femme et de son fils. Il quitta Paris le 2 décembre 1843. Il soutint la fatigue avec plus de courage que de force jusqu’à Lyon où il fut obligé de s’arrêter. C’est en vain qu’il lutta contre le mal, il lui fallut céder et rester à Lyon. Dans ses derniers moments, le 11 décembre à neuf heures du soir, il se faisait faire la lecture par sa femme. Comme celle-ci, trop émue, sautait des lignes, il la pria doucement de bien vouloir recommencer. Cependant quelques minutes après il parut cesser d’écouter la lecture, et posant sa tête sur sa main, murmura quelques mots, puis retombant sur son oreiller, sembla s’endormir. C’est ainsi qu’il s’éteignit dans la force de l’âge et du talent. La perte de Casimir suscita des profonds regrets. On vit se presser à ses funérailles tout ce que Paris renfermait de plus distingué, dans tous les genres et de tous les rangs. On y remarqua entre autres, Victor Hugo qui prononça au nom de l’Académie française l’éloge funèbre de celui qui fut le plus jeune académicien (35 ans), le dernier des classiques, et sans doute un des premiers romantiques. Le roi ordonna que son portrait et son buste fussent placés dans la Galerie de Versailles. Le Havre, sa ville natale, décida qu’un de ses quais porterait son nom et qu’une statue serait élevée sur une place de la ville. Elle y fut érigée, avenue du général Archinard. Épargnée par les fléaux de la dernière guerre elle se dresse actuellement en compagnie d’un autre illustre enfant du Havre : Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) au pied du bel escalier de pierre du Palais de Justice, aux côtés de deux lions débonnaires. La ville du Havre sauvait ainsi ces deux célébrités de l’oubli. En cette même année 1843, messieurs les sociétaires de la Comédie-Française (qui avait succédé au Théâtre-Français), arrêtèrent en assemblée générale, que le buste de Casimir Delavigne serait placé dans leur foyer au milieu des portraits de tous les grands hommes qui ont illustré ce théâtre. L’œuvre officielle de Casimir Delavigne représente une quinzaine de pièces de théâtre, une trentaine de poésies dont Les Messéniennes, des épîtres, des études sur l’antiquité, quatre chants populaires, ainsi que de nombreuses nouvelles et autres pièces en prose. Postérité Telle fut la gloire passagère d’un poète, considéré en son propre temps comme insurpassé et insurpassable, oublié aujourd’hui des publications littéraires et dont seule subsiste la Vaccine et la courte magnificence d’une bâtisse bourgeoise, pas très belle, mais admirablement implantée dans cet ancien domaine du marquis de Tourny à Pressagny-l’Orgueilleux. Balzac l’admirait éperdument et puisait son inspiration dans Les Vêpres Siciliennes à une époque où il n’était pas encore connu. Dans Illusions perdues (1836-1843), Les Petits Bourgeois (1855), Les Employés ou la Femme supérieure (1838), Casimir Delavigne est abondamment cité comme un génie. Flaubert, au contraire, l’appelle « un médiocre monsieur […] qui épiait le goût du jour et s’y conformait, conciliant tous les partis et n’en satisfaisant aucun, un bourgeois s’il en fut, un Louis-Philippe en littérature. » Il lui reproche surtout la forme de son évolution littéraire, qui prouve, selon lui, que Casimir Delavigne « s’est toujours traîné à la remorque de l’opinion ». Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (division 49). Depuis 1864, l’ancienne rue Voltaire, dans le 6e arrondissement de Paris, porte le nom de rue Casimir-Delavigne. Une rue et un quai du Havre portent également le nom du poète. Publications partielles ThéâtreLes Vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes, 1820 Les Comédiens, comédie Le Paria, 1821 L’École des vieillards, 1823 Marino Faliero, 1829 Don Juan d’Austriche, 1835 Les Messéniennes, 1818Divers. Charles VI, opéra en cinq actes, musique de Fromental Halevy, en collaboration avec son frère Germain (1843)Œuvres complètes, 1836, nouvelle édition revue et corrigée avec œuvres posthumes Derniers chants, Poëmes et Ballade sur l’Italie, Paris, Didier libraire-éditeur, 1855. Chants populaires, Discours, Épîtres, Études sur l’antiquité, Poésies de jeunesse Sources Notice biographique tirée des Œuvres complètes de Casimir Delavigne, Paris, H. L. Delloye & V. Lecou, 1836. Mme Fauchier-Delavigne, Casimir Delavigne intime, Paris, SFIL, 1907. Bulletin municipal de Pressagny-l’Orgueilleux, no 25, 2006, p. 64-76. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Casimir_Delavigne


Zoé Valdés (La Habana, 2 de mayo de 1959) es una escritora cubana de poesía, novela y guiones cinematográficos que adquirió la ciudadanía española en 1997. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, pero abandonó los estudios antes de terminar (hizo hasta cuarto año); después ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana, donde estudió hasta segundo año.
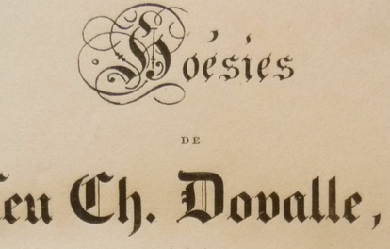

Charles Dovalle est un poète français né à Montreui, l-Bellay en 1807 et tué en duel à Paris en 1829. Biographie Descendant d’une longue lignée d’hommes de loi et d’officiers de finances du Saumurois, Charles Dovalle naquit à Montreuil-Bellay le 23 juin 1807. Il fit de brillantes études au collège de Saumur, où il écrivit des poèmes remarqués. Après des études de droit à Poitiers, il partit pour Paris et se lança avec ardeur dans la vie littéraire. Il publia des poésies en forme de chansons, qui figurent toujours dans les manuels de morceaux choisis, comme Bergeronnette, Mon Rêve, Le Curé de Meudon, Le Sylphe... Obligé de se consacrer à des travaux de jurisprudence, tout en écrivant dans Le Figaro, il devint rédacteur au Journal des Salons. Le jeune homme, qui habitait alors rue de la Harpe, n’en continuait pas moins à se consacrer à la poésie. Malheureusement, sa carrière devait être interrompue prématurément par une mort tragique à l’âge de 22 ans. Critique théâtral, il commit un calembour facile sur Mira, le directeur du théâtre des Variétés, qui lui avait refusé l’entrée de son établissement. Il écrivit dans Le Lutin: «Mira peut être Mira-sévère, mais il ne sera jamais Mira-beau». Ce dernier, qui était laid et vindicatif, le provoqua en duel. Blessé à l’épaule à la suite d’un premier assaut à l’épée, il exigea contre toutes les règles que le duel se poursuive au pistolet; au troisième échange, le pauvre Dovalle fut touché, après que la balle eut traversé son portefeuille, et mourut le 30 novembre 1829. Une colonne de marbre blanc fut érigée sur sa tombe dans le cimetière de Montmartre,. L’édition complète de ses œuvres, Le Sylphe, Poésies de feu Charles Dovalle, parut à Paris aux éditions Ladvocat, Palais-Royal, en 1830, avec une préface de Victor Hugo. Bibliographie Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, t.1, Ch.Delagrave, 1876, p. 831 Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Dovalle


Jacques Delille, souvent appelé l’abbé Delille, né à Clermont-Ferrand le 22 juin 1738 et mort à Paris dans la nuit du 1er au 2 mai 1813, est un poète et traducteur français. Biographie Jacques, enfant naturel, conçu dans un jardin d’Aigueperse, naît chez un accoucheur, rue des Chaussetiers, à Clermont-Ferrand, le 22 juin 1738 de Marie-Hiéronyme Bérard, de la famille du chancelier Michel de l’Hospital. Il est reconnu par Antoine Montanier, avocat au Parlement de Clermont-Ferrand, qui meurt peu de temps après en lui laissant une modeste pension viagère de cent écus. Sa mère, aussi discrète que belle, lui transmet un pré, sis à Pontgibaud, ce qui lui permit d’adjoindre à son prénom le nom de famille Delille. Jusqu’à douze ou treize ans, il est placé chez une nourrice à Chanonat et reçoit ses premières leçons du curé du village. Envoyé à Paris, il fait de brillantes études au collège de Lisieux et devient maître de quartier au collège de Beauvais, puis professeur, d’abord au collège d’Amiens, ensuite au collège de la Marche à Paris. Il s’était déjà signalé par un remarquable talent de versificateur et une aptitude exceptionnelle à la poésie didactique. Sa gloire est assurée d’un coup par sa traduction en vers des Géorgiques de Virgile, qu’il publie en 1770. Louis Racine avait tenté de le dissuader de cette entreprise, qu’il jugeait téméraire, mais Delille avait persisté dans son dessein, et Louis Racine, convaincu par ses premiers essais, l’y avait encouragé. Son poème est accueilli par un concert de louanges, troublé seulement par la voix discordante de Jean-Marie-Bernard Clément, de Dijon. «Rempli de la lecture des Géorgiques de M. Delille, écrivit Voltaire à l’Académie française en mars 1772, je sens tout le prix de la difficulté si heureusement surmontée, et je pense qu’on ne pouvait faire plus d’honneur à Virgile et à la nation. Le poème des Saisons [de Jean-François de Saint-Lambert] et la traduction des Géorgiques me paraissent les deux meilleurs poèmes qui aient honoré la France après L’Art poétique [de Nicolas Boileau].» Delille est élu à l’Académie française en 1772, mais le maréchal de Richelieu intervient auprès de Louis XV pour faire annuler son élection au motif qu’il est trop jeune. Réélu en 1774, il est, cette fois, reçu par l’illustre compagnie, Jean-François de La Harpe ayant fait observer dans le Mercure de France qu’il était indigne qu’un talent aussi exceptionnel en soit réduit à dicter des thèmes latins à des écoliers. Il est, en outre, nommé à la chaire de poésie latine du Collège de France. L’ascension de Delille s’accélère encore après la mort de Voltaire, qui pouvait passer pour son seul rival. Tant la cour que le monde des lettres reconnaissent unanimement la supériorité de son talent. Il est à la fois le protégé de Marie-Thérèse Geoffrin et celui de Marie-Antoinette et du comte d’Artois. Ce dernier lui fait attribuer le bénéfice de l’abbaye de Saint-Séverin, qui rapportait 30 000 francs, tout en permettant de se borner aux ordres mineurs, que Delille avait reçus à Amiens en 1762. En 1782, la publication du poème des Jardins, sans doute l’œuvre la plus célèbre de Delille, est un nouveau triomphe, amplifié par le talent avec lequel l’auteur savait lire ses vers à l’Académie, au Collège de France ou dans les salons. Le comte de Choiseul-Gouffier parvient néanmoins à le persuader de s’arracher à tant d’adulation pour le suivre dans son ambassade de Constantinople. En 1786, il se met en ménage avec sa gouvernante, Marie-Jeanne Vaudechamps, qu’il épouse en 1799. Sous la Révolution française, ayant perdu le bénéfice qui était sa seule source de revenus, Delille est inquiété, mais conserve la liberté, sacrifiant aux idées de l’heure en composant, à la demande de Pierre-Gaspard Chaumette, un Dithyrambe sur l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. Sous le Directoire, il se retire à Saint-Dié, pays de sa femme, puis quitte la France après la chute de Robespierre, au moment où d’autres y rentraient, pour passer en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Durant cet exil, poussé par sa femme, qui avait pris beaucoup d’ascendant sur lui, il travaille énormément. Il compose L’Homme des champs et entreprend Les Trois règnes de la nature en Suisse, compose La Pitié en Allemagne et traduit Paradise Lost (Le Paradis perdu) de John Milton à Londres. Rentré en France en 1802, il retrouve sa chaire au Collège de France et son fauteuil à l’Académie. Il effectue de longs séjours dans la maison de plaisance du baron Micoud d’Umons à Clamart, où il aurait écrit en 1808 Les Trois Règnes de la Nature. À la fin de sa vie, il devient aveugle, comme Homère, et cette infirmité ajoute encore à l’admiration proche de l’idolâtrie qui lui était vouée. Il meurt d’une attaque d’apoplexie dans la nuit du 1er au 2 mai 1813. Son corps est exposé pendant trois jours sur un lit de parade au Collège de France, le front ceint d’une couronne de laurier et, considéré comme le plus grand poète français, il reçoit des funérailles grandioses, suivies par une foule immense. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise (11e division). Œuvre Essai sur l’homme de Pope, 1765 Les Géorgiques de Virgile, 1770. Les Jardins ou l’art d’embellir les paysages, poème en 8 chants, 1782 Bagatelles jetées au vent, 1799 L’Homme des champs, ou les Géorgiques françaises, 1800 Dithyrambe sur l’immortalité de l’âme, 1802 Poésies fugitives, 1802 La Pitié, poème en 4 chants, 1803 L’Énéide de Virgile, 1804 Le Paradis perdu de Milton, 1805. L’Imagination, poème en 8 chants, 1806. Les Bucoliques de Virgile, 1806, réédité par Philippe Gonin, Paris, 1951, édition enrichie de bois gravés par Lucile Passavant (200 exemplaires). Les Trois Règnes de la nature, 1808 ( A Paris chez Nicolle et chez Giguet et Michaud) . La Conversation, poème, 1812.Ses œuvres complètes ont été publiées de 1817 à 1821 par Joseph-François Michaud, puis rééditées par Lefèvre en 1833, avec des notes de Choiseul-Gouffier, Parseval-Grandmaison, Charles-Marie de Féletz, Descuret, Aimé-Martin, Barthélemy Philibert d’Andrezel, Elzéar de Sabran (écrivain), Louis-Simon Auger, etc. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delille


Sophie d'Arbouville, née le 29 octobre 1810 et morte le 22 mars 1850 à Paris, est une poète et nouvelliste française. Biographie Née le 29 octobre 1810, Sophie de Bezancourt1 est la petite-fille de Sophie d'Houdetot. Elle fréquente dans le salon de celle-ci une société choisie. Léon Séché en fait ce portrait « Elle était plutôt mal de figure, elle avait des traits forts et os yeux ressortis qui, de prime abord, disposaient peu en sa faveur, mais dès qu'elle ouvrait la bouche on oubliait sa laideur relative.» et Sainte-Beuve en a dit « Jeune femme charmante, un peu Diane, sans enfants. Restée enfant et plus jeune que son âge. Pas jolie, mais mieux. » À 22 ans elle épouse le général François d'Arbouville, qu'elle suit dans ses campagnes. Sa santé s'en ressentira. Ne pouvant suivre le général en mission en Afrique elle retourne à Paris et y tient salon. Sa conversation, son amabilité et sa bienveillance sont reconnus de tous. Elle ne tient pas au succès et ses poésies paraissent en petit nombre, pour ses proches, et son couvert d'anonymat. Ses nouvelles publiées dans « La Revue des deux Mondes » le sont sans son consentement, Prendre l'ouvrage d'une femme pour le publier sans lui en demander la permission, c'est un manque de délicatesse. Ce n'est pas la peine de donner mille francs pour échapper à une complète publicité, si le lendemain les revues agissent de cette façon. J'ai écrit moi-même à M. Bulos (sic) une lettre très nette et très ferme qui l'aura un peu surpris, et je l'oblige, pour le prochain n°, à dire qu'il a agi sans mon consentement (Lettre à Sainte-Beuve). La revue ne publiera pas cette protestation, ayant l'assentiment du mari. Elle acceptera plus tard leur édition, mais au profit d'une œuvre caritative. Elle habitait au 10 place Vendôme et y tenait un salon où l'on parlait plus de poésie que de politique. Lamartine était un de ses poètes favoris. Sainte-Beuve, son hôte le plus assidu, en fit sa muse, et lui dédia Le Clou d’or2; elle ne lui céda jamais . En me voyant gémir, votre froide paupière M'a refermé d'abord ce beau ciel que j'aimais, Comme aux portes d'Enfer, de vos lèvres de pierre, Vous m'avez opposé pour premier mot : Jamais ! (À Elle qui était allée entendre des scènes de l'opéra d'Orphée) ; mais ils correspondirent pendant 10 ans. L'été elle résidait à Maisons-Laffitte ou Champlâtreux ; Prosper Mérimée y était reçu ; Chateaubriand y a composé Velléda. Malade La fièvre m'est revenue, avec des douleurs aiguës — des maux de tête terribles., atteinte d'un cancer elle partit en Ariège prendre les eaux de Celles puis rejoint son mari à Lyon. Les événements de juin 18493- altèrent sa santé car elle craint pour la vie du général ; le couple rentre à Paris et c'est là qu'elle meurt, le 22 mars 1850, après une longue maladie.


François Villon (1431-après 1463) Poète français du Moyen Âge, auteur de la célèbre Ballade des pendus, qui est considéré comme l’un des pères de la poésie moderne. Poète «!malfaiteur!» Issu d’une famille pauvre, François de Montcorbier, ou François des Loges, orphelin de père très jeune, fut élevé par le chanoine de Saint-Benoît-le-Bestourné, maître Guillaume de Villon, son «!plus que père!», dont il prit le nom pour lui rendre hommage. Après avoir été reçu bachelier en 1449, il devint licencié puis maître ès arts à Paris en 1452. À part ces quelques faits sur sa jeunesse, la vie de François Villon est remplie de zones d’ombre, et les seuls indices biographiques certains dont nous disposions sur sa vie adulte sont d’origine judiciaire, ce qui renforce l’image légendaire de poète «!malfaiteur!» qui est la sienne depuis la fin du Moyen Âge. Notons que cette image est aussi une tradition littéraire, dont Rutebeuf est l’un des autres exemples. La première affaire judiciaire grave dont nous ayons trace eut lieu le 5 juin 1455 : au cours d’une rixe, Villon tua Philippe Sermoise, un prêtre qui l’aurait provoqué!; blessé lui-même, il se fit panser sous le nom de Michel Mouton et dut quitter Paris, où il ne revint qu’en 1456, après avoir obtenu des lettres de rémission sous son vrai nom. On sait aussi que, durant la nuit de Noël 1456, il commit un vol avec effraction au collège de Navarre, ce qui l’obligea à quitter de nouveau Paris avec le fruit de son larcin. Il prétendit avoir écrit, au moment du vol, un poème célèbre, le Lais, également connu sous le nom de Petit Testament, pour s’en excuser et expliquer sa fuite par une raison sentimentale. Dans cette œuvre, en effet, Villon annonce son départ pour Angers afin, dit-il, de se consoler d’une déception amoureuse - mais ce n’est là qu’un prétexte à une satire de l’amour courtois. Prenant congé de ses amis et de ses connaissances, le poète fait dans ce poème une série de legs parodiques!; tout au long de cette «!donation!», il joue sur les mots «!lais!» et «!legs!», et use abondamment de double sens. À la cour de Charles d’Orléans Durant les années suivantes, Villon mena une vie d’errance, dont on sait peu de chose!; il séjourna, semble-t-il, à Angers chez un parent, puis à la cour de Jean II de Bourbon, établie à Moulins, puis à la cour de Charles d’Orléans, à Blois, l’une des plus raffinées du temps. Le séjour de Villon auprès du duc, qui marque un moment de paix dans cette existence incertaine, est attesté par la présence de trois de ses pièces dans le manuscrit autographe de Charles d’Orléans!; parmi ces pièces se trouvent notamment la Ballade des contradictions qui débute par le vers «!Je meurs de soif auprès d’une fontaine!», et qui traite de façon originale d’un thème rhétorique usé qui avait été donné par le duc d’Orléans comme sujet d’un concours de poésie. À cette même époque, Villon entretint des rapports avec la bande des Coquillards, une société criminelle plus ou moins secrète : nous ignorons s’il en faisait vraiment partie, mais il est certain qu’il connaissait le jargon de la Coquille, puisque nous possédons entre six et onze Ballades en jargon (le chiffre varie en raison des problèmes d’attribution), dont la compréhension reste difficile et la signification ambiguë. Voir Ballades (littérature). Le Testament Au cours de l’été 1461, Villon fut incarcéré à Meung-sur-Loire pour des raisons inconnues, à l’initiative de l’Évêque d’Orléans!; cette captivité le marqua profondément. Libéré le 2 octobre grâce à l’arrivée de Louis XI dans la ville, il rentra à Paris, où il composa le Testament (v. 1462). C’est vers 1462 que François Villon composa son œuvre principale, le Testament. La première partie de ce texte est une méditation consacrée essentiellement à la perte de la jeunesse, aux méfaits de l’amour mais surtout à la mort (cette partie contient la célèbre ballade désignée par Clément Marot en 1532 sous le titre de Ballade des dames du temps jadis). La seconde partie reprend, en l’approfondissant, la fiction testamentaire déjà abordée dans le Lais : Villon va jusqu’à choisir les exécuteurs, son sépulcre et le service religieux. La Ballade des pendus Impliqué dans une rixe au cours de laquelle François Ferrebouc, notaire pontifical, fut blessé, Villon fut arrêté, torturé et condamné à la pendaison, et fit appel de la sentence. C’est sans doute pendant ces jours pénibles qu’il écrivit la Ballade des pendus, intitulée aussi l’Épitaphe Villon, où se manifeste notamment son obsession des corps pourrissants. Le 5 janvier 1463, le parlement de Paris commua la peine en dix ans de bannissement. Ce sont là les dernières traces des faits et gestes de François Villon que nous possédions. Importance et postérité de l’œuvre S’il n’innova guère dans son usage des formes poétiques, Villon porta la ballade à sa perfection. Son œuvre est dominée par l’ambiguïté et par l’importance considérable accordée à la personne du poète, ce qui est rare au Moyen Âge, où le sujet poétique n’est souvent qu’une forme vide et où la poésie est considérée davantage comme un jeu rhétorique que comme le lieu de l’expression d’une individualité. Si Villon ridiculise souvent la tradition de l’amour courtois, il s’y inscrit pourtant parfois avec certains de ses poèmes, comme l’atteste sa Ballade à amie. La poésie de Villon est surtout marquée par une hantise profonde de la mort. Ce thème obsédant, que ne dissimule pas un usage fréquent de l’ironie, traverse toute son œuvre, où domine l’évocation des souffrances physiques et morales dans un monde désenchanté et sombre. En outre, lorsque Villon décrit la vie quotidienne, c’est souvent sur un ton réaliste ou pathétique. La postérité de Villon est immense et ne se dément pas depuis le XVIe siècle, où Clément Marot donna la première édition commentée de ses œuvres (1532)!; sa gloire doit aussi beaucoup à la fascination qu’il exerça sur les poètes du XIXe siècle, notamment les romantiques comme Théophile Gautier, qui inaugura avec une étude sur Villon sa série des «!grotesques!», ces textes critiques qu’il consacrait essentiellement aux «!petits!» auteurs du XVIe et du XVIIe siècle. Les références Encyclopédie Encarta (c) Microsoft

Pierre-Jean de Béranger, né le 19 août 1780 à Paris, et mort dans cette même ville le 16 juillet 1857, est un chansonnier français prolifique qui remporta un énorme succès à son époque. Plus connu sous le simple nom de Béranger, il est le fils de Jean-François Béranger de Mersix et de Marie-Jeanne Champy.


Jean Auvray, né vers 1580, probablement en Normandie et mort avant 1624, est un poète français. Jean Auvray a été chirurgien à Rouen, et ne saurait être confondu avec son homonyme dramaturge contemporain, avocat à Paris. Il appartient à la tradition de la satire normande dans la lignée de Vauquelin, Du Lorens, Angot de l’Éperonnière et Courval-Sonnet. Il est l’auteur d’écrits religieux et de satires. Alternant entre piété, cynisme et obscénité, sa poésie est cependant, selon certains critiques, la meilleure dans sa veine satirique. Il a aussi écrit une tragicomédie : l’Innocence descouverte (peut-être en 1609, dont on peut consulter le texte dans les seconde et troisième édition du Banquet des Muses). Tombeau du rud' en souppe Cy gist dans ce tombeau foireux Rud’ En-Souppe le valeureux, Qui voyant la guerre entreprise Au pays, et qu’on le cherchoit, Se cacha dessous la chemise De sa grand’ Jeanne qui pettoit : Luy qui trembloit tant escoutoit Tant redoubler de petarades, Saisi de peur creust qu’il estoit Au milieu des harquebusades : Qu’en advint-il ? Ses sens malades, Et le trou de son cul puant Perdant sa vertu retentrice, En lieu de combattre en la lice Il mourut de peur en chiant. Le Banquet des muses Œuvres * Le banquet des muses ou Les divers satires du sieur Auvray contenant plusieurs poëmes non encore veuës ny imprimez & L’innocence descouverte, tragi-comédie Rouen : D. Ferrand, 1623. * « La pourmenade de l’âme dévote accompagnant son Sauveur depuis les ruës de Jérusalem jusques au tombeau » [archive], Rouen : David Ferrand, 1633 (3e édition; N.B. : la première édition date de 1622) * « Les œuvres sainctes du sr Auvray : desquelles la plus grande partie n’ont encor esté veuës ny imprimées » [archive], Rouen : David Ferrand, 1634 (3e édition; N.B. : la première édition date de 1626) * L’Innocence découverte, Rouen, Petit, 1609. * Le Triomphe de la Croix, Rouen, D. Ferrand, 1622. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/


Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fère dans l’ancien presbytère du village dans l’Aisne et mort le 23 février 1955 à Paris, est un dramaturge, poète, essayiste et diplomate français. Membre de l’Académie française, il est le frère de la sculptrice Camille Claudel. Biographie Jeunesse Paul Louis Charles Claudel est le fils de Louis-Prosper Claudel, un haut fonctionnaire de province, né à La Bresse dans les Vosges, et de Louise Athénaïse Cerveaux. Frère cadet de Louise Claudel, pianiste,[réf. souhaitée] et de la sculptrice Camille Claudel qui réalisa en 1884 son buste « en jeune romain », dont un des quatre exemplaires en bronze réalisés à partir de l’original (fonte Gruet de 1893) est exposé au Musée des Augustins de Toulouse (don baron Alphonse de Rothschild, 1895), il grandit à Villeneuve-sur-Fère. De 1882 à 1886 il vit à Paris avec sa mère et ses sœurs au 135bis, boulevard du Montparnasse, puis de 1886 à 1892 au 31, boulevard de Port-Royal. Il fait ses études au lycée Louis-le-Grand où il obtient son baccalauréat de philosophie en 1885 et s’inscrit à l’École libre des sciences politiques pour y préparer une licence de droit. Claudel, selon ses dires, baignait, comme tous les jeunes gens de son âge, dans « le bagne matérialiste » du scientisme de l’époque. Il se convertit au catholicisme, religion de son enfance, en assistant en curieux aux vêpres à Notre-Dame de Paris le 25 décembre 1886, jour de Noël. « J’étais debout, près du deuxième pilier, à droite, du côté de la sacristie. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. En un instant mon cœur fut touché et je crus ». À la même époque, il découvre les Illuminations, le recueil de poèmes d’Arthur Rimbaud, dont la lecture sera pour lui déterminante. L’influence de celui qu’il appelait le « mystique à l’état sauvage » est manifeste, notamment, dans Tête d’or, une de ses premières pièces de théâtre. Le diplomate Passé une velléité d’entrer dans les ordres, il entre dans la carrière diplomatique en 1893. Tout d’abord premier vice-consul à New York puis à Boston, il est nommé consul à Shanghai en 1895. Il est alors appuyé par le secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe Berthelot. À l’âge de 32 ans, en 1900, il veut mettre fin à sa carrière diplomatique pour devenir moine bénédictin et postule à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé. Les supérieurs du monastère ne l’admettront pas comme moine mais, en 1905, il deviendra oblat de cette même abbaye. De retour en Chine, il y poursuit sa carrière diplomatique et, après avoir été consul à Shanghai (1895), il devient vice-consul à Fou-Tchéou (Fuzhou, 1900) puis consul à Tientsin (Tianjin, 1906-09). Il est ensuite consul à Prague (1909) Francfort (1911) et Hambourg (1913) avant d’être nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro (1916), et à Copenhague (1920). Il est ambassadeur à Tokyo (1922), à Washington (1928) puis à Bruxelles (1933), où se termine sa carrière diplomatique en 1936. L’écrivain engagé Claudel s’installe alors définitivement dans le château de Brangues en Isère, qu’il avait acquis en 1927 pour y passer ses étés. Le travail littéraire, mené jusqu’alors parallèlement à sa carrière diplomatique, occupe désormais la plus grande part de son existence. Il reçoit à Brangues diverses notoriétés : des hommes politiques comme le président Édouard Herriot, ou des écrivains comme François Mauriac. Georges Clemenceau, amateur de littérature et lui-même écrivain, a laissé cette sévère appréciation de la prose claudélienne : « J’ai d’abord cru que c’était un carburateur et puis j’en ai lu quelques pages– et non, ça n’a pas carburé. C’est des espèces de loufoqueries consciencieuses comme en ferait un Méridional qui voudrait avoir l’air profond… » En 1934 c’est lui qui écrit puis déclame l’éloge funèbre pour son ami, l’ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe Berthelot. Pendant la guerre d’Espagne, Claudel apporta son soutien aux franquistes. Geneviève Dreyfus-Armand écrit que : « Paul Claudel, que son statut de diplomate contraignait sans doute à la réserve, sortit pourtant de celle-ci en mai 1937 en écrivant un poème dédié « aux martyrs espagnols » morts à cause de leur foi. Ce poème servit de préface à l’ouvrage du Catalan Joan Estelrich (es), La Persécution religieuse en Espagne, publié à Paris en 1937 pour dénoncer les violences anticléricales. François Mauriac reprocha à Claudel de n’avoir pas écrit un seul vers pour « les milliers et les milliers d’âmes chrétiennes que les chefs de l’Armée Sainte […] ont introduits dans l’éternité » ». L’auteur ajoute que Bernanos lui répondit en publiant Les Grands Cimetières sous la lune et précise en outre que Claudel signa le « Manifeste aux intellectuels espagnols » du 10 décembre 1937 publié dans le magazine de propagande franquiste Occident, dirigé par Estelrich. Claudel, d’autre part, refusa de rejoindre le Comité français pour la paix civile et religieuse en Espagne lancé par Jacques Maritain. Enzo Traverso va plus loin en écrivant que « De son côté, le monde catholique a cessé d’être un bloc conservateur : il se divise entre une droite qui, notamment à cause de la guerre civile espagnole, se fascise – il suffit de penser aux poèmes de Paul Claudel à la gloire de Franco—, et une « gauche », au sens topologique du terme, qui reconnaît la légitimité de l’antifascisme. Traumatisés par la violence franquiste, François Mauriac et Georges Bernanos adoptent une position de soutien ou de neutralité bienveillante à l’égard de la République, tant en Espagne qu’en France. ». En 1938, Claudel entre au conseil d’administration de la Société des Moteurs Gnome et Rhône, grâce à la bienveillance de son directeur, Paul-Louis Weiller, mécène et protecteur de nombreux artistes (Jean Cocteau, Paul Valéry, André Malraux). Ce poste, richement doté, lui vaudra des critiques, à la fois par le statut social et le montant des émoluments qu’il en retire mais aussi par le fait qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette entreprise de mécanique participe à l’effort de guerre allemand pendant l’Occupation. Selon l’hebdomadaire royaliste L’Indépendance française, cité par Le Dictionnaire des girouettes[réf. à confirmer], « sans aucune nécessité et sans aucun travail, simplement pour avoir assisté six fois au Conseil d’administration, il a touché 675 000 francs. Bénéfices de guerre, bénéfices de la guerre allemande ». À partir de 1940, Paul-Louis Weiller, juif, est déchu de la nationalité française. Les hésitations devant la seconde guerre mondiale Attristé par les débuts de la guerre, et notamment l’invasion de la Pologne, au cours d’un mois de septembre 1939 qu’il juge par ailleurs « merveilleux », Claudel est initialement peu convaincu par le danger que représente l’Allemagne nazie. Il s’inquiète davantage de la puissante Russie qui représente selon lui une « infâme canaille communiste ». En 1940, il est ulcéré par la défaite de la France, mais voit d’abord une délivrance dans les pleins pouvoirs conférés par les députés à Pétain. Dressant dans son Journal un « état de la France au 6 juillet 1940 », il met au passif la sujétion de la France à l’Allemagne, la brouille avec l’Angleterre « en qui seule est notre espérance éventuelle » et la présence au gouvernement de Pierre Laval, qui n’inspire pas confiance. À l’actif, il met l’épuisement de l’Allemagne et de l’Italie, le gain de forces de l’Angleterre et un changement idéologique qu’il décrit comme suit : « La France est délivrée après soixante ans de joug du parti radical et anticatholique (professeurs, avocats, juifs, francs-maçons). Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la Grande-Chartreuse aux religieux. Espérance d’être délivré du suffrage universel et du parlementarisme ; ainsi que de la domination méchante et imbécile des instituteurs qui lors de la dernière guerre se sont couverts de honte. Restauration de l’autorité. » (Ce qui concerne les instituteurs est un écho d’une conversation de Claudel avec le général Édouard Corniglion-Molinier et Antoine de Saint-Exupéry, qui, selon Claudel, lui avaient parlé « de la pagaille des troupes françaises, les officiers (les réservistes instituteurs " lâchant pied " les premiers). ») Le 24 septembre 1940, Claudel va plus loin encore : « Ma consolation est de voir la fin de cet immonde régime parlementaire qui, depuis des années, dévorait la France comme un cancer généralisé. C’est fini [...] de l’immonde tyrannie des bistrots, des francs-maçons, des métèques, des pions et des instituteurs... » Il faut rappeler que Bernanos avait fustigé Pétain dès juin 1940. Toutefois, le spectacle de la collaboration avec l’Allemagne l’écœure bientôt. En novembre 1940, il note dans le même Journal : « Article monstrueux du cardinal Baudrillart dans La Croix nous invitant à collaborer « avec la grande et puissante Allemagne » et faisant miroiter à nos yeux les profits économiques que nous sommes appelés à en retirer ! (...) Fernand Laurent dans Le Jour déclare que le devoir des catholiques est de se serrer autour de Laval et de Hitler.—Les catholiques de l’espèce bien-pensante sont décidément écœurants de bêtise et de lâcheté ». Dans le Figaro du 10 mai 1941, il publie encore des Paroles au Maréchal (désignées couramment comme l’Ode à Pétain) qui lui sont souvent reprochées. La péroraison en est : « France, écoute ce vieil homme sur toi qui se penche et qui te parle comme un père./ Fille de saint Louis, écoute-le ! et dis, en as-tu assez maintenant de la politique ?/ Écoute cette voix raisonnable sur toi qui propose et qui explique. ». Henri Guillemin (critique catholique et grand admirateur de Claudel, mais non suspect de sympathie pour les pétainistes) a raconté que, dans un entretien de 1942, Claudel lui expliqua ses flatteries à Pétain par l’approbation d’une partie de sa politique (lutte contre l’alcoolisme, appui aux écoles libres), la naïveté envers des assurances que Pétain lui aurait données de balayer Laval et enfin l’espoir d’obtenir une protection en faveur de son ami Paul-Louis Weiller et des subventions aux représentations de l’Annonce faite à Marie. À partir d’août 1941, le Journal ne parle plus de Pétain qu’avec mépris. Dans le Figaro du 23 décembre 1944, il publie Un poème au général de Gaulle qu’il avait récité au cours d’une matinée du Théâtre-Français consacrée aux « Poètes de la Résistance ». La consécration Claudel a mené une constante méditation sur la parole, qui commence avec son théâtre et se poursuit dans une prose poétique très personnelle, s’épanouit au terme de sa vie dans une exégèse biblique originale. Cette exégèse s’inspire fortement de l’œuvre de l’Abbé Tardif de Moidrey (dont il a réédité le commentaire du Livre de Ruth), mais aussi d’Ernest Hello. Claudel s’inscrit ainsi dans la tradition patristique du commentaire scripturaire, qui s’était peu à peu perdue avec la scolastique, et qui a été reprise au XIXe siècle par ces deux auteurs, avant de revenir sur le devant de la scène théologique avec le cardinal Jean Daniélou et Henri de Lubac. Sa foi catholique est essentielle dans son œuvre qui chantera la création : « De même que Dieu a dit des choses qu’elles soient, le poète redit qu’elles sont. » Cette communion de Claudel avec Dieu a donné ainsi naissance à près de quatre mille pages de textes. Il y professe un véritable partenariat entre Dieu et ses créatures, dans son mystère et dans sa dramaturgie, comme dans Le Soulier de satin et L’Annonce faite à Marie. Avec Maurice Garçon, Charles de Chambrun, Marcel Pagnol, Jules Romains et Henri Mondor, il est l’une des six personnalités élues le 4 avril 1946 à l’Académie française lors de la deuxième élection groupée de cette année, visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l’Occupation. Il est reçu à l’Académie française le 13 mars 1947 par François Mauriac, au fauteuil de Louis Gillet. De 1953 à 1955 il participe à la revue littéraire de Jean-Marc Langlois-Berthelot et Jean-Marc Montguerre, L’Échauguette. Il fut membre du Comité d’honneur du Centre culturel international de Royaumont. Il meurt le 23 février 1955 à Paris, au 11 boulevard Lannes à l’âge de 86 ans. Il est enterré dans le parc du château de Brangues ; sa tombe porte l’épitaphe : « Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. » (Il faut probablement lire le mot « semence » à la lumière de la doctrine de la résurrection de la chair : à la fin des temps, lors du retour glorieux du Christ, les morts ressusciteront ; les restes humains sont ainsi la semence de la chair transfigurée qui sera celle de la résurrection. D’où l’importance de la sépulture dans la religion chrétienne, et les réticences face à l’incinération par exemple.) Le travail d’édition et d’annotation de son Journal est réalisé après sa mort par son ami François Varillon, prêtre jésuite et théologien, et par Jacques Petit, dans la bibliothèque de la Pléiade. L’exégèse religieuse On peut aussi passer par l’exégèse religieuse à laquelle Claudel s’est consacré la plupart de sa vie. Pour lui, la foi n’est pas seulement une persistance dans sa critique sur l’art, mais plutôt une nourriture pour son esprit et son âme. Il consacre plusieurs articles typiques à ce sujet : Vitraux des Cathédrales de France, la Cathédrale de Strasbourg, l’Art et la Foi, l’Art Religieux, etc. Il met en lumière l’esprit religieux partout où il le peut. C’est la façon pour lui d’exprimer sa méditation sur son intimité d’homme et de croyant. Il nous confie même parfois sa foi pour aider à comprendre ses textes. La Bible est perçue comme une œuvre poétique par Claudel, qui le stimule à interroger et à commenter les tableaux avec un style qui parfois s’en inspire. La déclamation Comme poète, Claudel porte une grande attention à la diction, à l’énonciation ou à la déclamation, les réclamant comme de son domaine propre d’écrivain. Il dit, dans une correspondance à son ami Édouard Bourdet : « Je n’admettrai jamais que la musique associée à un texte poétique dépende exclusivement du choix du metteur en scène. En réalité, il s’agit d’une émanation du texte et c’est l’auteur qui doit être responsable de l’une comme de l’autre. » Il recherche toute sa vie une énonciation intelligible et signifiante. Pour lui elle s’opère dans l’attention au diseur, et en détachant syntaxe et souffle : il peut aller jusqu’à proposer un silence au milieu d’une phrase, même au milieu d’un mot ou au milieu d’une syllabe ou d’un phonème. Par exemple, à la répartie de Don Camille à Prouhèze dans Le Soulier de Satin : « Et cependant qui diable m’a fait, je vo|us prie, si ce n’est pas elle seule ? », il indique un soupir au milieu du mot vous. Il retient d’autres principes expressifs : accentuer sur les consonnes et moins sur les voyelles, placer une inflexion en début de vers et le terminer dans légère atténuation de voix. Dans son rapport avec le comédien, le sens n’est pas enserré dans l’écrit, mais procède du travail vocal du diseur. Ce travail, à la différence de la versification classique, n’est pas préalablement fixé, c’est au diseur de se mettre à son école. Amours de Paul Claudel Paul Claudel a une liaison avec Rosalie Ścibor-Rylska, d’origine polonaise, épouse de Francis Vetch, entrepreneur et affairiste. Il la rencontre en 1900 sur le bateau qui l’amène avec son mari en Chine, et a une fille naturelle, Louise Vetch (1905-1996), compositrice et cantatrice. Rosalie Vetch inspire le personnage d’Ysé dans Partage de midi et celui de Prouhèze dans Le Soulier de satin. Elle repose à Vézelay, où sa tombe porte ce vers du poète : « Seule la rose est assez fragile pour exprimer l’éternité », vers extrait de Cent phrases pour éventails. Famille Paul Claudel épouse à Lyon le 14 mars 1906 Reine Sainte-Marie-Perrin (1880-1973), fille de Louis Sainte-Marie Perrin, architecte de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Le couple embarque trois jours plus tard pour la Chine, où Claudel est consul à Tientsin. Ils ont cinq enfants : Marie (1907-1981), Pierre (1908-1979), Reine (1910-2007), Henri (1912-2016), et Renée (née en 1917). En septembre 1913, la sculptrice Camille Claudel, sœur de Paul, est internée en asile d’aliénés à Mondevergues (Montfavet– Vaucluse) à la demande de la famille et à l’instigation de son frère Paul, qui décide d’agir immédiatement après la mort de leur père. En trente ans d’hospitalisation, Paul Claudel ne va voir sa sœur qu’à douze reprises. Lors de la rétrospective qui lui fut consacrée en 1934, des témoins ont rapporté que Paul Claudel s’emporte : il ne veut pas qu’on sache qu’il a une sœur folle. À la mort de celle-ci, en 1943, Paul Claudel ne se déplace pas : Camille est inhumée au cimetière de Montfavet accompagnée du seul personnel de l’hôpital ; quelques années plus tard, ses restes sont transférés dans une fosse commune, ni Paul ni les membres de la famille Claudel n’ayant proposé de sépulture. L’ancien presbytère où il est né est devenu la Maison de Camille et de Paul Claudel, exposant des œuvres de Camille et des documents inédits sur Paul Claudel. Œuvres * Théâtre1887 : L’Endormie (première version) * 1888 : Fragment d’un drame * 1890 : Tête d’or (première version) * 1892 : La Jeune Fille Violaine (première version) * 1893 : La Ville (première version) * 1894 : Tête d’or (deuxième version) ; L’Échange (première version) * 1899 : La Jeune Fille Violaine (deuxième version) * 1901 : La Ville (deuxième version) * 1901 : Le Repos du septième jour * 1906 : Partage de midi, drame (première version) * 1911 : L’Otage, drame en trois actes * 1912 : L’Annonce faite à Marie (première version) * 1913 : Protée, drame satirique en deux actes (première version) * 1917 : L’Ours et la Lune * 1918 : Le Pain dur, drame en trois actes * 1919 : Les Choéphores d’Eschyle * 1920 : Le Père humilié, drame en quatre actes * 1920 : Les Euménides d’Eschyle * 1926 : Protée, drame satirique en deux actes (deuxième version) * 1927 : Sous le rempart d’Athènes * 1929 : Le Soulier de satin ou Le pire n’est pas toujours sûr, action espagnole en quatre journées (créé partiellement en 1943 par Jean-Louis Barrault, en version intégrale au théâtre d’Orsay en 1980; la version intégrale a été reprise en 1987 par Antoine Vitez) * 1933 : Le Livre de Christophe Colomb, drame lyrique en deux parties * 1939 : Jeanne d’Arc au bûcher * 1939 : La Sagesse ou la Parabole du destin (sous le pseudonyme de Delachapelle) * 1942 : L’Histoire de Tobie et de Sara, moralité en trois actes * 1947 : L’Endormie (deuxième version) * 1948 : L’Annonce faite à Marie (deuxième version) * 1949 : Protée, drame satirique en deux actes (deuxième version) * 1954 : L’Échange (deuxième version) * * Poésie1900, puis 1907 (2e éd.): Connaissance de l’Est * 1905 : Poèmes de la Sexagésime * 1907 : Processionnal pour saluer le siècle nouveau * 1911 : Cinq grandes odes * 1911 : Le Chemin de la Croix * 1911–1912 : La Cantate à trois voix * 1915 : Corona benignitatis anni dei * 1919 : La Messe là-bas * 1922 : Poèmes de guerre (1914-1916) * 1925 : Feuilles de saints * 1942 : Cent phrases pour éventails * 1945 : Visages radieux * 1945 : Dodoitzu, illustrations de Rihakou Harada. * 1949 : AccompagnementsEssais1907 : Art poétique. Œuvre composée de trois traités : Connaissance du temps. Traité de la co-naissance au monde et de soi-même. Développement de l’Église * 1928 : Positions et propositions, tome I * 1929 : L’Oiseau noir dans le soleil levant * 1934 : Positions et propositions, tome II * 1935 : Conversations dans le Loir-et-Cher * 1936 : Figures et paraboles * 1940 : Contacts et circonstances * 1942 : Seigneur, apprenez-nous à prier * 1946 : L’œil écoute * 1949 : Emmaüs * 1950 : Une voix sur Israël * 1951 : L’Évangile d’Isaïe * 1952 : Paul Claudel interroge l’Apocalypse * 1954 : Paul Claudel interroge le Cantique des Cantiques * 1955 : J’aime la Bible, Fayard * 1956 : Conversation sur Jean Racine * 1957 : Sous le signe du dragon * 1958 : Qui ne souffre pas… Réflexions sur le problème social * 1958 : Présence et prophétie * 1959 : La Rose et le rosaire * 1959 : Trois figures saintes pour le temps actuel * Mémoires, journal1954 : Mémoires improvisés. Quarante et un entretiens avec Jean Amrouche * 1968 : Journal. Tome I : 1904-1932 * 1969 : Journal. Tome II : 1933-1955Correspondance1949 : Correspondance de Paul Claudel et André Gide (1899-1926) * 1951 : Correspondance de Paul Claudel et André Suarès (1904-1938) * 1952 : Correspondance de Paul Claudel avec Gabriel Frizeau et Francis Jammes (1897-1938), accompagnée de lettres de Jacques Rivière * 1961 : Correspondance Paul Claudel et Darius Milhaud (1912-1953) * 1964 : Correspondance de Paul Claudel et Lugné-Poe (1910-1928). Claudel homme de théâtre * 1966 : Correspondances avec Copeau, Dullin, Jouvet. Claudel homme de théâtre * 1974 : Correspondance de Jean-Louis Barrault et Paul Claudel * 1984 : Correspondance de Paul Claudel et Jacques Rivière (1907-1924) * 1990 : Lettres de Paul Claudel à Élisabeth Sainte-Marie Perrin et à Audrey Parr * 1995 : Correspondance diplomatique. Tokyo (1921-1927) * 1995 : Correspondance de Paul Claudel et Gaston Gallimard (1911-1954) * 1996 : Paul Claudel, Jacques Madaule Connaissance et reconnaissance : Correspondance 1929-1954, DDB * 1998 : Le Poète et la Bible, volume 1, 1910-1946, Gallimard, coll. « Blanche » * 2002 : Le Poète et la Bible, volume 2, 1945-1955, Gallimard, coll. « Blanche » * 2004 : Lettres de Paul Claudel à Jean Paulhan (1925-1954), Correspondance présentée et annotée par Catherine Mayaux, Berne : Paul Lang, 2004 (ISBN 3-03910-452-7) * 2005 : Correspondance de Paul Claudel avec les ecclésiastiques de son temps. Volume I, Le sacrement du monde et l’intention de gloire, éditée par Dominique Millet-Gérard, Paris : Champion, coll. « Bibliothèque des correspondances, mémoires et journaux » n° 19, 2005, 655 p. (ISBN 2-7453-1214-6). * 2005 : Une Amitié perdue et retrouvée. Correspondance de Paul Claudel et Romain Rolland, édition établie, annotée et présentée par Gérald Antoine et Bernard Duchatelet, Paris : Gallimard, coll. « Les cahiers de la NRF », 2005, 479 p. (ISBN 2-07-077557-7) * 2017: Lettres à Ysé. Correspondance de Paul Claudel et Rosalie Vetch (éd. Gérald Antoine, préf. Jacques Julliard), Paris, Gallimard, 2017, 464 p., (ISBN 978-2070769117). Décoration * Grand-croix de la Légion d’honneur. Divers * Claudel a plus d’une fois exprimé son peu de goût pour les écrivains français du dix-septième siècle, à l’exception de Bossuet, qu’il admirait vivement.[réf. souhaitée] Le directeur de l’école des beaux-arts de Paris lui ayant demandé un sujet de concours de peinture, il proposa “ Hippolyte étendu sans forme et sans couleur.” (Racine, Phèdre, acte V)[réf. souhaitée][pertinence contestée] * Claudel n’a pas eu que des admirateurs, mais aussi des détracteurs. Après la mort de Claudel, André-Paul Antoine, journaliste à L’Information, a publié cette épitaphe littéraire dans son journal : « Si M. Paul Claudel mérite quelque admiration, ce n’est ni comme poète, ni comme diplomate, ni comme Français, c’est comme maître-nageur. » Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel


Marcel Proust, né à Paris le 10 juillet 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922, est un écrivain français, dont l’œuvre principale est une suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927. Issu d’une famille aisée et cultivée (son père est professeur de médecine à Paris), Marcel Proust est un enfant de santé fragile et toute sa vie il a des difficultés respiratoires graves causées par l’asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n’a pas d’emploi et il entreprend en 1895 un roman qui reste à l’état de fragments (publiés en 1952, à titre posthume, sous le titre Jean Santeuil). En 1900, il abandonne son projet et voyage à Venise et à Padoue pour découvrir les œuvres d’art en suivant les pas de John Ruskin sur qui il publie des articles et dont il traduit deux livres : La Bible d’Amiens et Sésame et les Lys. C’est en 1907 que Marcel Proust commence l’écriture de son grand œuvre À la recherche du temps perdu dont les sept tomes sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann) et 1927, c’est-à-dire en partie après sa mort ; le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix Goncourt en 1919. Marcel Proust meurt épuisé, le 18 novembre 1922, d’une bronchite mal soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, accompagné par une assistance nombreuse qui salue un écrivain d’importance que les générations suivantes placeront au plus haut en faisant de lui un véritable mythe littéraire. L’œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions de l’art qui doit proposer ses propres mondes, mais c’est aussi une réflexion sur l’amour et la jalousie, avec un sentiment de l’échec et du vide de l’existence qui colore en gris la vision proustienne où l’homosexualité tient une place importante. La Recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de deux cents acteurs. Proust recrée des lieux révélateurs, qu’il s’agisse des lieux de l’enfance dans la maison de Tante Léonie à Combray ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois, ces mondes étant traités parfois avec une plume acide par un auteur à la fois fasciné et ironique. Ce théâtre social est animé par des personnages très divers dont Marcel Proust ne cache pas les traits comiques : ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles ce qui fait d’À la recherche du temps perdu un roman à clé et le tableau d’une époque. La marque de Proust est aussi dans son style dont on remarque les phrases souvent très longues, qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours. Biographie Enfance Marcel Proust naît à Paris (quartier d’Auteuil dans le 16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Cette maison fut vendue puis détruite pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du percement de l’avenue Mozart. Sa mère, née Jeanne Clémence Weil, fille d’un agent de change d’origine juive alsacienne et lorraine de Metz, lui apporte une culture riche et profonde. Elle lui voue une affection parfois envahissante. Son père, le Dr Adrien Proust, fils d’un commerçant d’Illiers (en Eure-et-Loir), professeur à la Faculté de médecine de Paris après avoir commencé ses études au séminaire, est un grand hygiéniste, conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies. Marcel a un frère cadet, Robert, né le 24 mai 1873, qui devient chirurgien. Son parrain est le collectionneur d’art Eugène Mutiaux. Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux privations subies par sa mère au cours de sa grossesse, pendant le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris,. C’est pour se protéger des troubles entraînés par la Commune et sa répression que ses parents ont cherché refuge à Auteuil. L’accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent le nouveau-né. « Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune, le docteur Proust avait été blessé par la balle d’un insurgé, tandis qu’il rentrait de l’hôpital de la Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l’émotion qu’elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait d’échapper son mari. L’enfant qu’elle mit au monde bientôt après naquit si débile que son père craignit qu’il ne fût point viable. On l’entoura de soins ; il donna les signes d’une intelligence et d’une sensibilité précoces, mais sa santé demeura délicate. » Bien que réunissant les conditions pour faire partie de deux religions, fils d’un père catholique et d’une mère juive, lui-même baptisé à l’église Saint-Louis-d’Antin à Paris, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas se définir lui-même par rapport à une religion. Dreyfusard convaincu, il fut sensible à l’antisémitisme prégnant de son époque, et subit lui-même les assauts antisémites de certaines plumes célèbres. Sa santé est fragile et le printemps devient pour lui la plus pénible des saisons. Les pollens libérés par les fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes crises d’asthme. À neuf ans, alors qu’il rentre d’une promenade au Bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration ne revient pas. Son père le voit mourir. Un ultime sursaut le sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l’enfant, et sur l’homme plus tard : la mort peut le saisir dès le retour du printemps, à la fin d’une promenade, n’importe quand, si une crise d’asthme est trop forte. Années de jeunesse Il est au début élève d’un petit cours primaire, le cours Pape-Carpantier, où il a pour condisciple Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet et de son épouse Geneviève Halévy. Celle-ci tient d’abord un salon chez son oncle, où se réunissent des artistes, puis, lorsqu’elle se remarie en 1886 avec l’avocat Émile Straus, tient son propre salon, dont Proust sera un habitué. Marcel Proust étudie ensuite à partir de 1882 au lycée Condorcet. Il redouble sa cinquième et est inscrit au tableau d’honneur pour la première fois en décembre 1884. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile, mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur, comme dans Jean Santeuil. Il est l’élève en philosophie d’Alphonse Darlu, et il se lie d’une amitié exaltée à l’adolescence avec Jacques Bizet. Il est aussi ami avec Fernand Gregh, Jacques Baignères et Daniel Halévy (le cousin de Jacques Bizet), avec qui il écrit dans des revues littéraires du lycée. Le premier amour d’enfance et d’adolescence de l’écrivain est Marie de Benardaky, fille d’un diplomate polonais, sujet de l’empire russe, avec qui il joue dans les jardins des Champs Élysées, le jeudi après-midi, avec Antoinette et Lucie Félix-Faure Goyau, filles du futur président de la République, Léon Brunschvicg, Paul Bénazet ou Maurice Herbette. Il cessa de voir Marie de Benardaky en 1887, les premiers élans pour aimer ou se faire aimer par quelqu’un d’autre que sa mère avaient donc échoué. C’est la première « jeune fille », de celles qu’il a tenté de retrouver plus tard, qu’il a perdue. Les premières tentatives littéraires de Proust datent des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892, Gregh fonde une petite revue, avec ses anciens condisciples de Condorcet, Le Banquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence alors sa réputation de snobisme, car il est introduit dans plusieurs salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est ami un peu plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui a six ans de moins que lui. L’adolescent est fasciné par le futur écrivain. Ils se sont rencontrés au cours de l’année 1895. Leur liaison, au moins sentimentale, est révélée par le journal de Jean Lorrain. Proust devance l’appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890 à Orléans, au 76e régiment d’infanterie, et en garde un souvenir heureux. Il devient ami avec Robert de Billy. C’est à cette époque qu’il fait connaissance à Paris de Gaston Arman de Caillavet, qui devient un ami proche, et de la fiancée de celui-ci, Jeanne Pouquet, dont il est amoureux. Il s’inspire de ces relations pour les personnages de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Il est aussi introduit au salon de Madame Arman de Caillavet à qui il reste attaché, jusqu’à la fin et qui lui fait connaître le premier écrivain célèbre de sa vie, Anatole France (modèle de Bergotte). Rendu à la vie civile, il suit à l’École libre des sciences politiques les cours d’Albert Sorel (qui le juge « fort intelligent » lors de son oral de sortie) et d’Anatole Leroy-Beaulieu. Il propose à son père de passer les concours diplomatiques ou celui de l’École des chartes. Plutôt attiré par la seconde solution, il écrit au bibliothécaire du Sénat, Charles Grandjean, et décide dans un premier temps de s’inscrire en licence à la Sorbonne, où il suit les cours d’Henri Bergson, son cousin par alliance, au mariage duquel il est garçon d’honneur et dont l’influence sur son œuvre a été parfois jugée importante, ce dont Proust s’est toujours défendu. Marcel Proust est licencié ès lettres en mars 1895. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin de siècle, illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust fréquente le salon avec son ami le compositeur Reynaldo Hahn. Il a fait connaissance chez Mme Lemaire de Reynaldo Hahn, élève de Jules Massenet, qui vient chanter ses Chansons grises au printemps 1894. Proust, qui a vingt-trois ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d’avoir vingt ans, passent une partie de l’été 1894 au château de Réveillon chez Mme Lemaire. Le livre passe à peu près inaperçu et la critique l’accueille avec sévérité—notamment l’écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal qu’il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à la main. Face à lui, également un pistolet à la main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud. Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l’auteur débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se dissipe qu’après la publication des premiers tomes d’À la recherche du temps perdu. Rédaction de Jean Santeuil La fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons du milieu grand bourgeois et de l’aristocratie du Faubourg Saint-Germain et du Faubourg Saint-Honoré. Il y fait la connaissance du fameux Robert de Montesquiou, grâce auquel il est introduit entre 1894 et le début des années 1900 dans des salons plus aristocratiques, comme celui de la comtesse Greffulhe, cousine du poète et belle-mère de son ami Armand de Gramont, duc de Guiche, de Lady Hélène Standish, née de Pérusse des Cars, de la princesse de Wagram, née Rothschild, de la comtesse d’Haussonville, etc. Il y accumule le matériau nécessaire à la construction de son œuvre : une conscience plongée en elle-même, qui recueille tout ce que le temps vécu y a laissé intact, et se met à reconstruire, à donner vie à ce qui fut ébauches et signes. Lent et patient travail de déchiffrage, comme s’il fallait en tirer le plan nécessaire et unique d’un genre qui n’a pas de précédent, qui n’aura pas de descendance : celui d’une cathédrale du temps. Pourtant, rien du gothique répétitif dans cette recherche, rien de pesant, de roman– rien du roman non plus, pas d’intrigue, d’exposition, de nœud, de dénouement. Le 29 juin 1895, il passe le concours de bibliothécaire à la Mazarine, il y fait quelques apparitions pendant les quatre mois qui suivent et demande finalement son congé. En juillet, il passe des vacances à Kreuznach, ville d’eau allemande, avec sa mère, puis une quinzaine de jours à Saint-Germain-en-Laye, où il écrit une nouvelle, « La Mort de Baldassare Silvande », publiée dans La Revue hebdomadaire, le 29 octobre suivant et dédicacée à Reynaldo Hahn. Il passe une partie de mois d’août avec Reynaldo Hahn chez Mme Lemaire dans sa villa de Dieppe. Ensuite, en septembre, les deux amis partirent pour Belle-Île-en-Mer et Beg Meil. C’est l’occasion de découvrir les paysages décrits par Renan. Il rentre à Paris mi-octobre. C’est à partir de l’été 1895 qu’il entreprend la rédaction d’un roman qui relate la vie d’un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle. On y retrouve l’évocation du séjour à Réveillon qu’il fait à l’automne, encore chez Mme Lemaire, dans son autre propriété. Publié en 1952, ce livre, intitulé, après la mort de l’auteur, Jean Santeuil, du nom du personnage principal, est resté à l’état de fragments mis au net. L’influence de son homosexualité sur son œuvre semble pour sa part importante, puisque Marcel Proust fut l’un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de l’homosexualité (masculine et féminine) dans ses écrits, plus tard. Pour l’instant, il n’en fait aucunement part à ses intimes, même si sa première liaison (avec Reynaldo Hahn) date de cette époque. Léon Daudet décrit Proust arrivant au restaurant Weber vers 1905 : « Vers sept heures et demie arrivait chez Weber un jeune homme pâle, aux yeux de biche, suçant ou tripotant une moitié de sa moustache brune et tombante, entouré de lainages comme un bibelot chinois. Il demandait une grappe de raisin, un verre d’eau et déclarait qu’il venait de se lever, qu’il avait la grippe, qu’il s’allait recoucher, que le bruit lui faisait mal, jetait autour de lui des regards inquiets, puis moqueurs, en fin de compte éclatait d’un rire enchanté et restait. Bientôt sortaient de ses lèvres, proférées sur un ton hésitant et hâtif, des remarques d’une extraordinaire nouveauté et des aperçus d’une finesse diabolique. Ses images imprévues voletaient à la cime des choses et des gens, ainsi qu’une musique supérieure, comme on raconte qu’il arrivait à la taverne du Globe, entre les compagnons du divin Shakespeare. Il tenait de Mercutio et de Puck, suivant plusieurs pensées à la fois, agile à s’excuser d’être aimable, rongé de scrupules ironiques, naturellement complexe, frémissant et soyeux ». L’esthétique de Ruskin Vers 1900, il abandonne la rédaction de ce roman qui nous est parvenu sous forme de fragments manuscrits découverts et édités dans les années 1950 par Bernard de Fallois. Il se tourne alors vers l’esthète anglais John Ruskin, que son ami Robert de Billy, diplomate en poste à Londres de 1896 à 1899, lui fait découvrir. Ruskin ayant interdit qu’on traduise son œuvre de son vivant, Proust le découvre dans le texte, et au travers d’articles et d’ouvrages qui lui sont consacrés, comme celui de Robert de La Sizeranne, Ruskin et la religion de la beauté. À la mort de Ruskin, en 1900, Proust décide de le traduire. À cette fin, il entreprend plusieurs « pèlerinages ruskiniens », dans le nord de la France, à Amiens, et surtout à Venise, où il séjourne avec sa mère, en mai 1900, à l’hôtel Danieli, où séjournèrent autrefois Musset et George Sand. Il retrouve Reynaldo Hahn et sa cousine Marie Nordlinger qui demeurent non loin, et ils visitent Padoue, où Proust découvre les fresques de Giotto, Les Vertus et les Vices qu’il introduit dans La Recherche. Pendant ce temps, ses premiers articles sur Ruskin paraissent dans La Gazette des Beaux Arts. Cet épisode est repris dans Albertine disparue. Les parents de Marcel jouent d’ailleurs un rôle déterminant dans le travail de traduction. Le père l’accepte comme un moyen de mettre à un travail sérieux un fils qui se révèle depuis toujours rebelle à toute fonction sociale et qui vient de donner sa démission d’employé non rémunéré de la bibliothèque Mazarine. La mère joue un rôle beaucoup plus direct. Marcel Proust maîtrisant mal l’anglais elle se livre à une première traduction mot à mot du texte anglais ; à partir de ce déchiffrage, Proust peut alors « écrire en excellent français, du Ruskin », comme le nota un critique à la parution de sa première traduction, La Bible d’Amiens (1904). À l’automne 1900, la famille Proust emménage au 45, rue de Courcelles. C’est à cette époque que Proust fait la connaissance du prince Antoine Bibesco chez sa mère, la princesse Hélène, qui tient un salon où elle invite surtout des musiciens (dont Fauré qui est si important pour la Sonate de Vinteuil, même si c’est finalement la Sonate pour violon et piano no 2 de Brahms qui aura pu servir de modèle à la petite phrase) et des peintres. Les deux jeunes gens se retrouvent après le service militaire dans la Roumanie du prince, en automne 1901. Antoine Bibesco devient un confident intime de Proust, jusqu’à la fin de sa vie, tandis que l’écrivain voyage avec son frère Emmanuel Bibesco, qui aime aussi Ruskin et les cathédrales gothiques. Proust continue encore ses pèlerinages ruskiniens en visitant notamment la Belgique et la Hollande en 1902 avec Bertrand de Fénelon (autre modèle de Saint-Loup) qu’il a connu par l’intermédiaire d’Antoine Bibesco et pour qui il éprouve un attachement qu’il ne peut avouer. Le départ du fils cadet, Robert, qui se marie en 1903, transforme la vie quotidienne de la famille. L’écriture de La Recherche La première phrase de l’œuvre est posée en 1907. Pendant quinze années, Proust vit en reclus dans sa chambre tapissée de liège, au deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, où il a emménagé le 27 décembre 1906 après la mort de ses parents, et qu’il quittera en 1919. Portes fermées, Proust écrit, ne cesse de modifier et de retrancher, d’ajouter en collant sur les pages initiales les « paperolles » que l’imprimeur redoute. Plus de deux cents personnages vivent sous sa plume, couvrant quatre générations. Après la mort de ses parents, sa santé déjà fragile se détériore davantage en raison de son asthme. Il s’épuise au travail, dort le jour et ne sort—rarement—que la nuit tombée et dînant souvent au Ritz, seul ou avec des amis. Son œuvre principale, À la recherche du temps perdu, est publiée entre 1913 et 1927. Le premier tome, Du côté de chez Swann (1913), est refusé chez Gallimard sur les conseils d’André Gide, malgré les efforts du prince Antoine Bibesco et de l’écrivain Louis de Robert. Gide exprime ses regrets par la suite. Finalement, le livre est édité à compte d’auteur chez Grasset. L’année suivante, le 30 mai, Proust perd son secrétaire et ami, Alfred Agostinelli, dans un accident d’avion. Ce deuil, surmonté par l’écriture, traverse certaines des pages de La Recherche. Les éditions Gallimard acceptent le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel Proust reçoit en 1919 le prix Goncourt. C’est l’époque où il songe à entrer à l’Académie française, où il a des amis ou soutiens tels que Robert de Flers, René Boylesve, Maurice Barrès, Henri de Régnier... Il ne lui reste plus que trois années à vivre. Il travaille sans relâche à l’écriture des cinq livres suivants de La Recherche et meurt, épuisé, le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Il demeurait au 44, rue de l’Amiral-Hamelin à Paris. Une photographie, prise par Man Ray à la demande de Jean Cocteau, montre Marcel Proust sur son lit de mort, le 20 novembre. Les funérailles ont lieu le lendemain, 21 novembre, en l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d’honneur. L’assistance est nombreuse. Barrès dit à Mauriac sur le parvis de l’église : « Enfin, c’était notre jeune homme ! » Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, division 85. Les œuvres Les Plaisirs et les Jours Les Plaisirs et les Jours est un recueil de poèmes en prose et de nouvelles publié par Marcel Proust en 1896 chez Calmann-Lévy. Ce recueil s’inspire fortement du décadentisme et notamment du travail du dandy Robert de Montesquiou. Il s’agit du premier ouvrage de son auteur, qui cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de La Recherche. Jean Santeuil En 1895, Proust entreprend l’écriture d’un roman mettant en scène un jeune homme qui évolue dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Considéré comme une ébauche de La Recherche, Jean Santeuil ne constitue pas un ensemble achevé. Proust y évoque notamment l’affaire Dreyfus, dont il fut l’un des témoins directs. Il est l’un des premiers à faire circuler une pétition favorable au capitaine français accusé de trahison et à la faire signer par Anatole France. Les traductions de Ruskin La Bible d’Amiens (Wikisource) Sésame et les lys (Wikisource)Proust traduit La Bible d’Amiens (1904), de John Ruskin, et ce travail, ainsi que sa deuxième traduction, Sésame et les Lys (1906), est salué par la critique, dont Henri Bergson. Cependant, le choix des œuvres traduites ne se révèle pas heureux et l’ensemble est un échec éditorial. C’est pourtant pour le futur écrivain un moment charnière où s’affirme sa personnalité. En effet, il accompagne ses traductions de notes abondantes et de préfaces longues et riches qui occupent une place presque aussi importante que le texte traduit. Surtout, en traduisant Ruskin, Proust prend peu à peu ses distances avec celui-ci, au point de critiquer ses positions esthétiques. Cela est particulièrement perceptible dans le dernier chapitre de sa préface à La Bible d’Amiens qui tranche avec l’admiration qu’il exprime dans les trois premiers. Il reproche notamment à Ruskin son idolâtrie esthétique, critique qu’il adressa également à Robert de Montesquiou et qu’il fit partager par Swann et dans la Recherche. Pour Proust, c’est dévoyer l’art que d’aimer une œuvre parce que tel écrivain en parle ; il faut l’aimer pour elle-même. Contre Sainte-Beuve Le Contre Sainte-Beuve n’existe pas réellement : il s’agit d’un ensemble de pages, publiées à titre posthume en 1954 sous la forme d’un recueil associant des courts passages narratifs et de brefs essais (ou esquisses d’essais) consacrés aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant : Balzac, Flaubert, etc. Il y attaque Charles-Augustin Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l’œuvre d’un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et ne pourrait s’expliquer que par elle. En s’y opposant, Proust fonde sa propre poétique ; on peut considérer À la recherche du temps perdu comme une réalisation des idées exposées dans ces pages, dont certaines sont reprises par le narrateur proustien dans Le Temps Retrouvé, ou attribuées à des personnages ; d’autre part, nombre de passages narratifs ont été développés dans le roman. Pastiches et Mélanges Pastiches et Mélanges est une œuvre que Proust publie en 1919 à la NRF. Il s’agit d’un recueil de préfaces et d’articles de presse parus principalement dans Le Figaro à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard. Un extrait de cette oeuvre “ Journées de Lecture ”, préface à la traduction de Sésame et les lys de Ruskin, a été publié notamment chez 10-18, 1993 (ISBN 2-2640 1811-9), Gallimard, 2017 (ISBN 978-2-0727-0534-2) et Publie.net. À la recherche du temps perdu Des critiques[Qui ?] ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d’intrigue, l’écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l’âme. La composition de La Recherche en témoigne : les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s’apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l’amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l’existence, et de l’art. Son style écrit évoque son style parlé, caractérisé par une phrase parfois longue, « étourdissante dans ses parenthèses qui la soutenaient en l’air comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, (...) vous engaînait dans un réseau d’incidentes si emmêlées qu’on se serait laissé engourdir par sa musique, si l’on n’avait été sollicité soudain par quelque pensée d’une profondeur inouïe », mais selon « un rythme d’une infinie souplesse. Il le varie au moyen de phrases courtes, car l’idée populaire que la prose de Proust n’est composée que de phrases longues est fausse (comme si d’ailleurs les phrases longues étaient un vice) ». « Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y ait d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et qui, bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. « Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c’est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l’amour-propre, la passion, l’intelligence, et l’habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie ». (Le Temps retrouvé) L’œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La « Recherche du Temps Perdu » permet de s’interroger sur l’existence même du temps, sur sa relativité et sur l’incapacité à le saisir au présent. Une vie s’écoule sans que l’individu en ait conscience et seul un événement fortuit constitué par une sensation—goûter une madeleine, buter sur un pavé—fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur (notion de « réminiscence proustienne »). Le temps n’existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l’escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l’impossibilité qu’il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres. On garde toute sa vie l’image des êtres tels qu’ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu’à ce que les ayant reconnus l’individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté. L’analyse du snobisme et de la société aristocratique et bourgeoise de son temps fait de l’œuvre de Proust une interrogation majeure des mobiles sociaux de l’individu et de son rapport aux autres, instruments de l’ascension sociale. Comme Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd’hui des types sociaux ou moraux. Comme le Père Goriot, Eugénie Grandet, la Duchesse de Langeais ou Vautrin chez Balzac, Madame Verdurin, la duchesse de Guermantes, Charlus ou Charles Swann sont, chez Proust, des personnages en lesquels s’incarne une caractéristique particulière : ambition, désintéressement, suprématie mondaine, veulerie,,. L’amour et la jalousie sont analysés sous un jour nouveau. L’amour n’existe chez Swann, ou chez le Narrateur, qu’au travers de la jalousie. La jalousie, ou le simple fait de ne pas être l’élu, génèrerait l’amour, qui une fois existant, se nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de l’absence. Swann n’épouse Odette de Crécy que lorsqu’il ne l’aime plus. Le Narrateur n’a jamais autant aimé Albertine que lorsqu’elle a disparu (voir Albertine disparue). On n’aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d’inaccessible, on n’aime que ce qu’on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans La Prisonnière. Cette théorie développée dans l’œuvre reflète exactement la pensée de Proust, comme l’illustre la célèbre rencontre entre l’écrivain et le jeune Emmanuel Berl, rencontre que ce dernier décrira dans son roman Sylvia (1952). Lorsque Berl lui fait part de l’amour partagé qu’il éprouve pour une jeune femme, Proust dit sa crainte que Sylvia ne s’interpose entre Berl et son amour pour elle, puis devant l’incompréhension de Berl, qui maintient qu’il peut exister un amour heureux, se fâche et renvoie le jeune homme chez lui. La Recherche réserve une place importante à l’analyse de l’homosexualité, en particulier dans Sodome et Gomorrhe où apparaît sous son vrai jour le personnage de Charlus. Enfin, l’œuvre se distingue par son humour et son sens de la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur reproduit le style lyrique du valet Joseph Périgot ou les fautes de langage du directeur de l’hôtel de Balbec, qui dit un mot pour un autre (« le ciel est parcheminé d’étoiles », au lieu de « parsemé »). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare le rabâchage de sa gouvernante, Françoise, une femme d’extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur les mêmes sujets, au retour systématique du thème d’une fugue de Bach. Anecdotes Surnoms et pseudonymes La mère de Proust lui donnait, enfant, des surnoms affectueux, tels « mon petit jaunet » (un jaunet est un louis d’or ou un franc Napoléon en or), « mon petit serin », « mon petit benêt » ou « mon petit nigaud ». Dans ses lettres, son fils était « loup » ou « mon pauvre loup ». Ses amis et relations lui attribuaient d’autres sobriquets, plus ou moins amicaux, tels que « Poney », « Lecram » (anacyclique de Marcel), l’« Abeille des fleurs héraldiques », le « Flagorneur » ou le « Saturnien », et ils utilisaient le verbe « proustifier » pour qualifier sa manière d’écrire. Dans les salons, il était « Popelin Cadet », et ses dîners mémorables dans le grand hôtel parisien lui ont valu l’appellation de « Proust du Ritz ». Le romancier Paul Bourget affubla Proust d’un sobriquet faisant référence à son goût pour les porcelaines de Saxe. Il écrivit à la demi-mondaine Laure Hayman, amie des deux écrivains : « (...) votre saxe psychologique, ce petit Marcel (...) tout simplement exquis ». Laure Hayman avait donné à Marcel Proust un exemplaire de la nouvelle de Paul Bourget Gladys Harvey relié dans la soie d’un de ses jupons. Laure était le modèle supposé du personnage créé par Bourget, et avait écrit sur l’exemplaire offert à Proust une mise en garde : « Ne rencontrez jamais une Gladys Harvey ». Dans ses écrits, Proust a souvent employé des pseudonymes. Ses publications dans la presse sont signées Bernard d’Algouvres, Dominique, Horatio, Marc-Antoine, Écho, Laurence ou simplement D. Illiers-Combray Le village d’Illiers, en Eure-et-Loir, inspira à Proust le lieu fictif de Combray. À l’occasion du centenaire de sa naissance, en 1971, ce village d’Illiers où, enfant, le « petit Marcel » venait passer ses vacances chez sa tante Élisabeth Amiot, lui rendit hommage en changeant de nom pour devenir Illiers-Combray. C’est l’une des rares communes françaises à avoir adopté un nom emprunté à la littérature. La « maison de Tante Léonie », où Proust passa ses vacances d’enfance entre 1877 et 1880, est devenue le Musée Marcel Proust. Un timbre français de 0.30 + 0.10 de 1966 représente Marcel Proust avec le pont Saint-Hilaire à Illiers. Le questionnaire L’écrivain est également connu pour le Questionnaire de Proust (1886), en réalité un simple questionnaire de personnalité auquel il répondit par hasard dans son adolescence, et qui donna à Bernard Pivot l’idée d’élaborer le sien. Quelques réponses sont restées historiques, par exemple, à l’interrogation « Comment aimeriez-vous mourir ? », la réplique : « J’aimerais mieux pas. » Quelques années après son apparition chez Bernard Pivot, le questionnaire traversa l’Atlantique pour se retrouver dans l’émission télévisée Actors’ Studio, où James Lipton interviewe les stars du grand écran. Postérité Avec le temps, Proust s’impose comme l’un des auteurs majeurs du XXe siècle et est considéré dans le monde comme l’un des écrivains, voire l’écrivain le plus représentatif de la littérature française, au même titre que le sont Shakespeare, Cervantes, Dante et Goethe dans leurs pays respectifs, et est identifié à l’essence de ce qu’est la « littérature ». Il s’est écrit davantage de livres sur lui que sur tout autre écrivain français. Publications Ouvrages antérieurs à La Recherche Publiés par ProustLes Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896 La Bible d’Amiens, préface, traduction et notes de l’ouvrage de John Ruskin The Bible of Amiens, Mercure de France, 1904 Sésame et les lys, traduction de l’ouvrage de John Ruskin Sesame and Lilies, Mercure de France, 1906Ces deux ouvrages de Ruskin ont été réunis dans une édition critique établie par Jérôme Bastianelli, collection Bouquins, Robert Laffont, 2015 Pastiches et Mélanges, NRF, 1919Éditions posthumes Chroniques, 1927 Jean Santeuil, 1952 Contre Sainte-Beuve, 1954 Le chagrin de la marquise, 1961 Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009 Le Mensuel retrouvé, précédé de « Marcel avant Proust » de Jérôme Prieur (sous-titré Inédits), éditions des Busclats, novembre 2012 Mort de ma grand-mère, suivie d’une conclusion de Bernard Frank (écrivain). Grenoble, Éditions Cent Pages, 2013 (ISBN 978-2-9163-9041-3) À la recherche du temps perdu Éditions originalesDu côté de chez Swann, Grasset, 1913 Partie 1 : Combray Partie 2 : Un amour de Swann Partie 3 : Noms de pays : le nom À l’ombre des jeunes filles en fleurs, NRF, 1918, prix Goncourt Partie 1 : Autour de Mme Swann Partie 2 : Noms de pays : le pays Le Côté de Guermantes I et II, NRF, 1921-1922 Sodome et Gomorrhe I et II, NRF, 1922-1923 La Prisonnière, NRF, 1923 Albertine disparue (La Fugitive), 1925 Le Temps retrouvé, NRF, 1927Éditions diversesA la recherche du temps perdu : L’essentiel lu par Daniel Mesguich aux éditions Frémeaux & Associés Du côté de chez Swann Vol.1– Coffret 4 CD A l’ombre des jeunes filles en fleurs Vol. 2– Coffret 4 CD Le Côté de Guermantes Vol. 3– Coffret 4 CD Sodome et Gomorrhe Vol. 4– Coffret 4 CD Gallimard : Les quatre versions chez Gallimard utilisent toutes le même texte : Pléiade : édition en 4 volumes, avec notes et variantes Folio : édition en 7 volumes, poche Collection blanche : édition en 7 volumes, grand format Quarto : édition en 1 volume, grand format Garnier-Flammarion : édition en 10 volumes, poche Livre de Poche : édition en 7 volumes, poche Bouquins, Robert Laffont : édition en 3 volumes, grand format Omnibus, Presses de la Cité : édition en 2 volumes, grand format Intégrale, lue par André Dussollier, Guillaume Gallienne, Michael Lonsdale, Denis Podalydès, Robin Renucci et Lambert Wilson aux éditions Thélème Texte intégral de l’édition Gallimard de 1946-1947 en ligne sur Gutenberg Le manuscrit retrouvé d’À la recherche du temps perdu, Éditions des Saints-Pères, 2016 Correspondance Plusieurs volumes posthumes, publiés à partir de 1926. Robert de Billy, Marcel Proust, Lettres et conversations, Paris, Éditions des Portiques, 1930 Une première édition en 6 tomes (classée par correspondants), publiée par Robert Proust et Paul Brach : Correspondance générale (1930-1936). Une grande édition de référence en 21 tomes, où les lettres des volumes précédents sont reprises, augmentées, dotées d’une annotation universitaire et classées chronologiquement par Philip Kolb : Correspondance (Plon, 1971-1993). Une édition anthologique de l’édition de Philip Kolb, corrigée et présentée par Françoise Leriche, avec de nouvelles lettres inédites : Marcel Proust, Lettres (Plon, 2004). Bibliographie Ouvrages généraux Pierre Abraham, Proust, Rieder, 1930 Pierre Assouline, Autodictionnaire Proust, Omnibus, 2011 Jérôme Bastianelli, Dictionnaire Proust-Ruskin, Classiques Garnier, 2017, (ISBN 978-2-406-06716-0) Samuel Beckett, Proust, essai composé en anglais en 1930, traduit en français par É. Fournier, Les Éditions de Minuit, 1990 Annick Bouillaguet, Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires et références », 2004 Georges Cattaui, Marcel Proust, Proust et son Temps, Proust et le Temps, préface de Daniel-Rops, Julliard, 1953 Pietro Citati, La Colombe poignardée, Proust et la Recherche, Gallimard, 1997 Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Le Seuil, 1989 Antoine Compagnon et autres, Un été avec Proust, Éd. des Équateurs, 2014 Ernst Robert Curtius, Marcel Proust, Paris, La Revue Nouvelle, 1928 Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1970 Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, 1991 Roger Duchêne, L’Impossible Marcel Proust, Robert Laffont, 1994 Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, Plon/Grasset, 2013 Michel Erman, Marcel Proust, Fayard, 1994 Ramon Fernandez, À la gloire de Proust, Éditions de La Nouvelle Revue Critique, 1943 rééd. Grasset sous le titre Proust, 2009 (ISBN 9782246075226). Luc Fraisse, L’Éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll. Lettres françaises, 2013. Laure Hillerin, Proust pour Rire– Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, Flammarion, 2016. Edmond Jaloux, Avec Marcel Proust, La Palatine, Genève, 1953 Julia Kristeva, Le Temps sensible : Proust et l’expérience littéraire, Folio Essai, 2000 Giovanni Macchia, L’Ange de la Nuit (Sur Proust), Gallimard, 1993 Diane de Margerie, Proust et l’obscur, Albin Michel, 2010 Diane de Margerie, À la recherche de Robert Proust, Flammarion, 2016 Claude Mauriac, Proust par lui-même, coll. « Écrivains de toujours », Seuil, 1953 François Mauriac, Du côté de chez Proust, La Table ronde, 1947 André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, Hachette, 1949, étude et biographie littéraire. Ouvrage collectif, Proust, Hachette (coll. « Génies et réalités »), c1965, 1972 George D. Painter, Marcel Proust, 2 vol., Mercure de France, 1966-1968, traduit de l’anglais et préfacé par Georges Cattaui ; édition revue, en un volume, corrigée et augmentée d’une nouvelle préface de l’auteur, Mercure de France, 1992 Gaëtan Picon, Lecture de Marcel Proust, Mercure de France, 1963 Jérôme Picon, Marcel Proust, une vie à s’écrire, Flammarion, 2016 Léon Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son œuvre, Sagittaire, 1946 Jean-François Revel, Sur Proust, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1987 Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Seuil, 1974 Ernest Seillière, Marcel Proust, Éditions de La Nouvelle Revue critique, 1931 Anne Simon, Proust ou le réel retrouvé, Paris, PUF, 2000 Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, NRF/Biographie, Gallimard, 1996 Jean-Yves Tadié, De Proust à Dumas, Gallimard (coll. « Blanche »), 2006 Edmund White, Marcel Proust, Fides, 2001 Ouvrages iconographiques Georges Cattaui, Proust, documents iconographiques, éditions Pierre Cailler, collection « Visages d’hommes célèbres », 1956, 248 pages illustrées de 175 photos relatives à Marcel Proust. Collectif, Le Monde de Proust vu par Paul Nadar, édition du Centre des monuments nationaux / Éditions du Patrimoine, 1999– (ISBN 9782858223077) Pierre Clarac et André Ferré, Album Proust, Gallimard, collection Albums de la Pléiade, 1965. Eric Karpeles, Le musée imaginaire de Marcel Proust– Tous les tableaux de A la recherche du temps perdu, traduit de l’anglais par Pierre Saint-Jean, Thames and Hudson, 2017 André Maurois, Le Monde de Marcel Proust, Hachette, 1960 Mireille Naturel et Patricia Mante-Proust, Marcel Proust. L’Arche et la Colombe, Michel Lafon, 2012. Jérôme Picon, Marcel Proust, album d’une vie, Textuel, 1999. Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Parigramme, 1995. Monographies Céleste Albaret (et Georges Belmont), Monsieur Proust, Robert Laffont, 1973. Jacques Bersani (éd.), Les Critiques de notre temps et Proust, Garnier, 1971. Catherine Bidou-Zachariasen, Proust sociologue. De la maison aristocratique au salon bourgeois, Descartes, 1997. Maurice Blanchot, « L’étonnante patience », chapitre consacré à Marcel Proust dans le Livre à venir, Gallimard, 1959. Brassaï, Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, 1997. Étienne Brunet, Le Vocabulaire de Marcel Proust, avec l’Index complet et synoptique de À la recherche du temps perdu, 3 vol., 1918 p., Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1983 (préface de J.Y. Tadié). (ISBN 2051004749) (ISBN 9782051004749). Alain Buisine, Proust et ses lettres, Presses Universitaires de Lille, coll. « Objet », 1983. Jean-Yves Tadié, Marcel Proust : La cathédrale du temps, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard/Littératures » (no 381), 1999, rééd. 2017 Philippe Chardin, Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare, Honoré Champion, 2006. Philippe Chardin, Originalités proustiennes, Kimé, 2010 Philippe Chardin et Nathalie Mauriac Dyer, Proust écrivain de la Première Guerre mondiale, Dijon, EUD, 2014. Józef Czapski, Proust contre la déchéance : Conférence au camp de Griazowietz, Noir sur blanc, 2004 et 2011. Serge Doubrovsky, La Place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust, Mercure de France, 1974. Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust (accompagnés de lettres inédites), Paris, Grasset, 1926. Maurice Duplay, Mon ami Marcel Proust : souvenirs intimes. Cet ouvrage contient notamment une lettre de Marcel Proust à Maurice Duplay, Editions Gallimard, 1972 Clovis Duveau, Proust à Orléans, édité par les Musées d’Orléans, 1998. Michel Erman, Le Bottin proustien. Qui est dans « La Recherche » ?, Paris, La Table Ronde, 2010. Michel Erman, Le Bottin des lieux proustiens, La Table ronde, 2011. Luc Fraisse, L’Œuvre cathédrale. Proust et l’architecture médiévale, José Corti, 1990, 574 pages. Louis Gautier-Vignal, Proust connu et inconnu, Robert Laffont, 1976. Jean-Michel Henny, Marcel Proust à Évian. Étape d’une vocation. Chaman édition, Neuchâtel, 2015. Geneviève Henrot Sostero, Pragmatique de l’anthroponyme dans À la recherche du temps perdu, Paris, Champion, 2011. Anne Henry, La Tentation de Proust, Paris, PUF, 2000, (ISBN 2-13-051075-2) Laure Hillerin, La comtesse Greffulhe. L’ombre des Guermantes, Flammarion, 2014. Philip Kolb, La correspondance de Marcel Proust, chronologie et commentaire critique, University of Illinois Press, 1949 Elisabeth Ladenson, Proust lesbien (préface d’Antoine Compagnon), Ed. EPEL 2004. Luc Lagarde, Proust à l’orée du cinéma, L’âge d’Homme, 2016 Nathalie Mauriac Dyer, Proust inachevé, le dossier Albertine disparue, Honoré Champion, 2005. Marie Miguet-Ollagnier, La Mythologie de Marcel Proust, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon », 1982, 425 p. (ISBN 2-251-60276-3). Christian Péchenard, Proust à Cabourg ; Proust et son père ; Proust et Céleste, in Proust et les autres, Éditions de la Table ronde, 1999. Léon Pierre-Quint, Comment travaillait Proust, Bibliographie, Les Cahiers Libres, 1928. Georges Poulet, L’Espace proustien, Gallimard, 1963. Jérôme Prieur, Proust fantôme, Gallimard, 2001 et 2006 Jérôme Prieur Marcel avant Proust, suivi de Proust, Le Mensuel retrouvé, éditions des Busclats, 2012 Henri Raczymow, Le Cygne de Proust, Gallimard, coll. L’un et l’autre, 1990. Jean Recanati, Profils juifs de Marcel Proust, Paris, Buchet-Chastel, 1979. Thomas Ravier, Éloge du matricide : Essai sur Proust, Gallimard, coll. « L’Infini », Paris, 2008, 200 p. (ISBN 978-2-07-078443-1) Jacqueline Risset, Une certaine joie. Essai sur Proust, Éditions Hermann, 2009. Jean-Yves Tadié (dir.), Proust et ses amis, Colloque fondation Singer-Polignac, Gallimard, « Les cahiers de la NRF », 2010. Nayla Tamraz, Proust Portrait Peinture, Paris, Orizons, coll. Universités/Domaine littéraire, 2010 Davide Vago, Proust en couleur, coll. « Recherches proustiennes », Honoré Champion, 2012 (ISBN 9782745323927) Stéphane Zagdanski, Le Sexe de Proust, Gallimard, 1994 (ISBN 2070738779) Adaptations Filmographie Céleste, de Percy Adlon, film allemand avec pour personnage principal Céleste Albaret (1981). Le Temps retrouvé, de Raoul Ruiz (1998). Un amour de Swann, de Volker Schlöndorff (1984). La Captive, de Chantal Akerman (2000). À la recherche du temps perdu, téléfilm en deux parties de Nina Companeez (diffusé sur France 2 en février 2011). Divers Suso Cecchi D’Amico et Luchino Visconti : À la recherche du temps perdu, scénario d’après Marcel Proust, Persona, 1984. Harold Pinter : Le Scénario Proust : À la recherche du temps perdu, avec la collaboration de Joseph Losey et Barbara Bray, traduction de l’anglais par Jean Pavans, scénario d’après Marcel Proust, Gallimard, Paris, 2003. Stéphane Heuet : À la recherche du temps perdu, bande dessinée d’après Marcel Proust, 5 vol. parus, Delcourt, Tournai, Belgique, 1998-2008. Alberto Lombardo, L’Air de rien, adaptation théâtrale de À la recherche du temps perdu sur la relation Albertine-Marcel, 1988. À la recherche du temps perdu, version manga, traduit du japonais par Julien Lefebvre-Paquet, Soleil Manga, 2011 (ISBN 2-302-01879-6) Voir aussi Prix Marcel-Proust Prix de la Madeleine d’or L’hôtel littéraire Le Swann a été inauguré le 14 novembre 2013 pour le centenaire de la publication de Du côté de chez Swann, le premier tome d’À la recherche du temps perdu. Il est situé 11-15 rue de Constantinople à Paris, dans le 8e arrondissement. L’ensemble de la décoration rend hommage à Marcel Proust et à son œuvre et un espace d’exposition présente des livres rares et des manuscrits. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust

Arsène Houssaye, pseudonyme d’Arsène Housset 28 mars 1814 à Bruyères-et-Montbérault et mort le 26 février 1896 à Paris, est un homme de lettres français. Il est également connu sous le pseudonyme d’Alfred Mousse. Biographie Issu d’une famille bourgeoise apparentée à Condorcet, Arsène Houssaye s’enfuit de chez lui en 1832 pour mener une vie de bohème à Paris. Il s’engage dans une troupe de baladins pour qui il compose des chansons. Il se lie avec Théophile Gautier, Gérard de Nerval – qui logent comme lui, impasse du Doyenné, à l’emplacement actuel de la place du Carrousel – Jules Janin ou Alphonse Esquiros: tous collaboreront à la revue L’Artiste, dont Houssaye devient le directeur en 1843 et où il accueille de jeunes écrivains comme Théodore de Banville, Henri Murger, Charles Monselet, Champfleury et Charles Baudelaire. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes et à La Revue de Paris. Il collabore avec son ami Jules Sandeau. Il a dirigé le quotidien populaire La Presse. Baudelaire lui a dédié les poèmes en prose du Spleen de Paris. La publication de ces textes dans La Presse en 1862 fut néanmoins à l’origine d’une brouille entre les deux hommes, car Houssaye, cherchant à obtenir la suppression de certains poèmes qui pouvaient choquer ses lecteurs, en retarda la publication au prétexte que Baudelaire lui envoyait des textes dont certains avaient déjà été publiés dans des revues. En résulta une rupture de contrat qui affecta durement Baudelaire, qui avait alors un besoin impérieux d’argent. En 1848, il participe au mouvement réformateur qui précède la révolution et harangue picards et champenois au fameux banquet des étudiants. Aux élections législatives dans le département de l’Aisne, il est battu par Odilon Barrot. De 1849 à 1856, grâce à l’influence de Rachel, il est nommé administrateur général de la Comédie-Française, où il fait entrer les pièces de Victor Hugo, d’Alexandre Dumas père, d’Alfred de Musset de François Ponsard ou de Léon Gozlan. Malgré l’augmentation de la dette, son administration correspond à une période de remarquable succès pour le Théâtre-français. En 1857, il est nommé inspecteur des musées de province. Il devient directeur, en 1866, de la Revue du XIXe siècle. Après 1870, il fonde La Gazette de Paris puis La Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg. En 1884, il fut président de la Société des gens de lettres. Il a publié de nombreux ouvrages, s’essayant à tous les genres: roman (La Couronne de bluets, Une Pécheresse, La Vertu de Rosine, Les Trois Sœurs, Mademoiselle Mariani, Mademoiselle Rosa) ; théâtre (Les Caprices de la Marquise, La Comédie à la fenêtre, Le Duel à la tour) ; poésie (Les Sentiers perdus, La Poésie dans les bois, La Symphonie de vingt ans, Cent et un sonnets), essais d’histoire de l’art et de critique, souvenirs (Les Confessions)… Il rend avec élégance l’atmosphère de la Régence ou du règne de Louis XV, introduisant un soupçon de sentiment romantique dans l’élégance spirituelle du XVIIIe siècle, qu’il contribua, avec Edmond et Jules de Goncourt, à remettre au goût du jour. Son livre le plus connu est sans doute son Histoire du quarante-et-unième fauteuil de l’Académie française (1845), qui passe en revue tous les grands écrivains qui n’ont jamais appartenu à l’illustre Compagnie et imagine leurs discours de réception. Arsène Houssaye ne se portera jamais candidat à l’Académie française, mais son fils, l’historien Henry Houssaye (1848-1911) en sera membre en 1894. S’étant enrichi grâce à de fructueuses spéculations immobilières, Arsène Houssaye habitait une propriété située à l’emplacement actuel du 39 avenue de Friedland (VIIIe arrondissement), issue du lotissement du parc Beaujon (1824). Il y logea d’abord dans « un château à trois tours avec un parc orné de fontaines et de grottes, un jardin où couraient les treilles […] un pavillon gothique et un autre chinois » (André de Fouquières, Mon Paris et ses parisiens, 1953, p. 38). Dans les vignes du jardin, on célébrait des bacchanales restées célèbres. Houssaye fit ensuite construire, à la place de ce château, un hôtel de style Renaissance, orné de médaillons d’Auguste Clésinger. « C’est là, écrit encore André de Fouquières, que se donnèrent tant de redoutes célèbres dont l’une fut, dit-on, l’occasion d’une première rencontre entre Mme de Loynes et l’austère Jules Lemaître. […] Sur le palier de l’étage, […] [se trouvait] la chaise à porteurs où, au cours des folles redoutes de jadis, venaient se cacher pour intriguer leurs cavaliers, les invitées d’Arsène Houssaye, Ferdinand Bac m’a beaucoup parlé des fastes de cette demeure, du faux Raphaël dont l’excellent Arsène était si fier et pour l’achat duquel, lui toujours à court d’argent du fait de ses constantes générosités, avait consenti de gros sacrifices. C’est encore Bac qui me conta que le vieil Arsène Houssaye, qui devait pour bonne part sa charge d’administrateur du Français à Rachel, invita certain soir la jeune Sarah Bernhardt à dîner au restaurant Cubat, dans l’ancien hôtel de la Païva. De Rachel à Sarah… » (op. cit., p. 36-37). À proximité, la rue Arsène Houssaye est aujourd’hui seule à rappeler le souvenir de cette demeure. Émile Zola, qui fréquenta les « mardis » de Houssaye, avenue de Friedland, l’appela, dans l’éloge funèbre qu’il prononça lors de ses obsèques le 29 février 1896: « Un des derniers grands chênes de la forêt romantique. » Vie privée Arsène Houssaye avait épousé en premières noces, le 5 avril 1842 à Paris, Anne Stéphanie Bourgeois-Brucy (née le 26 novembre 1821 à Paris, où elle est décédée le 12 décembre 1854). Le couple a eu un fils: Georges Henry (1848-1911). Veuf, Arsène Houssaye avait épousé en secondes noces, le 19 juin 1862 à Paris, Marie Jeanne Nathalie Belloc (née vers 1836 à Lima, au Pérou, et décédée le 13 septembre 1864 à Paris). Le peintre Eugène Delacroix et l’écrivain Théophile Gautier furent témoins à ce second mariage qui n’a pas eu de descendance. Sa première épouse est décédée à 33 ans, et la seconde vers l’âge de 28 ans. Œuvres * De profundis, sous le pseudonyme d’Alfred Mousse (1834) * La Couronne de bluets, roman (1836) * Une pécheresse (1837) * Le Serpent sous l’herbe (1838) * La Belle au bois dormant (1839) * Fanny (1840) * Les Revenants, avec Jules Sandeau (1840) * Les Onze maîtresses délaissées (1841) * Les Sentiers perdus, poésies (1841) * Le XVIIIe siècle: poètes, peintres, musiciens (1843) * L’arbre de science: roman posthume de Voltaire, imprimé sur un manuscrit de Madame Duchâtelet, pastiche attribué à Arsène Houssaye (1843) * Le Café de la Régence (1843) * Elisabeth, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845) * La fontaine aux loups, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845) * Mlle de Marivaux, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845) * Un roman sur les bords du Lignon (1843) * Mademoiselle de Kérouare, avec Jules Sandeau (1843) * Madame de Vandeuil, avec Jules Sandeau (1843) * Marie, avec Jules Sandeau (1843) * Milla, avec Jules Sandeau (1843) * Les Caprices de la marquise, comédie en 1 acte, Paris, Odéon, 12 mai 1844 * Madame de Favières (1844) * Mlle de Camargo (1844) * Revue du salon de 1844 (1844) * L’abbé Prévost et Manon Lescaut (1844) * La Poésie dans les bois (1845) * Histoire de la peinture flamande et hollandaise (1846) * Romans, contes et voyages (1846) * Les Trois sœurs (1846) * Un martyr littéraire: touchantes révélations (1847) * Manon Lescaut a-t-elle existé ? (1847) * Les Aventures galantes de Margot (1850) * Voyage à Venise (1850) * Voyage à Paris, dans Revue pittoresque, page 60, 1850 * Un drame en 1792, dans Revue pittoresque, page 89, 1850 * La Pantoufle de Cendrillon (1851) * Philosophes et comédiennes (1851) * Voyage à ma fenêtre (1851) * La Comédie à la fenêtre, écrite le matin pour être jouée le soir, Paris, Hôtel Castellane, 22 mars 1852 * Les Peintres vivants (1852) * La Vertu de Rosine, roman philosophique (1852) * Sous la Régence et sous la Terreur: talons rouges et bonnets rouges (1853) * Le repentir de Marion (1854) * Histoire du 41e fauteuil de l’Académie française (1855) ; texte 7e édition, librairie de L. Hachette et Cie, 1864, sur Gallica * Les comédiennes d’autrefois (1855) * Voyages humoristiques: Amsterdam, Paris, Venise (1856) * Galerie flamande et hollandaise (1857) * Une chambre à coucher (1857) * Le roi Voltaire, sa jeunesse, sa cour, ses ministres, son peuple, ses conquêtes, sa mort, son Dieu, sa dynastie (1858) * L’Amour comme il est (1858) * Les trois sœurs (1858) * Les filles d’Ève (1858) * Mademoiselle Mariani, histoire parisienne (1859) * Romans parisiens: la Vertu de Rosine ; le Repentir de Marion ; le Valet de cœur et la dame de carreau ; Mademoiselle de Beaupréau ; le Treizième convive (1859) * Le Royaume des roses (1861) * Les Parisiennes 2e série des ″Grandes dames″ (1862) * Les Charmettes, Jean-Jacques Rousseau et madame de Warens (1863) * Les femmes du temps passé (1863) * Les hommes divins (1864) * Blanche et Marguerite (1864) * Les dieux et les demi-dieux de la peinture (1864) * Madame de Montespan, études historiques sur la cour de Louis XIV (1864) * Mademoiselle Cléopatre, histoire parisienne (1864) * Le Repentir de Marion et les Peines de cœur de Madame de La Popelinière (1865) * Le Roman de la duchesse, histoire parisienne (1865) * Les pigeons de Venise (1865) * Les légendes de la jeunesse (1866) * Notre-Dame de Thermidor: histoire de Madame Tallien (1866) * Le Palais pompéien de l’avenue Montaigne: études sur la maison gréco-romaine, ancienne résidence du prince Napoléon (1866) * Les femmes du diable (1867) * Merveilles de l’art flamand (1867) * La Pantoufle de Cendrillon, ou Suzanne aux coquelicots, conte (1867) * Histoire de Léonard de Vinci (1869) * Les Courtisanes du grand monde, 3e et dernière série des ″Grandes Dames″ (1870) * Le Chien perdu et la femme fusillée (1872) * La question des jeux: opinions des moralistes, des journaux et des hommes politiques (1872) * Juliette et Roméo, comédie en 1 acte en prose, Paris, Ambigu-comique, 1873 * Lucie, histoire d’une fille perdue (1873) * Mademoiselle Trente-Six Vertus, drame en 5 actes et 7 tableaux, Paris, Ambigu-comique, 2 mai 1873 * Tragique aventure de bal masqué (1873) * Les Cent et un sonnets (1874) * Louis XV (1874) * Les Mains pleines de roses, pleines d’or et pleines de sang (1874) * Le roman des femmes qui ont aimé (1874) * Van Ostade, sa vie et son œuvre (1874) * Les Dianes et les Vénus (1875) * Jacques Callot: sa vie et son œuvre (1875) * Les Mille et une nuits parisiennes, 4 vol. (1875) * Histoire étrange d’une fille du monde (1876) * Tableaux rustiques. Le Cochon (1876) * La Révolution (1876) * Alice: roman d’hier (1877) * Les amours de ce temps-là (1877) * Les Charmeresses (1878) * La comtesse Du Barry (1878) * Les Larmes de Jeanne, histoire parisienne (1878) * Les Trois duchesses (1878) * Les comédiennes de Molière (1879) * Des Destinées de l’âme (1879) * L’Éventail brisé (1879) * Histoires romanesques (1879) * La Robe de la mariée (1879) * Molière, sa femme et sa fille (1880) * La Comédie-française: 1680-1880 (1880) * Mlle Rosa (1882) * Les Princesses de la ruine (1882) * La Belle Rafaella (1883) * Les Douze nouvelles nouvelles (1883) * La Comédienne (1884) * La Couronne d’épines (1884) * Les Confessions, souvenirs d’un demi-siècle, 6 vol. (1885-1891) * Contes pour les femmes (1885-1886) * Les Onze mille vierges (1885) * Les Comédiens sans le savoir (1886) * Le Livre de minuit (1887) * Madame Lucrèce (1887) * Madame Trois-Étoiles (1888) * Rodolphe et Cynthia, roman parisien (1888) * La Confession de Caroline (1890) * Les femmes démasquées (1890-1895) * Julia (1891) * Blanche et Marguerite (1892) * Les Femmes comme elles sont (1892) * Les Larmes de Mathilde (1894) * Un hôtel célèbre sous le second empire. L’hôtel Païva, ses merveilles, précédé de l’ancien hôtel de la marquise de Païva (1896) * Souvenirs de jeunesse: 1830-1850, Paris, Éditions Ernest Flammarion, 1896, VII-322 p. (Wikisource) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A8ne_Houssaye

Alejandrina Benítez de Gautier (Mayagüez, Puerto Rico, 1819-1879) fue una poeta puertorriqueña. Perdió a sus padres y se quedó a cargo de su tía, la poetisa María Bibiana Benítez. Se casó con Rodulfo Gautier el 12 de abril de 1848, en Caguas, Puerto Rico y tuvieron un hijo llamado José Gautier Benítez, que fue un reputado poeta. Murió en 1879 con 60 años. Colaboró con el Aguinaldo Puertorriqueño, publicación de 1843 de jóvenes literatos. Escribió un poema llamado La Patria del Genio dedicado a José Campeche, por el que le dieron 100 pesos en la «Sociedad Económica Amigos del País». Puerto Rico ha honrado su memoria dedicádole varias escuelas e incluso hay una en Brooklyn que ha recibido su nombre. Fue madre del poeta José Gautier Benítez.