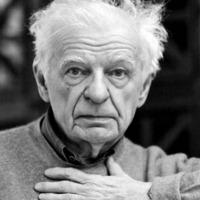Deux barques
L’orage qui s’attarde, le lit défait,
La fenêtre qui bai dans la chaleur
Et le sang dans sa fièvre : je reprends
La main proche à son rêve, la cheville
A son anneau de barque retenue
Contre un appontemeni, dans une écume,
Puis le regard, puis la bouche à l’absence
Et tout le brusque éveil dans l’été nocturne
Pour y porter l’orage et le finir.
Où que tu sois quand je te prends obscure,
S’étant accru en nous ce bruit de mer.
Accepte d’être l’indifférence, que j’étreigne
A l’exemple de
Dieu l’aveugle la matière
La plus déserte encore dans la nuit.
Accueille-moi intensément mais distraitement,
Fais que je n’aie pas de visage, pas de nom
Pour qu’étant le voleur je te donne plus
Et l’étranger l’exil, en toi, en moi
Se fasse l’origine...—
Oh, je veux bien.
Toutefois, l’oubliant, je suis avec toi,
Desserres-tu mes doigts.
Formes-tu de mes paumes une coupe,
Je bois, prés de ta soif.
Puis laisse l’eau couler sur tous nos membres.
Eau qui fait que nous sommes, n’étant pas,
Eau qui prend au travers des coips arides
Pour une joie éparse dans l’énigme,
Pressentiment pourtant !
Te souviens-tu,
Nous allions par ces champs barrés de pierre.
Et soudain la citerne, et ces deux présences
Dans quel autre pays de l’été désert ?
Regarde comme ils se penchent, eux comme nous,
Est-ce nous qu’ils écoutent, dont ils parlent,
Souriant sous les feuilles du premier arbre
Dans leur lumière heureuse un peu voilée ?
Et ne dirait-on pas qu’une lueur
Autre, bouge dans cet accord de leurs visages
Et, riante, les mêle ?
Vois, l’eau se trouble
Mais les formes en sont plus pures, consumées.
Quel est le vrai de ces deux mondes, peu importe.
Invente-moi, redouble-moi peut-être
Sur ces confins de fable déchirée.
J’écoute, je consens.
Puis j’écarte le bras qui s’est replié,
Me dérobant la face lumineuse.
Je la touche à la bouche avec mes lèvres,
En désordre, brisée, toute une mer.
Comme
Dieu le soleil levant je suis voûté
Sur cette eau où fleurit notre ressemblance.
Je murmure :
C’est donc ce que tu veux,
Puissance errante insatisfaite par les mondes,
Te ramasser, une vie, dans le vase
De terre nue de notre identité ?
Et c’est vrai qu’un instant tout est silence.
On dirait que le temps va faire halte
Comme s’il hésitait sur le chemin.
Regardant par-dessus l’épaule terrestre
Ce que nous ne pouvons ou ne voulons voir.
Le tonnerre ne roule plus dans le ciel calme.
L’ondée ne passe plus sur notre toit,
Le volet, qui heurtait à notre rêve,
Se tait courbé sur son âme de fer.
J’écoute, je ne sais quel bruit, puis je me lève
Et je cherche, dans l’ombre encore, où je retrouve
Le verre d’hier soir, à demi plein.
Je le prends, qui respire à notre souffle,
Je te lais le toucher de ta soif obscure,
Et quand je bois l’eau tiède où furent tes lèvres,
C’est comme si le temps cessait sur les miennes
Et que mes yeux s’ouvraient, à enfin le jour.
Donne-moi ta main sans retour, eau incertaine
Que j’ai désempierrée jour après jour
Des rêves qui s’attardent dans la lumière
Et du mauvais désir de l’infini.
Que le bien de la source ne cesse pas
A l’instant où la source est retrouvée,
Que les lointains ne se séparent pas
Une nouvelle fois du proche, sous la faux
De l’eau non plus tarie mais sans saveur.
Donne-moi ta main et précède-moi dans l’été mortel
Avec ce bruit de lumière changée.
Dissipe-toi me dissipant dans la lumière.
Les images, les mondes, les impatiences.
Les désirs qui ne savent pas bien qu’ils dénouent,
La beauté mystérieuse au sein obscur.
Aux mains frangées pourtant d’une lumière,
Les rires, les rencontres sur des chemins,
El les appels, les dons, les consentements,
Les demandes sans fin, naître, insensé.
Les alliances éternelles et les hâtives.
Les promesses miraculeuses non tenues
Mais, tard, l’inespéré, soudain : que tout cela
La rose de l’eau qui passe le recueille
En se creusant ici. puis l’illumine
Au moyeu immobile de la roue.
Paix, sur l’eau éclairée.
On dirait qu’une barque
Passe, chargée de fruits : et qu’une vague
De suffisance, ou d’immobilité.
Soulève notre lieu et cette vie
Comme une barque à peine autre, liée encore.
Aie confiance, et laisse-toi prendre, épaule nue.
Par l’onde qui s’élargit de l’été sans fin.
Dors, c’est le plein été : et une nuit
Par excès de lumière : et va se déchirer
Notre éternelle nuit : va se pencher
Souriante sur nous l’Égvptienne.
Paix, sur le flot qui va.
Le temps scintille.
On dirait que la barque s’est arrêtée.
On n’entend plus que se jeter, se désunir,
Contre le liane désert l’eau infinie.
Le feu, ses joies de sève déchirée.
La pluie, ou rien qu’un vent peut-être sur les tuiles.
Tu cherches ton manteau de l’autre année.
Tu prends les clefs, tu sors, une étoile brille.
Éloigne-toi
Dans les vignes, vers la montagne de
Vachères.
A l’aube
Le ciel sera plus rapide.
Un cercle
Où tonne l’indifférence.
De la lumière
A la place de
Dieu.
Presque du feu, vois-tu,
Dans le baquet de l’eau de la pluie nocturne.
Dans le rêve, pourtant.
Dans l’autre feu obscur qui avait repris.
Une servante allait avec une lampe
Loin devant nous.
La lumière était rouge
Et ruisselait
Dans les plis de la robe contre la jambe
Jusqu’à la neige.
Étoiles, répandues.
Le ciel, un lit défait, une naissance.
Et l’amandier, grossi
Après deux ans : le flot
Dans un bras plus obscur, du même fleuve.
O amandier en fleurs,
Ma nuit sans fin.
Aie confiance, appuie-toi enfant
A cette foudre.
Branche d’ici, brûlée d’absence, bois
De tes fleurs d’un instant au ciel qui change.
Je suis sorti
Dans un autre univers.
C’était
Avant le jour.
J’ai jeté du sel sur la neige.