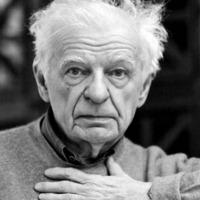Les nuées
Deux fois silencieuse l’après-midi
Par vertu de l’été désert, et d’une flamme
Qui déborde, on ne sait si de ce vase
Ou de plus haut encore dans le ciel.
Nous avons donc dormi : je ne sais combien
D’étés dans la lumière ; et je ne sais
Non plus dans quels espaces nos yeux s’ouvrent.
J’écoute, rien ne vibre, rien ne finit.
A peine le désir façonnant l’image
Tourne-t-il méditant, sur son axe simple.
L’argile d’un éveil en rêve, trempée d’ombre.
Toutefois le soleil bourdonne sur la vitre
El, l’âme enveloppée de ses rouges élyires.
Il descend, mais en paix, vers la terre des morts.
Au-dessus de moi seul, quand je traçais
Le signe d’espérance en temps de guerre,
Une nuée rôdait noire et le vent
Dispersait à grandes lueurs la phrase vaine.
Au-dessus de nous deux, qui avons voulu
Le nœud, le déliement, une énergie
S’accumula entre deux hauts flancs sombres
Et il y eut, enfin,
Comme un tressaillement dans la lumière.
Autres pays, montagnes éclairées
Du ciel, lacs au-delà, inapprochés, nouvelles
Rives,—apaisement des dieux progéniteurs,
L’éclair aura été sa propre cause
Et au-dessus de l’enfant à ses jeux
L’anneau de ces nuages, le feu clair
Qui semble s’attarder ce soir, comme une preuve.
Nuages, oui,
L’un à l’autre, navires à l’arrivée
Dans un rapport de musique.
Il me semble, parfois,
Que la nécessité se métamorphose
Comme à la fin du
Conte d’hiver
Quand chacun reconnaît chacun, quand on apprend
De niveau en niveau dans la lumière
Que ceux qu’avaient jetés l’orgueil, le doute
De contrées en contrées dans le dire obscur
Se retrouvent, se savent.
Parole en cet instant
Leur silence ; et silence leurs quelques mots
On ne sait si de joie ou de douleur
Bien qu’à coup sûr l’extrême de l’une ou l’autre ».
Ils semblent, dit encore
Un témoin, méditant, et qui s’éloigne,
Entendre la nouvelle
D’un monde rédimé ou d’un monde mort.
Nuages,
Et ces deux pourpres là-bas un père, une fille.
Et cet autre plus proche, la statue
D’une femme, mère de la beauté, mère du sens.
Dont on voit bien qu’immobile longtemps.
Étouffée dans sa voix de siècle en siècle.
Déniée, animée
Par rien que la magie de la sculpture.
Elle prend vie. elle va parler.
Foudre ses yeux
Qui s’ouvrent dans le gouffre du safre clair,
Mais foudre souriante comme si,
Condamnée à suivre le rêve au flux stérile
Mais découvrant de l’or dans le sable vierge,
Elle avait médité et consenti.
L’homme d’ailleurs s’approche, son visage
Déchiré s’apaisant de tant de joie.
Il gravit les degrés de l’heure qui roule
En rafales, car le ciel change, la nuit vient.
Et vacille où elle l’attend, nuit étoilée
Qui s’ébrase. musique.
Il se redresse.
11 se tourne vers l’univers.
Ses traits scintillen’
De la phosphorescence de l’absolu.
Et le jour reprend pour eux tous et nous, comme une
veine
Se regonfle de sang,—cime des arbres
Crevassée par l’éclair, fleuves, châteaux
En paix de l’autre rive.
Oui, une terre
Sur ses colonnes torses de nuée
Et qu’importe si l’homme, le ciel tournant.
Vacille une seconde fois, dit à la femme
A demi emportée déjà, nuage noir.
Quelques mots que l’on n’entend pas puis se détourne.
S’éloigne à ses côtés qui se dissipent
Et se penche vers elle
Et cache son visage en pleurs dans ses mains pures
Puisque vers l’Occident, encore clair,
Un navire à fond plat, dont la proue figure
Un feu, une fumée, est apparu.
Livre rouvert, nuage rouge, au faîte
De la houle qui s’enfle.
Il vient.
Il vire, lentement, on ne voit pas
Ses ponts, ses mâts, on n’entend pas les cris
De l’équipage, on ne devine pas
Les chimères, les espérances de ceux qui
Là-haut se pressent à l’avant, les veux immenses,
Ni quel autre horizon ils aperçoivent.
Quelle rive peut-être, on ne sait non plus
De quelle ville incendiée ils ont dû fuir.
De quelle
Troie inachevable ; mais on sent
Battre dans ce bras nu toute l’ardeur
De l’été, notre angoisse...
Aie foi, le sens
Peut croître dans tes mots, terre sauvée,
Comme la transparence dans la grappe
De l’été, celui qui vieillit.
Parles-tu, chantes-tu, enfant,
Et je rêve aussitôt que toute la treille
Terrestre s’illumine ; et que ce poids
Des étoiles serrées à du froid, des pierres
Denses comme des langues non révélées,
Et des cimes que prend notre nuit encore,
Des cris de désespoir mais des cris de joie,
Des vies qui se séparent dans l’énigme.
Des erreurs, des effondrements, des solitudes
Mais des aubes aussi, des pressentiments,
Des eaux qui se dénouent au loin, des retrouvailles.
Des enfants qui jouent clair à des proues qui passent,
Des feux dans les maisons ouvertes, des appels
Le soir, de porte en porte dans la paix,
Oui, que ce vrai, ce lieu déjà, presque le bien,
Mûrit, que ce n’était que la grappe verte.
Tout n’est-il pas si cohérent, si prêt
Bien que. certes, scellé ?
Le soleil de l’aube
Et le soleil du soir, l’illuminé,
Mènent bien, bœufs aveugles, la charrue
De l’or universel inachevé.
Et sonne sur leur front cette chaîne d’astres
Indifférents, c’est vrai : mais eux avancent
Comme une eau s’évapore, un sel dépose
Et n’est-ce toi là-bas, mère dont les yeux brillent,
Terre, qui les conduis,
La robe rouge déchirée, non, entrouverte
Sous l’arche de l’étoile première née ?
Mais toujours et distinctement je vois aussi
La tache noire dans l’image, j’entends le cri
Qui perce la musique, je sais en moi
La misère du sens.
Non, ce n’est pas
Aux transfigurations que peut prétendre
Notre lieu, en son mal.
Je dis l’espoir,
Sa joie, son feu même de grappe immense, quand
L’éclair de chaque nuit frappe à la vitre, quand
Les choses se rassemblent dans l’éclair
Comme au lieu d’origine, et les chemins
Luiraient dans les jardins de l’éclair, la beauté
Y porterait ses pas errants...
Je dis le rêve,
Mais ce n’est que pour le repos de mots blessés.
Et je sais même dire ; et je suis tenté
De vous dire parfois, signes fiévreux.
Criants, les salles peintes,
Les cours intérieures ombragées,
La suffisance de l’été sur les dalles fraîches,
Le murmure de l’eau comme absente, le sein
Qui est semblable à l’eau, une, infinie,
Gonflée d’argile rouge.
De vous donner
L’anneau des ciels de palmes, mais aussi
Celui, lourd, de cette cheville, qu’une main
De tiédeur et d’indifférence fait glisser
Contre l’arc du pied maigre, cependant
Que la bouche entrouverte ne cherche que
La mémoire d’une autre. «
Regarde-moi,
Dirait la voix néante à travers la mienne,
Je mens, à l’infini, mais je satisfais,
Je ne suis pas mais je ferme les yeux,
Je courbe si tu veux ma nuque noire
Et je chante, veux-tu, esprit lassé.
Ou je feins de dormir »...
Au crépuscule
La guêpe se couronne de lumière,
Elle règne absolue dans son instant
D’ascension tâtonnante sur la grappe.
Non, nous ne sommes pas guéris du jardin,
De même que ne cesse pas, gonflé d’une eau
Noire, l’épanchement du rêve quand les yeux
s’ouvrent.
Encore nous chargerons, à contre-jour
Dans l’afflux d’en dessous, étincelant,
Notre barque à fond plat de fruits, de fleurs
Comme d’un feu, rouge, dont la fumée
Dissipera de ses acres images
Les heures et les rives.
Et que d’espoirs
Enfantins, sous les branches !
Quelle avancée
Dans les mots consentants !
Bien que la nuit
Nous frôle même là d’une aile insue
Et trempe même là son bec, dans l’eau rapide.
« Je voulais l’enrichir de n’être qu’une image
Pour que lui n’en soit qu’une, et que le feu
Du temps, s’il prend aux corps, aux cris, aux rêves
même.
Laisse intacte la forme où nous nous retrouvions,
Aussi je me faisais sa réserve d’eau pure,
J’illimitais ses yeux qui se penchaient sur moi.
Ma bouche aimait sa bouche aux hâtives conliances,
C’était ma joie d’attendre et de lui faire don.
Il dort.
Je suis l’étoffe de la porte
Que l’on a trempée d’eau pour changer de ciel.
J’ourle l’après-midi d’outre-marine.
Je suis le jeu des quelques ombres sur son corps.
Il vieillit.
Même en nous l’heure a grossi et roule
Son bruit de nuit qui vient dans les pierres.
Parfois
Il laisse aller son bras dans cette eau plus froide.
Je ne sais si en rêve et ne me sachant pas... »
Es-tu venu pour ce livre fermé.
Je ne consens pas que tu l’ouvres.
Es-tu venu pour en briser le sceau
Brûlant, troué de nuit, courbé, feuillage
Sous l’orage qui rôde et n’éclate pas.
Je ne te permets pas d’en toucher la cire.
Es-tu venu « ne serait-ce que pour »
Entrevoir, comme en songe, une parole
Croître transfigurée dans l’aube du sens (Et je sais bien qu’un soc a travaillé
Longtemps à cet espoir et, retombé
Dans la phrase terrestre, brille là
Déchiré au rebord de ma lumière).
Je reste silencieux dans ta voix qui rêve...
Es-tu venu pour dévaster l’écrit (Tout écrit, tout espoir), pour retrouver
La surface introublée que double l’étoile
Et boire à l’eau qui passe et te baigner
Sous la voûte où mûrit le fruit non le sens
Je ne t’ai pas permis d’oublier le livre. »
O rêves, beaux enfants
Dans la lumière
Des robes déchirées.
Des épaules peintes.
«
Puisque rien n’a de sens,
Souffle la voix.
Autant peindre nos corps
De nuées rouges.
Vois, j’éclaire ce sein
D’un peu d’argile
Et délivre la joie, qui est le rien,
D’être la faute. »
Us marchent, les pieds nus
Dans leur absence.
Et atteignent les rives
Du fleuve terre.
Ils demandent, ils donnent,
Les yeux fermés,
Les chevilles rougies
Par la boue d’images.
Rien n’aura précédé, rien ne finit,
Ils partagent, une eau.
S’étendent, le liane nu
Reflète l’étoile.
Ils passent, prenant part
A l’eau étincelante,
A toi, pierre jetée,
A des mondes là-bas, qui s’élargissent.
Et à leurs pas se joint
Flore la pure
Qui jette ses pavots
A qui demande.
Et beauté pastorale
Nue, pour ouvrir
A des bêtes mouillées, au froid du jour.
L’enclos du simple
Mais aussi beauté grise
Des fumées
Qui se tord et défait
Au moindre souffle
Tu te penches, tu prends
Un peu de la divinité d’une herbe sèche
Et dans la profusion de l’odeur froissée
Cesse l’attente de la vie au cri de faim.
Des lèvres qui demandent d’autres lèvres.
De l’eau qui veut la pente dans les pierres,
De l’élan de l’agneau, fait de joie pure,
De l’enfant qui joue sans limite sur le seuil
Tu accomplis le vœu puisque tu accueilles
La terre, qui excède le désir.
Tu te penches...
Le myrte, puis pleurer.
Mon amie, ce n’est là que l’été qui vibre
Comme fait un volet que le vent assaille
Sur son gond d’espérance déchirée.
Mais que ce jour est clair !
Notre révolte
Est bue par la porosité de la lumière,
Et l’assombrissement de l’aile du ciel.
Son cri. le vent qui recommence, tout cela
Dit la vie enfin prête à soi et non la mort.
Vois, il aura sufTî de faire confiance,
L’enlant a pris la main du temps vieilli,
La main de l’eau, la main des fruits dans le feuillage,
Il les guide muets dans le mystère.
Et nous qui regardons de loin, tout nous soit simple
De croiser son regard qui ne cille pas.
Désir se fit
Amour par ses voies nocturnes
Dans le chagrin des siècles ; et par beauté
Comprise, par limite acceptée, par mémoire
Amour, le temps, porte l’enfant, qui est le signe.
Et en nous et de nous, qui demeurons
Si obscurs l’un à l’autre, ce qui est
La faute mais fatale, la parole Étant inachevée comme l’être encor,
Que sa joie prenne forme : pour retenir
L’eau dans sa coupe fugitive : pour refléter
Le tèu, qui est le rien ; pour faire don
D’au moins l’idée du sens—à la lumière.
Nuages,
El un. le plus au loin, oui, à jamais
Rouge, l’eau et le feu
Dans le vase de terre, la fumée
En tourbillons au point de braise pure
Où va bondir la llanime...
Mais ici
Le sol, connue le ciel.
Est parsemé à l’infini de pierres
Dont quelques-unes, rouges.
Portent des traits que nous rêvons des signes.
Et nous les dégageons des mousses, des ronces.
Nous les prenons, nous les soulevons.
Regarde !
Ici. c’est un tracé, de l’écriture.
Ici vibra le cri sur le gond du sens.
Ici...
Mais non, cela ne parle pas, l’entaille
Dévie, au laite
Aussi de braise pure, dans l’esprit,
Où la répétition, la symétrie
Auraient redit l’espoir d’une main œuvrante.
Le silence
Comme un pont éboulé au-dessus de nous
Dans le soir.
Nous ramassons pourtant,
Mon amie
Tant et plus de ces pierres, quand la nuit
Tachant l’étoffe rouge, trouant nos voix.
Les dérobe déjà à nos mains anxieuses
Et nuées que nous sommes, leur feu nous guide
Quand nous rentrons, chargés,
A la maison, « là-bas ».
Quand nous passons
Déserts
Dans la vitre embrasée de ce pays
Qui ressemble au langage : illuminé
Au loin, pierreux ici.
Quand nous allons
Plus loin même, nous divisant, nous déchirant.
L’enfant courant devant nous dans sa joie
A sa vie inconnue,
Simples.—non, clairs.
En paix.
Immobiles parfois à des carrefours.
Entre les colonnes des feux de l’été qui va prendre fin.
Dans l’odeur de l’étoile et de la cendre.
Tout cela », oui,
Nos leurres, nos joies.
Nos regrets à jamais.
Non, nos consentements, nos certitudes,
Tout cela, c’est l’été,
L’incohérent
Qui assaille nos yeux
De son eau brusque.
Et dehors c’est la nuit,
Non, c’est le jour
Qui proclame, glaireux.
Une naissance.
L’été .
Cette chevêche que cloue
Là. sur le seuil.
Le fer en paix de l’étoile.