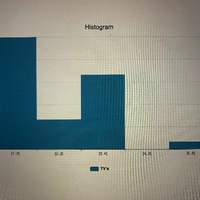Mercedes de Velilla y Rodríguez fue una ensayista, dramaturga, pero sobre todo poetisa y una de las escritoras más representativas del movimiento literario de Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX. Nació en Sevilla el 24 de septiembre de 1852 en el seno de una familia con gran vocación literaria. De hecho, casi todos los miembros de su familia escribían, especialmente poesía, como su madre María Dolores Rodríguez, su hermana Felisa pero y sobre todo su hermano José de Velilla, uno de los dramaturgos más fecundos de la segunda mitad del siglo XIX sevillano.

Cecilia Vicuña Ramírez (Santiago de Chile, 1948) es una artista visual, poeta, cineasta y activista chilena. Es considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas de la poesía contemporánea y una potencia artística que encarna la exploración creativa y la resistencia política. La práctica artística y poética que Cecilia Vicuña llama “lo precario”, creada a mediados de la década de 1960 en Chile, incluye la escritura, el performance y el arte. Su obra ha sido calificada como anticipadora de grandes movimientos poéticos, artísticos y académicos, desde el arte conceptual y el performance de poesía, hasta el land art y discursos de la segunda ola de feminismo, que empezarían a florecer en las décadas 70 y 80 del siglo XX.

La compañera por Eugenio Florit A Cintio Vitier A veces se la encuentra en mitad del camino de la vida y ya todo está bien. No importa nada. No importa el ruido, ni la ciudad, ni la máquina. No te importa. La llevas de la mano, compañera tan fiel como la muerte, y así va con el tren como el paisaje, en el aire de abril como la primavera, como la mar junto a los pinos, junto a la loma como está la palma, o el chopo junto al río, o aquellos arrayanes junto al agua. No importa. Como todo lo que une y completa. Junto a la sed el agua, y al dolor el olvido. El fuego con la fragua, la flor y la hoja verde, y el mar azul y la espuma blanca. La niña pequeñita con el brazo de amor que la llevaba, y el ciego con su perro lazarillo, y el Tormes junto a Salamanca. Lo uno con lo otro tan cerrado que se completa la mitad que falta. Y el cielo con la tierra. Y el cuerpo con el alma. Y tú, por fin, para decirlo pronto, mi soledad, en Dios transfigurada. Cintio Vitier (Cayo Hueso, Florida, Estados Unidos, 25 de septiembre de 1921 - La Habana, Cuba, 1 de octubre de 2009 ) fue un destacado poeta, narrador, ensayista y crítico cubano. Vinculado en sus inicios al grupo de la revista Orígenes, junto con otros nombres destacados de la literatura cubana, tales como José Lezama Lima, Eliseo Diego o Fina García Marruz, su obra dio un giro hacia el compromiso político y social a partir de los años 60, en parte debido a la influencia del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Fue hijo del educador Medardo Vitier Guanche. Hizo sus primeros estudios en el colegio "Froebel", fundado por su padre en la localidad cubana de Matanzas. En 1935 se trasladó con su familia a La Habana, donde prosiguió sus estudios en el colegio "La Luz", en el que tuvo como condiscípulo al futuro poeta Eliseo Diego. Más tarde cursó estudios superiores en la Universidad de La Habana, época durante la cual editó la revista Clavileño (1942-1943). Se doctoró en Derecho Civil en 1947, aunque nunca ejerció como abogado. Durante sus años universitarios, Vitier hizo amistad con José Lezama Lima y Fina García Marruz, con la que contraería matrimonio en 1947. Fue miembro de la redacción de la revista Orígenes, dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, y una de las más importantes revistas de la historia literaria cubana. Ha colaborado también en otras muchas revistas literarias cubanas, como Espuela de Plata, Poeta, Lunes de Revolución, Casa de las Américas, Unión, etc. Trabajó, entre 1947 y 1961, como profesor de francés en la Escuela Normal para Maestros de La Habana. Más tarde fue también docente de literatura cubana e hispanoamericana en la Universidad Central de Las Villas. Dirigió varias revistas, entre ellas, la Nueva Revista Cubana, la Revista de la Biblioteca Nacional "José Martí" y el Anuario Martiano. Recibió numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura en 1988, el Premio Juan Rulfo, en el año 2002, el título de Oficial de Artes y Letras de Francia, y la medalla de la Academia de Ciencias de Cuba. Presidió el Centro de Estudios Martianos. Recibió doctorados honoris causa por parte de la Universidad de La Habana, la Universidad Central de Las Villas y la Universidad Soka de Japón. Poesía * Poemas (1937-1938) (1938) * Sedienta cita (1943) * Experiencia de la poesía (1944) * De mi provincia (1945) * Extrañeza de estar (1945) * Capricho y homenaje (1947) * El hogar y el olvido: 1946-1949 (1949) * Sustancia (1950) * Conjeturas (1951) * Vísperas 1938-1953 (1953) * Canto llano (1954-1955) (1956) * Escrito y cantado (1954-1959) (1959 * Testimonios (1966) * Vísperas * La fecha al pie * Nupcias * Un extraño honor Novelas * De peña pobre * Los papeles de Jacinto Finalé * Rajando la leña está Ensayos * Lo cubano en la poesía (1958) * Poética (1961) * Crítica sucesiva (1971) * Ese sol del mundo moral (1975) Antologías de poesía cubana * Diez poetas cubanos 1937-1947 * Cincuenta años de poesía cubana. 1902-1952 * Las mejores poesías cubanas * Los grandes románticos cubanos * Los poetas románticos cubanos Referencias Wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/Cintio_Vitier

Poema para Antonio Vega de Joaquín Lera Delgado como un papel de fumar Se le ve pasar por las calles del viejo Madrid ¿No lo véis? Sigue allí. En el sitio de su recreo. Entonando canciones inmortales. Hay flores que nunca se marchitan Y Antonios que habitan en los tejados Ajenos al bullicio y los embistes del ocaso Convirtiendo las cenizas en poemas Las palabras en regalos. Bajo lluvia de guitarras que lloran ausencias que nunca partieron. Simplemente se fueron de viaje a la isla de los sueños Invitados por John Lennon. ¿No lo véis? ¿Quién está muerto? Antonio Vega Tallés (Madrid, 16 de diciembre de 1957 - Majadahonda, Madrid, 12 de mayo de 2009 ) fue un autor, escritor, compositor y cantante español. En 1978 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop, originado en otra banda, Uhu Helicopter, de la que provenían ambos. Su disco de presentación se editó en 1980, separándose el grupo en 1988 tras una exitosa carrera con seis álbumes de estudio y uno en directo. Vega comenzó entonces su carrera como solista, en la que editaría cinco discos de estudio, un álbum en directo y un recopilatorio de colaboraciones con otros artistas. Antonio Vega ha sido considerado uno de los compositores fundamentales del pop español desde la llegada de la democracia. El intimismo de sus canciones y su sensibilidad le ganaron la admiración de crítica y público. Nacha Pop Nacha Pop, uno de los grupos más representativos del pop español de los años 80, tenía dos compositores: el propio Antonio y su primo Nacho García Vega. Vega pudo desarrollar su talento artístico en la formación, respaldada por un amplio éxito en esa época, viendo la luz durante esa etapa numerosos temas de su autoría que terminarían entrando en el cancionero popular español, entre ellos Chica de ayer, considerada generalmente como una de las mejores canciones del pop peninsular e incluida en su primer LP. Éste, de título homónimo al grupo, es considerado por revistas como Rockdelux o la edición en castellano de Rolling Stone una obra maestra imprescindible en la música española. Con el tiempo, Chica de ayer se convirtió en una de las canciones más representativas de la movida madrileña, el movimiento contracultural surgido durante los 80 fundamentalmente en la ciudad natal del autor. Ha sido versionada por multitud de artistas, como El Canto del Loco, Eduardo Capetillo, Enrique Iglesias, Undershakers o los estadounidenses Gigolo Aunts (The girl from yesterday). El segundo LP de la banda, Buena disposición, mantuvo la misma línea musical, siendo uno de sus temas más conocido Atrás, después reinterpretado en los conciertos de su carrera en solitario. Más números, otras letras fue el tercer LP de la banda, coincidiendo con el comienzo de la época en que ésta trabajó bajo el sello DRO, con el que editó el mini-LP Una décima de segundo, siendo el tema más conocido el que le daba nombre. El sonido conseguido por el productor Peter McNamee le dio nuevas cotas de excelencia al grupo, incluso en la improvisada versión piano bar de Una décima de segundo, que contó con la colaboración de Teo Cardalda. En 1985 llegaría Dibujos animados (que incluía temas como Cada uno su razón o Relojes en la oscuridad), y tras él El momento, una obra que fue ganando adeptos con el tiempo, con temas como Lucha de gigantes. La banda terminaría por separarse en 1988, tras una serie de conciertos en Madrid que darían lugar a su disco de despedida, Nacha Pop 80-88, que repasaría su discografía de estudio y que sería el epitafio del grupo. Se ha señalado que, como compositor en Nacha Pop, Antonio Vega desarrolló su especial sensibilidad para hacer partícipe al oyente de una historia personal con una delicada visión poética del mundo. Este carácter intimista ofrecía en el trabajo del grupo un contrapunto a la música del otro compositor de la banda, Nacho García Vega, que se inclinaba hacia un pop más directo y unas letras menos metafóricas. En 2007 la banda se vuelve a reunir para ofrecer una serie de conciertos por España entre junio y octubre de ese año, colaborando asimismo en la grabación del filme en DVD La edad de oro del pop español. Carrera en solitario La carrera en solitario de Antonio Vega comenzaría marcada por su etapa anterior, de la que saldría como un músico consagrado y muy respetado por sus compañeros de profesión. Así pues, el músico mantendría la misma línea de creación durante su etapa de solista, aunque acentuando en algún sentido su vocación más intimista, quizá por la ausencia de la influencia musical de García Vega. Su primer disco en solitario data de 1991 y llevó por título No me iré mañana. En él se mezclan temas más poperos, como Esperando nada (que más tarde versionaría la cantante chilena Nicole y que daría lugar a un álbum homónimo, el segundo de la cantante desde 1989), Háblame a los ojos o Lo mejor de nuestra vida, con temas más próximos a un estilo de la denominada canción de autor, como Tesoros o Se dejaba llevar por ti, canción de la cual el propio músico reconocería que hacía alusión a su adicción a la heroína. En 1992 se publicó un recopilatorio que mezclaba algunas de sus mejores canciones de la época de Nacha Pop con temas de su primer disco como solista. Se incluía asimismo una versión de la canción Ansiedad, de Chelique Sarabia, y una maqueta de otro de sus temas más conocidos, El sitio de mi recreo, que también daba nombre al disco. Su siguiente trabajo, Océano de sol, vería la luz en 1994, cuando Vega se desplazaría hasta Inglaterra para trabajar con Phil Manzanera, ex guitarrista de Roxy Music y productor musical que se ocuparía de la producción del disco. Sin embargo, Vega no quedó satisfecho con el trabajo de Manzanera, atribuyendo a éste falta de profesionalidad, así como diferencias en la concepción del trabajo. Del disco destacan temas como Vapor, Palabras o una segunda versión más trabajada de El sitio de mi recreo. Al año siguiente colabora en el primer disco tributo a Joan Manuel Serrat, que llevaría por nombre Serrat, eres único (1995), con el Romance de Curro el Palmo. También partició en 1997 en el Tributo a Queen, con el tema Días que no volverán, versión en español de la canción These are the days of our lives publicada por la banda británica en su álbum Innuendo, de 1991. Mientras se grababa este álbum, el vocalista de Queen Freddie Mercury vivía sus últimos meses de vida antes de fallecer de sida el 24 de noviembre de 1991. Tras un silencio de cuatro años se publica el disco Anatomía de una ola, más acústico y tranquilo que los anteriores. En él se recogen temas como Ángel caído, dedicada a Vincent Van Gogh o Como la lluvia al sol. En este disco se hallaba también una versión de Agua de río, del grupo Sonora, compuesto entre otros por varios amigos de Vega, Basilio Martí y Nacho Béjar, muy influenciados por aquel en su único LP, Arquitectura de la soledad. Con la muerte en 1999 del líder de Los Secretos Enrique Urquijo la banda publica un disco homenaje con el título A tu lado, y en el cual Vega interpretó la canción Agárrate a mí, María. Tras una etapa con la discográfica Polydor se produce su fichaje por EMI, que edita en 2001 De un lugar perdido, un disco corto en el que destacan temas como Estaciones, Para bien y para mal o A trabajos forzados, poema de Antonio Gala al cual pone música. Ese año también colabora con Jarabe de Palo en el tema Completo, incompleto, dentro del disco De vuelta y vuelta. En 2002 publica su particular Básico, basado en un concierto acústico ofrecido el 5 de julio de 2001 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que incluye tanto versiones de su repertorio clásico como algún tema inédito. A finales de 2003 participa como solista en el tributo a la banda española Hombres G, interpretando la canción La carretera. Esta versión fue una de las incluidas en Escapadas, disco que salió al mercado en 2004 y en el cual contaba con colaboraciones de otros artistas como Amaral, con los que canta Cómo hablar; Pau Donés, con quien cantaba a dueto Completo, incompleto, o Elefantes, con los que realiza una versión de Que yo no lo sabía. También en ese mismo año participa en el homenaje colectivo al poeta Pablo Neruda en su centenario, que llevaba el título de Neruda en el corazón. La muerte de su compañera sentimental Margarita del Río, coautora de algunos de sus temas, supone un duro golpe para Vega, que sufrió seguidamente una neumonía que le tuvo hospitalizado. e incluso le llevó a atravesar un período de depresión. Posteriormente compondría su último disco en solitario, 3000 noches con Marga, editado en 2005, en el que se incluyen temas como Angel de Orión, Caminos infinitos, Pasa el otoño o la instrumental 3000 noches con Marga. En 2007 Antonio se reúne con Nacho García Vega y deciden volver al escenario como Nacha Pop en una gira por España, además de su aparición en el DVD Historia sinfónica del pop español junto a Germán Coppini, Javier Andreu, José María Granados y otras leyendas del pop español.8 También colaboraría en el tema Ahora qué de Conchita, incluido en su álbum de debut, Nada más. En marzo del mismo año graba a dúo con Miguel Bosé una versión de El sitio de mi recreo que el cantante incluiría en el disco conmemorativo Papito. El proyecto valenciano Escoles de Nicaragua, que tenía como objetivo recaudar fondos con destino a la construcción de infraestructura educativa en el país sudamericano, le lleva a participar en Un sueño compartido, disco que el grupo Un Mar al Sur realizó para este fin. Tras acabar la gira con Nacha Pop vuelve a su carrera en solitario y continúa dando conciertos, orientando en los últimos tiempos su gira a los escenarios teatrales con el respaldo de una banda en la que estaba Basilio Martí, que también era su representante musical. Esta serie de conciertos estaba pensada para dar lugar a un nuevo disco en directo. En marzo de 2009 presentó, en el que sería a la postre su último concierto, una de sus últimas composiciones: Antes de haber nacido.1 Su último concierto tuvo lugar el 28 de marzo de 2009 en el Kafe Antzokia de Bilbao. Fallecimiento El 20 de abril de 2009 fue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid debido a una neumonía aguda que le obligó a suspender su gira.9 Falleció el 12 de mayo siguiente, a los 51 años de edad, a consecuencia de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses antes. Tras su muerte A finales de 2009 se anunció el proyecto de llevar la vida de Antonio a la televisión: el proyecto contaría con el asesoramiento de Carlos Vega (hermano del cantante), y constaría de varias entregas. En noviembre del mismo año sale a la venta el libro Mis cuatro estaciones, realizado por Juan Bosco, que constaba de una biografía con material inédito que detalla la vida de Antonio Vega, conteniendo asimismo una extensa entrevista. El libro se divide en las cuatro estaciones del año. En 2010, Universal Music sacó a la luz un recopilatorio tributo a su obra con el título de El alpinista de los sueños, contando con la participación de artistas como Love of Lesbian, Zahara, Enrique Bunbury, Bebe, Shinoflow, etc. Discografía Álbumes de estudio, en solitario * 1991: No me iré mañana * 1992: El sitio de mi recreo * 1994: Océano de sol * 1998: Anatomía de una ola * 2001: De un lugar perdido * 2005: 3000 noches con Marga Álbumes en directo, en solitario * 2002: Básico (concierto acústico en el Círculo de Bellas Artes de Madrid) Recopilatorios * 1992: El sitio de mi recreo (recopilatorio de sus mejores baladas) * 2004: Autorretratos (recopilatorio) * 2004: Escapadas (disco de colaboraciones). * 2009: Canciones 1980-2009 (recopilatorio póstumo). Álbumes de estudio, con Nacha Pop * 1980: Nacha Pop * 1982: Buena disposición * 1983: Más números, otras letras * 1984: Una décima de segundo * 1985: Dibujos animados * 1987: El momento Álbumes en directo, con Nacha Pop * 1988: Nacha Pop 1980-1988 * 2008: Tour 80-08 Reiniciando Con Un Mar al Sur * 2008: Un sueño compartido References Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vega


Enrique José Varona (Camagüey, 13 de abril de 1849 – La Habana, 19 de noviembre de 1933) fue un escritor, filósofo, pensador, pedagogo, militar y político cubano que participó en la Guerra de los Diez Años y muchos años después fue vicepresidente de Cuba. Cursó su primera enseñanza en su provincia natal y poco después en La Habana. En 1868 al estallar la Guerra de los Diez Años se incorpora al campo de batalla, al finalizar ésta en 1878 con el Pacto del Zanjón, se une al movimiento autonómico y reinicia sus actividades literarias las que se vuelven más intensas. Dicta y publica en La Habana sus célebres «Conferencias Filosóficas sobre Lógica, Psicología y Moral». Más tarde ante el fracaso de su gestión como diputado a las Cortes de España representando a Cuba, rompe con el autonomismo. A solicitud de José Martí en 1895, asume en Nueva York la redacción del periódico Patria, órgano oficial del independentista Partido Revolucionario Cubano (PRC), y en 1896 pronuncia la conferencia titulada «El Fracaso Colonial de España». Durante la ocupación norteamericana desempeña el cargo de secretario de Hacienda y posteriormente el de Instrucción Pública y Bellas Artes, implantando la modernización de la enseñanza mediante el Plan Varona.

Basically I grew up sheltered, had a rocky marriage, have 3 beautiful daughters that I'm very proud of. I am currently seeing someone and I hope it lasts. My work on this site is just when my emotions and/or thoughts get too big for my head and heart. I've never been one to conform to rhyming or even a set standard for poetry. I long for Freedom in every aspect of my life.
.jpeg)
Xavier Villaurrutia y González (Ciudad de México, 27 de marzo de 1903 - 31 de diciembre de 1950) Escritor mexicano. Alumno del Colegio Francés y de la Escuela Nacional Preparatoria, abandonó muy pronto los estudios de jurisprudencia para consagrarse por entero a la literatura. Junto con otros intelectuales mexicanos, como el poeta y dramaturgo Salvador Novo, fundó las revistas Ulises (1927), cuyo nombre es un homenaje de admiración al escritor irlandés James Joyce, y Contemporáneos (1928), que marcó un hito fundamental en el panorama de la literatura mexicana al aglutinar a un grupo de magníficos poetas comprometidos en una tarea de depuración lingüística y de apertura y renovación del quehacer poético. En este marco se inscriben los versos de sus Nocturnos, publicados en 1933 en el poemario Nostalgia de la muerte, que recurren a la ensoñación, a un mundo onírico en el que el autor da libre curso a sus interrogaciones existenciales, un universo móvil y cambiante, cuya ambigüedad es puesta de relieve, y magníficamente, por un juego de palabras, caro al estilo del poeta cuando utiliza el doble valor del vocablo como sustantivo y como forma verbal. En su visión de la muerte se percibe el concepto calderoniano de "la vida es sueño", concibiendo el tránsito final como un despertar. El tema de la muerte, tan propio de toda la literatura castellana, cantado con severo ascetismo temeroso por Jorge Manrique, adquiere en Villaurrutia una expresión inusitada, con frecuentes imágenes de cuerpos vacíos y de sombras humanas, de genios que sueñan que son hombres. Su poesía otorga una indiscutible importancia, una sugerente función inspiradora, al principio del error freudiano y a la técnica, utilizada ya por los surrealistas, de la inconsciente asociación de ideas potenciada por un mismo fonema, que alude a planos muy distintos de la experiencia. La palabra adquiere así un carácter casi fantasmagórico, que actúa como un espejo donde el poeta se ve siempre devuelto a sí mismo en un insatisfactorio vaivén lleno de ansiedad, revelador de una carencia que es la propia esencia del vivir y que sólo puede concluir con la muerte. Su breve obra poética, que los estudiosos consideran la parte más perdurable de su labor, se completa con Décima muerte y otros poemas, donde Villaurrutia contempla desesperanzado la nada que le acecha, y Cantos a la primavera y otros poemas, publicados póstumamente, en los que parece brillar cierta esperanza de trascendencia, una salida humana a la soledad y la muerte. Pero no debe olvidarse el relevante papel desempeñado por el autor en la renovación de la escena mexicana. En 1935 y 1936, becado por la Fundación Rockefeller, estudió arte dramático en la Universidad de Yale y, ya en su madurez, el poeta se inclinó cada vez más por el teatro, aunque sus obras dramáticas son menos experimentales de lo que podría suponerse considerando su producción poética y el interés que Villaurrutia y sus compañeros de aventuras literarias sentían por las experiencias europeas contemporáneas. Algunos estudiosos han mencionado el parecido de sus obras dramáticas con las de Eugene O'Neill; se le ha reprochado que atiendan más a lo literario que a lo dramático, con muy pocos elementos coloquiales en el diálogo y unas líneas didascálicas muy próximas al terreno narrativo. Incidiendo en el drama psicológico, utilizando temas que giran en torno a las relaciones familiares, opta a menudo por situaciones extraídas de los mitos clásicos griegos, trasladándolos a ambientes contemporáneos. Así, en La hiedra hace una incursión en el tema de Fedra cuando Hipólito, que odia a su madrastra Teresa hasta el punto de verse obligado a alejarse de la familia, regresa convertido en un hombre y no la contempla ya como madrastra sino como una mujer deseable, a la que puede amar. Su producción dramática está siempre teñida por un lirismo que confirma sus inquietudes poéticas, dando a sus fábulas una particular carga psicológica que sobresale en su Yerro candente, de 1944, o en una Tragedia de las equivocaciones que Villaurrutia no pudo ver representada, pues se estrenó después de su muerte. Destacó también su actividad como fundador de empresas teatrales, como el Teatro de Ulises y Orientación que, por su caracter experimental, tuvieron una indiscutible importancia en el desarrollo del teatro vanguardista mexicano y lo llevaron, posteriormente, a dirigir la sección teatral del Departamento de Bellas Artes. Hombre de amplios intereses culturales, Xavier Villaurrutia cultivó también el ensayo (Textos y pre-textos, 1949), el guión cinematográfico (La mujer de todos, 1946), la novela (Dama de corazones, 1928) y tradujo a numerosos autores, como André Gide, William Blake o Anton P. Chéjov. Referencias Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villaurrutia.htm


Celia Viñas Olivella (Cèlia Vinyes i Olivella) (Lérida, 16 de junio de 1915 - Almería, 21 de junio de 1954), autora española que escribió poesía infantil en español y catalán, con una obra breve pero considerada renovadora y clave en el panorama de la posguerra. Su infancia y juventud transcurren en Palma de Mallorca y en Barcelona, donde comenzó sus estudios de Filosofía y Letras, los cuales se vieron interrumpidos por la Guerra Civil, y que terminó en 1941. Entre sus profesores universitarios cabe destacar a Rafael Lapesa, a Ángel Balbuena Prat y a Guillermo Díaz Plaja, que en 1976 se encargó de realizar una antología de la producción poética de la que había sido su alumna para la colección Adonais.
Am a Ugandan born, based in the capital Kampala. I am a professional community developer and an inclusive development expert. I love reading, watching and spending time with friends. I have deep love and passion for writing poetry, short stories and religious and political articles. its all about my heart on a paper.


François-Marie Arouet, dit Voltairebre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778 (à 83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières, anglomane, féru d’arts et de sciences, personnage protéiforme et complexe, non dénué de contradictions, Voltaire domine son époque par la durée de sa vie, l’ampleur de sa production littéraire et la variété des combats politiques qu’il a menés. Son influence est décisive sur la bourgeoisie libérale avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle. Anticlérical mais déiste, il dénonce dans son Dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de son époque. Sur le plan politique, il est en faveur d’une monarchie modérée et libérale, éclairée par les « philosophes ». Mettant sa notoriété au service des victimes de l’intolérance religieuse ou de l’arbitraire, il prend position dans des affaires qu’il a rendues célèbres: Jean Calas, Pierre-Paul Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally. Son œuvre littéraire est riche et variée: son importante production théâtrale, ses longs poèmes épiques, telle La Henriade, et ses œuvres historiques firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au XVIIIe siècle. Son œuvre comprend aussi des contes, notamment Candide ou l’Optimisme, des Lettres philosophiques, le Dictionnaire philosophique et une correspondance monumentale dont nous connaissons plus de 15 000 lettres sur un total parfois estimé à 40 000. Titulaire d’une charge officielle d’historiographe du roi, il a publié Le siècle de Louis XIV, puis Le Siècle de Louis XV, ouvrages considérés comme les premiers essais historiques modernes. Il a traduit librement La Science nouvelle de Jean-Baptiste Vico en lui donnant pour titre l’expression inédite de Philosophie de l’histoire, ce qui fait de lui le précurseur du déterminisme historique au XIXe siècle, puis de l’histoire culturelle au XXe siècle. Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir, qui l’embastille et le contraint à l’exil en Angleterre ou loin de Paris. En 1749, après la mort d’Émilie du Châtelet, avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse pendant quinze ans, il part pour la cour de Prusse mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin, il se brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard aux Délices, près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise, à l’abri des puissants. Il ne reviendra à Paris qu’en 1778, ovationné par le peuple après une absence de près de vingt-huit ans. Il y meurt à 83 ans. Voltaire aime le confort, les plaisirs de la table et de la conversation qu’il considère, avec le théâtre, comme l’une des formes les plus abouties de la vie en société. Soucieux de son aisance matérielle, qui garantit sa liberté et son indépendance, il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives qui préfigurent les grandes spéculations boursières sous Louis XVI et dans la vente de ses ouvrages, ce qui lui permet de s’installer en 1759 au château de Ferney et d’y vivre sur un grand pied, tenant table et porte ouvertes. Le pèlerinage à Ferney fait partie en 1770-1775 du périple de formation de l’élite européenne éclairée. Investissant ses capitaux, il fait du village misérable de Ferney une petite ville prospère. Généreux, d’humeur gaie, il est néanmoins chicanier et parfois féroce et mesquin avec ses adversaires comme Jean-Jacques Rousseau ou Crébillon. La Révolution française voit en lui comme en Rousseau un précurseur, si bien qu’il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau. À cette même période, sur l’initiative du marquis de Villette qui l’hébergeait, le « quai des Théatins » où l’écrivain habitait à Paris au moment de sa mort sera baptisé « quai Voltaire ». Célébré par la IIIe République (dès 1870, à Paris, un boulevard et une place portent son nom), il a nourri, au XIXe siècle, les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et, au-delà, de l’esprit des Lumières. Biographie Débuts (1694-1733) Origines: naissance et filiation contestée François-Marie Arouet est né officiellement le 21 novembre 1694 à Paris et a été baptisé le lendemain à l’église de Saint-André-des-Arcs. Il est le deuxième fils de François Arouet (1647-1722), notaire au Châtelet depuis 1675, marié le 7 juin 1683 à Saint-Germain-l’Auxerrois avec Marie-Marguerite Daumart (1661-1701), fille d’un greffier criminel au Parlement qui lui donne cinq enfants (dont trois atteignent l’âge adulte). Le père revend en 1696 sa charge de notaire pour acquérir celle de conseiller du roi, receveur des épices à la Chambre des comptes. Voltaire perd sa mère à l’âge de sept ans. Il a comme frère aîné, Armand Arouet (1685-1765), avocat au Parlement, puis successeur de son père comme receveur des épices, personnalité très engagée dans le jansénisme parisien à l’époque de la Fronde parlementaire et du Diacre Pâris. Sa sœur, Marie Arouet (1686-1726), seule personne de sa famille qui ait inspiré de l’affection à Voltaire, épousera Pierre François Mignot, correcteur à la Chambre des comptes, et elle sera la mère de l’abbé Mignot, qui jouera un rôle à la mort de Voltaire, et de Marie-Louise, la future « Madame Denis », qui partagera une partie de la vie de l’écrivain. Cependant, Voltaire a plusieurs fois affirmé qu’il était né le 20 février 1694 à Châtenay-Malabry, où son père avait une propriété, le château de la Petite Roseraie. Ce fait semble confirmé par la personne devenue propriétaire du château, la comtesse de Boigne ainsi qu’elle l’écrit dans ses mémoires: « La naissance de Voltaire dans cette maison lui donne prétention à quelque célébrité ». Il a contesté aussi sa filiation paternelle, persuadé que son vrai père était un certain Roquebrune,: « Je crois aussi certain que d’Alembert est le fils de Fontenelle, comme il est sûr que je le suis de Roquebrune ». Voltaire prétendit que l’honneur de sa mère consistait à avoir préféré un homme d’esprit comme était Roquebrune, « mousquetaire, officier, auteur et homme d’esprit », à son père, le notaire Arouet dont Roquebrune était le client, car Arouet était, selon Voltaire, un homme très commun. Le baptême à Paris aurait été retardé du fait de la naissance illégitime et du peu d’espoir de survie de l’enfant. Aucune certitude n’existe sinon que l’idée d’une naissance illégitime et d’un lien de sang avec la noblesse d’épée ne déplaisait pas à Voltaire. Du côté paternel, les Arouet sont originaires d’un petit village du nord du Poitou, Saint-Loup-sur-Thouet, près d’Airvault, où ils exercent aux XVe et XVIe siècles une activité marchands tanneurs, ce qui faisait de l’aïeul de Voltaire, Helenus Arouet (1569-1625), un très riche marchand, propriétaire de la seigneurie de Puy-Terrois, acquéreur en 1612 pour 4000 livres tournois « la maison noble terre et seigneurie et métairie de la Routte » à Saint-Loup qu’il revend en 1615. Le premier Arouet à quitter sa province s’installe à Paris en 1625 où il ouvre une boutique de marchand de draps et de soie. Il épouse la fille d’un riche marchand drapier et s’enrichit suffisamment pour acheter en 1675 pour son fils, François, le père de Voltaire, une charge anoblissante de notaire au Châtelet, assurant à son titulaire l’accès à la petite noblesse de robe. Le père de Voltaire, travailleur austère et probe aux relations importantes, arrondit encore la fortune familiale, et épouse le 7 juin 1683 la fille d’un greffier criminel au Parlement. Études chez les Jésuites (1704-1711) À la différence de son frère aîné chez les jansénistes, François-Marie entre à dix ans comme interne (400 puis 500 livres par an) au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites. François-Marie y reste durant sept ans. Les jésuites enseignent le latin et la rhétorique, mais veulent avant tout former des hommes du monde et initient leurs élèves aux arts de société: joutes oratoires, plaidoyers, concours de versification, et théâtre. Un spectacle, le plus souvent en latin et d’où sont par principe exclues les scènes d’amour, et où les rôles de femmes sont joués par des hommes, est donné chaque fin d’année lors la distribution des prix. Arouet est un élève brillant, vite célèbre par sa facilité à versifier: sa toute première publication est son Ode à sainte Geneviève. Imprimée par les Pères, cette ode est répandue hors les murs de Louis-le-Grand (au grand dam ultérieurement de Voltaire adulte). Il apprend au collège Louis-le-Grand à s’adresser d’égal à égal aux fils de puissants personnages, le tout jeune Arouet tisse de précieux liens d’amitié, très utiles toute sa vie: entre bien d’autres, les frères d’Argenson, René-Louis et Marc-Pierre, futurs ministres de Louis XV et le futur duc de Richelieu. Bien que très critique en ce qui concerne la religion en général et les ecclésiastiques en particulier, il garde toute sa vie une grande vénération pour son professeur jésuite Charles Porée. Voltaire écrit en 1746: « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également cher à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimables. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses ; et j’aurais voulu qu’il eût été établi dans Paris, comme dans Athènes, qu’on pût assister à de telles leçons ; je serais revenu souvent les entendre ». Débuts comme homme de lettres et premières provocations (1711-1718) Arouet quitte le collège en 1711 à dix-sept ans et annonce à son père qu’il veut être homme de lettres, et non avocat ou titulaire d’une charge de conseiller au Parlement, investissement pourtant considérable que ce dernier est prêt à faire pour lui. Devant l’opposition paternelle, il s’inscrit à l’école de droit et fréquente la société du Temple, qui réunit dans l’hôtel de Philippe de Vendôme, des membres de la haute noblesse et des poètes (dont Chaulieu), épicuriens lettrés connus pour leur esprit, leur libertinage et leur scepticisme. L’abbé de Châteauneuf, son parrain, qui y avait ses habitudes, l’avait présenté dès 1708. En leur compagnie, il se persuade qu’il est né grand seigneur libertin et n’a rien à voir avec les Arouet et les gens du commun. C’est aussi pour lui une école de poésie ; il va ainsi y apprendre à faire des vers « légers, rapides, piquants, nourris de référence antiques, libres de ton jusqu’à la grivoiserie, plaisantant sans retenue sur la religion et la monarchie ». Son père l’éloigne un moment de ce milieu en l’envoyant à Caen, puis en le confiant au frère de son parrain, le marquis de Châteauneuf, qui vient d’être nommé ambassadeur à La Haye et accepte d’en faire son secrétaire privé. Mais son éloignement ne dure pas. À Noël 1713, il est de retour, chassé de son poste et des Pays-Bas pour cause de relations tapageuses avec une demoiselle. Furieux, son père veut l’envoyer en Amérique mais finit par le placer dans l’étude d’un magistrat parisien. Il est sauvé par un ancien client d’Arouet, lettré et fort riche, M. de Caumartin, marquis de Saint-Ange, qui le convainc de lui confier son fils pour tester le talent poétique du jeune rebelle. Arouet fils passe ainsi des vacances au château de Saint-Ange près de Fontainebleau à lire, à écrire et à écouter les récits de son hôte qui lui serviront pour La Henriade et Le Siècle de Louis XIV. En 1715, alors que débute la Régence, Arouet a 21 ans. Il est si brillant et si amusant que la haute société se dispute sa présence. Il aurait pu devenir l’ami du Régent mais se retrouve dans le camp de ses ennemis. Invité au château de Sceaux, centre d’opposition le plus actif au nouveau pouvoir, où la duchesse du Maine, mariée au duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV, tient une cour brillante, il ne peut s’empêcher de faire des vers injurieux sur les relations amoureuses du Régent et de sa fille, la duchesse de Berry, qui vient d’accoucher clandestinement. Le 4 mai 1716, il est exilé à Tulle. Son père use de son influence auprès de ses anciens clients pour fléchir le Régent qui remplace Tulle par Sully-sur-Loire, où Arouet fils s’installe dans le château du jeune duc de Sully, une connaissance du Temple, qui vit avec son entourage dans une succession de bals, de festins et de spectacles divers. À l’approche de l’hiver, il sollicite la grâce du Régent qui la lui accorde. Le jeune Arouet alors recommence sa vie turbulente à Saint-Ange et à Sceaux, profitant de l’hospitalité des nantis et du confort de leurs châteaux. Mais, pris par l’ambiance, quelques semaines plus tard, il récidive. S’étant lié d’amitié avec un certain Beauregard, en réalité un indicateur de la police chargé de le faire parler, il lui confie être l’auteur de nouveaux ouvrages de vers satiriques contre le Régent et sa fille. Le 16 mai 1717, il est envoyé à la Bastille par lettre de cachet. Arouet a alors 23 ans et il restera embastillé durant onze mois. Premiers succès littéraires et retour à la Bastille (1718-1726) À sa première sortie de la prison de la Bastille, conscient d’avoir jusque-là gaspillé son temps et son talent, il veut donner un nouveau cours à sa vie, et devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature de son époque: la tragédie et la poésie épique. Pour rompre avec son passé, et notamment avec sa famille, afin d’effacer un patronyme aux consonances vulgaires et équivoques, il se crée un nom euphonique: Voltaire. On ne sait pas à partir de quels éléments il a élaboré ce pseudonyme. De nombreuses hypothèses ont été avancées, toutes vraisemblables mais jamais prouvées: inversion des syllabes de la petite ville d’Airvault (proche du village dont est originaire la famille Arouet), anagramme d’Arouet l.j. (le jeune) ou encore référence à un personnage de théâtre nommé Voltare[Lequel ?]. La ville de Volterra en Toscane fut aussi évoquée: organisée en République de Volterra dans la ligue Guelfe, elle fut fière et rebelle et s’opposa à l’autorité des évêques. Il a été dit que Voltaire, en voyage et malade y fut si bien soigné qu’il en fut reconnaissant ; l’hypothèse est belle mais contestée par Chaudon. Le 18 novembre 1718, sa première pièce écrite sous le pseudonyme de Voltaire, Œdipe, obtient un immense succès. Le public, qui voit en lui un nouveau Racine, aime ses vers en forme de maximes et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion. Ses talents de poète mondain triomphent dans les salons et les châteaux. Il devient l’intime des Villars, qui le reçoivent dans leur château de Vaux, et l’amant de Madame de Bernières, épouse du président à mortier du parlement de Rouen. Après l’échec d’une deuxième tragédie, il connaît un nouveau succès en 1723 avec La Henriade, poème épique de 4 300 alexandrins se référant aux modèles classiques (Iliade d’Homère, Énéide de Virgile) dont le sujet est le siège de Paris par Henri IV et qui trace le portrait d’un souverain idéal, ennemi de tous les fanatismes: vendu à 4 000 exemplaires en quelques semaines, ce poème connaîtra soixante éditions successives du vivant de son auteur. Pour ses contemporains admiratifs, Voltaire va être longtemps l’auteur de La Henriade, le « Virgile français », le premier à avoir écrit une épopée nationale, mais celle-ci n’est pas passée à la postérité et a été repoussée dans l’oubli par le romantisme au XIXe siècle. En janvier 1726, il subit une humiliation qui va le marquer toute sa vie. Le chevalier de Guy-Auguste de Rohan-Chabot, jeune gentilhomme arrogant, appartenant à l’une des plus illustres familles du royaume, l’apostrophe à la Comédie-Française: « Monsieur de Voltaire, Monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ? » ; Voltaire réplique alors: « Voltaire! Je commence mon nom et vous finissez le vôtre ». Quelques jours plus tard, on le fait appeler alors qu’il dîne chez son ami le duc de Sully. Dans la rue, il est frappé à coups de gourdin par les laquais du chevalier, qui surveille l’opération de son carrosse. Blessé et humilié, Voltaire veut obtenir réparation, mais aucun de ses amis aristocrates ne prend son parti. Le duc de Sully refuse ainsi de l’accompagner chez le commissaire de police pour appuyer sa plainte. Il n’est pas question d’inquiéter un Rohan pour avoir fait rouer de coups un écrivain: « Nous serions bien malheureux si les poètes n’avaient pas d’épaules », dit un parent de Caumartin. Le prince de Conti écrit sur l’incident que les coups de bâtons « ont été bien reçus mais mal donnés ». Voltaire veut venger son honneur par les armes, mais son ardeur à vouloir se faire justice lui-même indispose tout le monde. Les Rohan obtiennent que l’on procède à l’arrestation de Voltaire, qui est conduit à la Bastille le 17 avril. Il n’est libéré, deux semaines plus tard, qu’à la condition qu’il s’exile. En Angleterre, « terre de Liberté » (1726-1728) Voltaire a 32 ans. Cette expérience va le marquer d’une empreinte indélébile. Il est profondément impressionné par l’esprit de liberté de la société anglaise (ce qui ne l’empêche pas d’apercevoir les ombres du tableau, surtout vers la fin de son séjour). Alors qu’en France règnent les lettres de cachet, la loi d’Habeas corpus de 1679 (nul ne peut demeurer détenu sinon par décision d’un juge) et la Déclaration des droits de 1689 protègent les citoyens anglais contre le pouvoir du roi. L’Angleterre, cette « nation de philosophes », rend justice aux vraies grandeurs qui sont celles de l’esprit. Présent en 1727 aux obsèques solennelles de Newton à Westminster Abbey, il fait la comparaison: à supposer que Descartes soit mort à Paris, on ne lui aurait certainement pas accordé d’être enseveli à Saint-Denis, auprès des sépultures royales. La réussite matérielle du peuple d’Angleterre suscite aussi son admiration. Il fait le lien avec le retard de la France dans le domaine économique et l’archaïsme de ses institutions. Il estime que, là où croît l’intensité des échanges marchands et intellectuels, grandit en proportion l’aspiration des peuples à plus de liberté et de tolérance. Il ne lui faut que peu de temps pour acquérir une excellente maitrise de l’anglais. En novembre 1726, il s’installe à Londres. Il rencontre des écrivains, des philosophes, des savants (physiciens, mathématiciens, naturalistes) et s’initie à des domaines de connaissance qu’il ignorait jusqu’ici. Son séjour en Angleterre lui donne l’occasion de découvrir Newton dont il n’aura de cesse de faire connaître l’œuvre. Ainsi s’esquisse la mutation de l’homme de lettres en « philosophe », qui le conduit à s’investir dans des genres jusqu’alors considérés comme peu prestigieux: l’histoire, l’essai politique et plus tard le roman. C’est en Angleterre qu’il commence à rédiger en anglais l’ouvrage où il expose ses observations sur l’Angleterre, qu’il fera paraître en 1733 à Londres sous le titre Letters Concerning the English Nation et dont la version française n’est autre que les Lettres philosophiques. Il se rapproche de la cour de Georges Ier puis de Georges II et prépare une édition de la Henriade en souscription accompagnée de deux essais en anglais qui remporte un grand succès (343 souscripteurs) et renfloue ses finances. Une souscription analogue ouverte en France par son ami Thériot n’en rassemble que 80 et fera l’objet de nombreuses saisies de la police. Retour d’Angleterre (1728-1733) À l’automne 1728, il est autorisé à rentrer en France pourvu qu’il se tienne éloigné de la capitale. L’affaire Rohan remonte à plus de trois ans. Voltaire procède précautionneusement, séjournant plusieurs mois à Dieppe où il se fait passer pour un Anglais. Il obtient en avril l’autorisation de venir à Paris, mais Versailles lui reste interdit. Voltaire veut être riche pour être un écrivain indépendant. À son retour d’Angleterre, il n’a que quelques économies qu’il s’emploie activement à faire fructifier. Il gagne un capital important (avec d’autres et sur une idée du mathématicien La Condamine) en participant à une loterie d’État mal conçue. Puis, il part à Nancy spéculer sur des actions émises par le duc François III de Lorraine, opération dans laquelle il aurait « triplé son or ». Il reçoit aussi en mars 1730 sa part de l’héritage paternel. Ces fonds vont être judicieusement placés dans le commerce, « les affaires de Barbarie », vente des blés d’Afrique du Nord vers l’Espagne et l’Italie où elle est plus lucrative qu’à Marseille et les « transactions de Cadix », échange de produits des colonies françaises contre l’or et l’argent du Pérou et du Mexique. En 1734, il confie ses capitaux aux frères Pâris dans leur entreprise de fournitures aux armées. Enfin, à partir de 1736, Voltaire va surtout prêter de l’argent à des grands personnages et des princes européens, prêts transformés en rentes viagères selon une pratique courante de l’époque (à lui d’actionner ses débiteurs, désinvoltes mais ayant du répondant, pour obtenir le paiement de ses rentes). « J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre ». Programme réalisé à son retour d’Angleterre. En 1730, un incident, dont il se souviendra à l’heure de sa mort, le bouleverse et le scandalise. Il est auprès d’Adrienne Lecouvreur, une actrice qui a joué dans ses pièces et avec laquelle il a eu une liaison, lorsqu’elle meurt. Le prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice refuse la sépulture (la France est alors le seul pays catholique où les comédiens sont frappés d’excommunication). Le cadavre doit être placé dans un fiacre jusqu’à un terrain vague à la limite de la ville où elle est enterrée sans aucun monument pour marquer sa tombe. Quelques mois plus tard meurt à Londres une comédienne, Mrs Oldfield, enterrée à Westminster Abbey. Là encore, Voltaire fait la comparaison. Voltaire fait sa rentrée littéraire à Paris par le théâtre (mais il travaille selon son habitude à plusieurs œuvres à la fois). Sans beaucoup de succès avec Brutus, La mort de César et Eriphyle. Mais Zaïre en 1732 remporte un triomphe comparable à celui d’Œdipe et est joué dans toute l’Europe (la 488e représentation a eu lieu en 1936). La mise sur orbite avec les Lettres philosophiques ou Lettres anglaises, publiées en 1734 apparaît le premier grand travail des Lumières. Vingt-cinq lettres abordent des sujets assez variés: la religion, les sciences, les arts, la politique ou la philosophie (de Pascal notamment). L’ouvrage est destiné à un peuple plus ou moins cultivé, capable de lire mais nécessitant une éducation certaine. Ce sont des lettres ouvertes, destinées à être lues par un plus grand nombre grâce à leur parution sous forme d’un livre. Les Lettres philosophiques et l’Académie (1733-1749) Depuis des mois, sa santé délabrée fait que Voltaire vit sans maîtresse. En 1733, il devient l’amant de Mme du Châtelet. Émilie du Châtelet a 27 ans, 12 de moins que Voltaire. Fille de son ancien protecteur, le baron de Breteuil, elle décide pendant seize ans de l’orientation de sa vie, dans une situation quasi conjugale (son mari, un militaire appelé à parcourir l’Europe à la tête de son régiment, n’exige pas d’elle la fidélité, à condition que les apparences soient sauves, une règle que Voltaire « ami de la famille » sait respecter). Ils ont un enthousiasme commun pour l’étude et sous l’influence de son amie, Voltaire va se passionner pour les sciences. Il « apprend d’elle à penser », dit-il. Elle joue un rôle essentiel dans la métamorphose de l’homme de lettres en « philosophe ». Elle lui apprend la diplomatie, freine son ardeur désordonnée. Ils vont connaître dix années de bonheur et de vie commune. La passion se refroidit ensuite. Les infidélités sont réciproques (la nièce de Voltaire, Mme Denis, devient sa maitresse fin 1745, secret bien gardé de son vivant ; Mme du Châtelet s’éprend passionnément de Saint-Lambert en 1748), mais ils ne se sépareront pas pour autant, l’entente entre les deux esprits demeurant la plus forte. À sa mort, en 1749, elle ne sera jamais remplacée. Mme Denis, que Voltaire aimera tendrement, va régner sur son ménage (ce dont ne se souciait pas Mme du Châtelet), mais elle ne sera jamais la confidente et la conseillère de ses travaux. Émilie est une véritable femme de sciences. L’étendue de ses connaissances en mathématiques et en physique en fait une exception dans le siècle. C’est aussi une femme du monde qui mène une vie mondaine assez frénétique en dehors de ses études. Elle aime l’amour (elle a déjà eu plusieurs amants, dont le duc de Richelieu ; elle devient en 1734 la maîtresse de son professeur de mathématiques, Maupertuis, que lui a présenté Voltaire) et le jeu, où elle perd beaucoup d’argent. Elle cherche un homme à sa mesure pour asseoir sa réussite intellectuelle: Voltaire est un écrivain de tout premier plan, de réputation européenne, avide de réussite lui aussi. 1734 est l’année de la publication clandestine des Lettres philosophiques, le « manifeste des Lumières », grand reportage intellectuel et polémique sur la modernité anglaise, publié dans toute l’Europe à 20 000 exemplaires, selon l’estimation de René Pomeau, chiffre particulièrement élevé à l’époque. L’éloge de la liberté et de la tolérance anglaise est perçu à Paris comme une attaque contre le gouvernement et la religion. Le livre est condamné par le Parlement à majorité janséniste et brulé au bas du grand escalier du Palais. Une lettre de cachet est lancée contre Voltaire qui s’enfuit à Cirey, le château champenois que possèdent les Châtelet. Un an plus tard, après une lettre de désaveu où il « proteste de sa soumission entière à la religion de ses pères », il sera autorisé à revenir à Paris si nécessaire, mais la lettre de cachet ne sera pas révoquée. Pendant les dix années suivantes passées pour l’essentiel à Cirey, Voltaire va jouer un double jeu: rassurer ses adversaires pour éviter la Bastille, tout en continuant son œuvre philosophique pour gagner les hésitants. Tous les moyens sont bons: publications clandestines désavouées, manuscrits dont on fait savoir qu’il s’agit de fantaisies privées non destinées à la publication et qu’on lit aux amis et visiteurs qui en répandent les passages les plus féroces (exemple La Pucelle qui ridiculise Jeanne d’Arc). Son engagement est inséparable d’un combat antireligieux. L’intolérance religieuse, qu’il rend responsable de retard en matière de civilisation, est pour lui l’un des archaïsmes dont il voudrait purger la France. Voltaire restaure Cirey grâce à son argent. Les journées sont studieuses: discussions, lectures et travaux en communs, travaux personnels, portant sur la science et la religion. Voltaire fait des expériences scientifiques dans le laboratoire d’Émilie pour le concours de l’Académie des sciences. Aidé par Émilie du Châtelet, il est l’un des premiers à vulgariser en France les idées de Newton sur la gravitation universelle en publiant l’Épitre sur Newton (1736) et les Éléments de la philosophie de Newton (1738). Il commence La Pucelle (pour s’amuser dit-il) et Le Siècle de Louis XIV (pour convaincre son amie qui n’aime pas l’histoire), prépare L’Essai sur les mœurs, histoire générale de l’Occident chrétien où il dénombre les horreurs engendrées par le fanatisme. Toujours du théâtre avec Alzire (qui fait « perdre la respiration » au jeune Rousseau) et Mérope qui est un grand succès. Un poème, où il fait l’apologie du luxe (« Le superflu, chose très nécessaire »), Le Mondain, et évoque la vie d’Adam, scandalise à Paris les milieux jansénistes. Prévenu, il s’enfuit en Hollande par crainte des représailles. En 1742, sa pièce Mahomet est applaudie à Paris. Mais les mêmes milieux accusent Voltaire de taxer d’imposture, à travers l’islam, le christianisme lui-même. Ils obtiennent du pouvoir royal plutôt réticent l’interdiction de fait de la pièce, que Voltaire, toujours sous le coup de la lettre de cachet de 1734, doit retirer après la 3e représentation. Elle ne sera reprise qu’en 1751. Voltaire apparaît de plus en plus comme un adversaire de la religion. En 1736, Voltaire reçoit la première lettre du futur roi de Prusse. Commence alors une correspondance qui durera jusqu’à la mort de Voltaire (interrompue en 1754, après l’avanie de Francfort, elle reprendra en 1757). « Continuez, Monsieur, à éclairer le monde. Le flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains », lui écrit Frédéric qui veut l’attacher à sa cour par tous les moyens. Voltaire lui rend plusieurs fois visite, mais refuse de s’installer à Berlin du vivant de Mme du Châtelet qui se méfie du roi-philosophe. Pour cette raison peut-être, Madame du Châtelet pousse Voltaire à chercher un retour en grâce auprès de Louis XV. De son côté, Voltaire ne conçoit d’avenir pour ses idées sans l’accord du roi. En 1744, il est aidé par la conjoncture: le nouveau ministre des Affaires étrangères est d’Argenson, son ancien condisciple de Louis-le-Grand, et surtout il a le soutien de la nouvelle favorite Mme de Pompadour, qui l’admire. Son amitié avec le roi de Prusse est un atout. Il se rêve en artisan d’une alliance entre les deux rois et accepte une mission diplomatique, qui échoue. Grâce à ses appuis, il obtient la place d’historiographe de France, le titre de « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi » et les entrées de sa chambre. Dans le cadre de ses fonctions, il compose un poème lyrique, La Bataille de Fontenoy et un opéra, avec Rameau, à la gloire du roi. Mais Louis XV ne l’aime pas et Voltaire ne sera jamais un courtisan. De même, la conquête de l’Académie française lui paraît « absolument nécessaire ». Il veut se protéger de ses adversaires et y faire rentrer ses amis (à sa mort, elle sera majoritairement voltairienne et aura à sa tête d’Alembert qui lui est tout dévoué). Après deux échecs et beaucoup d’hypocrisies (un éloge des Jésuites et le canular de la bénédiction papale), il réussit à se faire élire le 2 mai 1746. La même année, Zadig, un petit livre publié clandestinement à Amsterdam est désavoué par Voltaire: « Je serais très fâché de passer pour l’auteur de Zadig qu’on ose accuser de contenir des dogmes téméraires contre notre sainte religion ». Outre ses aspects philosophiques, Zadig apparaît comme un bilan autocritique qu’établit Voltaire à 50 ans, estime Pierre Lepape. La gloire ne s’obtient qu’au prix du ridicule et de la honte du métier de courtisan, le bonheur est saccagé par les persécutions qu’il faut subir, l’amour est un échec, la science une manière de se cacher l’absurdité de la vie. L’histoire de l’humanité est celle d’un cheminement de la conscience malgré les obstacles: ignorance, superstition, intolérance, injustice, déraison. Zadig est celui qui lutte contre cette obscurité de la conscience: « Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à s’obscurcir ». En septembre 1749, Mme du Châtelet, enceinte de Saint-Lambert, officier de la cour du roi Stanislas et poète, meurt dans les jours qui suivent son accouchement. À la mort de Madame du Châtelet, avec laquelle il avait cru faire sa vie jusqu’à la fin de ses jours malgré leurs querelles et infidélités réciproques, Voltaire est désemparé et souffre de dépression (« la seule vraie souffrance de ma vie », dira-t-il). Il a 56 ans. Il ne reste que six mois à Paris. L’hostilité de Louis XV et l’échec de sa tragédie Oreste le poussent à accepter les invitations réitérées de Frédéric II. La maturité (1749-1768) Le voyage à Berlin (1749-1753) Il part en juin 1750 pour la cour de Prusse. Le 27 juillet, il est à Berlin. C’est l’enchantement. Magnifiquement logé dans l’appartement du maréchal de Saxe, il travaille deux heures par jour avec le roi qu’il aide à mettre au point ses œuvres. Le soir, des soupers délicieux avec la petite cour très francisée de Potsdam où il retrouve Maupertuis, président de l’Académie des sciences de Berlin, La Mettrie, d’Argens. Il a sa chambre au château de Sans-Souci et un appartement dans la ville au palais de la Résidence. En août, il reçoit la dignité de chambellan, avec l’ordre du Mérite. Voltaire va passer plus de deux ans et demi en Prusse (il y termine Le Siècle de Louis XIV et écrit Micromégas). Mais après l’euphorie des débuts, ses relations avec Frédéric se détériorent, les brouilles se font plus fréquentes, parfois provoquées par les imprudences de Voltaire (affaire Hirschel). Un pamphlet de Voltaire contre Maupertuis (ce dernier avait commis, en tant que président de l’Académie des sciences, un abus de pouvoir contre l’ancien précepteur de Mme du Châtelet, König, académicien lui aussi) provoque la rupture. Le pamphlet, La Diatribe du docteur Akakia, est imprimé par Voltaire sans l’accord du roi et en utilisant une permission accordée pour un autre ouvrage. Se sentant berné, furieux que l’on attaque son Académie, Frédéric fait saisir les exemplaires qui sont brûlés sur la place publique par le bourreau. Voltaire demande son congé. Il quitte la Prusse le 26 mars 1753 avec la permission du roi. Il ne se dirige pas tout de suite vers la France, faisant des arrêts prolongés à Leipzig, Gotha et Kassel où il est fêté, mais à Francfort, ville libre d’empire, Frédéric le fait arrêter le 31 mai par son résident le baron von Freytag, pour récupérer un livre de poésies écrit par lui et donné à Voltaire, dont il craint que ce dernier ne fasse mauvais usage (Voltaire en fait dans son récit de l’évènement « l’œuvre de poéshie du roi mon maitre »). Pendant plus d’un mois, Voltaire, en compagnie de Mme Denis venue le rejoindre, est humilié, séquestré, menacé et rançonné dans une série de scènes absurdes et ubuesques. Enfin libéré, il peut quitter Francfort le 8 juillet. À la frontière de la France (1753-1755) Jusqu’à la fin de l’année, il attend à Colmar la permission de revenir à Paris, mais le 27 janvier 1754, l’interdiction d’approcher de la capitale lui est notifiée. Il se dirige alors, par Lyon, vers Genève. Il pense trouver un havre de liberté dans cette république calviniste de notables et de banquiers cultivés parmi lesquels il compte de nombreux admirateurs et partisans. Grâce à son ami François Tronchin, Voltaire achète sous un prête-nom (les catholiques ne peuvent pas être propriétaires à Genève) la belle maison des Délices et en loue une autre dans le canton de Vaud pour passer la saison d’hiver. Les Délices annoncent Ferney. Voltaire embellit la maison, y mène grand train, reçoit beaucoup (la visite du grand homme, au cœur de la propagande voltairienne, devient à la mode), donne en privé des pièces de théâtre (le théâtre est toujours interdit dans la ville de Calvin). Très vite, les pasteurs genevois lui « conseillent » de ne rien publier contre la religion tant qu’il habite parmi eux. Le tremblement de terre et Candide (1755-1759) Il travaille aussi beaucoup: théâtre, préparation de Candide, sept volumes de l’Essai sur les mœurs tiré à 7 000 exemplaires, Poème sur le désastre de Lisbonne, révision des dix premiers volumes de ses Œuvres complètes chez Gabriel Cramer, son nouvel éditeur, qui a un réseau de correspondants européens permettant de diffuser les livres interdits. Voltaire collabore aussi à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (125 auteurs recensés). Ce grand dictionnaire vendu dans toute l’Europe (la souscription coûte une fortune) défend aussi la liberté de penser et d’écrire, la séparation des pouvoirs et attaque la monarchie de droit divin. Voltaire rédige une trentaine d’articles, mais il est en désaccord sur la tactique (« Je voudrais bien savoir quel mal peut faire un livre qui coûte cent écus. Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre »). Il voudrait imposer sa marque, faire de l’Encyclopédie l’organe du combat antichrétien, l’imprimer hors de France, mais, s’il possède en d’Alembert un allié de poids, il ne peut gagner Diderot à ses vues. Largement inspiré par Voltaire, l’article « Genève » de d’Alembert paru dans le volume VII en 1757 fait scandale auprès du clergé genevois. En France, après l’attentat de Damiens contre Louis XV, une offensive antiphilosophique se déclenche: après le livre d’Helvétius, De l’Esprit, interdit en août 1758, l’Encyclopédie est interdite à son tour le 8 mars 1759, par décret royal. Pour mieux assurer son indépendance et échapper aux tracasseries des pasteurs de Genève, Voltaire achète le château de Ferney (et celui de Tourney qui forme avec le précédent un vaste ensemble d’un seul tenant) et s’y installe en octobre 1758. Ferney est dans le Pays de Gex, en territoire français, mais loin de Versailles et à quatre kilomètres de la république genevoise où il peut trouver refuge et où se situe son éditeur Cramer et bon nombre de ses partisans dans les milieux dirigeants. Le Vignoble de la vérité (1759-1763) Ferney est la période la plus active de la vie de Voltaire. Il va y résider vingt ans jusqu’à son retour à Paris. C’est à Ferney qu’il va acquérir une nouvelle stature, celle d’un champion de la justice et de l’humanité et livrer ses grandes batailles. Il a 64 ans, un âge au XVIIIe siècle où la vie approche de son terme. Voltaire est devenu riche et en est fier: « Je suis né assez pauvre, j’ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau, et cependant me voilà maintenant avec deux châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d’argent comptant », écrit-il à son banquier en 1761. Sa fortune lui permet de reconstruire le château, d’en embellir les abords, d’y construire un théâtre, de faire de son vivant du village misérable de Ferney une petite ville prospère et aussi de tenir table et porte ouvertes, jusqu’à ce que l’afflux de visiteurs et la fatigue l’obligent à restreindre l’accueil. C’est la nièce et compagne de Voltaire, Madame Denis, qui reçoit comme maitresse de maison dont le poète Florian. Lui ne se montre qu’aux repas, se réservant d’apparaître à l’improviste si cela lui convient, car il se ménage de longues heures de travail (« J’ai quelquefois 50 personnes à table. Je les laisse avec Mme Denis qui fait les honneurs, et je m’enferme »). Ses visiteurs, qui l’attendent impatiemment, sont en général frappés par le charme de sa conversation, la vivacité de son regard, sa maigreur, son accoutrement (habituellement Voltaire ne « s’habille » pas). Il aime conduire ses hôtes dans son jardin et leur faire admirer le paysage. Les grandes heures sont celles du théâtre (« Rien n’anime plus la société, rien ne donne plus de grâce au corps et à l’esprit, rien ne forme plus le goût », dit-il). Installé à côté du château, il peut contenir 300 personnes. Voltaire et Mme Denis y jouent eux-mêmes leurs rôles préférés. Lutte contre l’injustice: Calas, Sirven et La Barre (1761-1765) Le 22 mars 1761, Voltaire est informé que, par ordre du parlement de Toulouse, un vieux commerçant protestant, nommé Calas, vient d’être roué, puis étranglé et brulé. Il aurait assassiné son fils, qui voulait se convertir au catholicisme. Voltaire apprend bientôt qu’en réalité Calas a été condamné sans preuves. Des témoignages le persuadent de son innocence. Convaincu qu’il s’agit d’une tragédie de l’intolérance, que les juges ont été influencés par le fanatisme ambiant, il entreprend la réhabilitation du supplicié et l’acquittement des autres Calas qui restent inculpés. Pendant trois ans (1762-1765), il mène une intense campagne: écrits, lettres, mettent en mouvement tout ce qui a de l’influence en France et en Europe. C’est à partir de l’affaire Calas que le mot d’ordre « Écrasez l’Infâme » (chez Voltaire, la superstition, le fanatisme et l’intolérance), abrégé à l’usage en Ecr.linf., apparaît dans sa correspondance à la fin de ses lettres. Il élève le débat par un Traité sur la tolérance (1763). Une sentence d’un parlement n’étant pas susceptible d’appel, le seul recours est le Conseil du royaume, présidé par le roi. Seul Voltaire a assez de prestige pour saisir une telle instance. De Ferney, n’ayant que son écritoire et son papier, il parvient à faire casser l’arrêt du Parlement et à faire indemniser la famille. « Par lui – par lui seul – le procès Calas deviendra l’affaire Calas, une de ces affaires qui marquent la conscience des hommes », écrit René Pomeau. Il réussit de même à faire réhabiliter Sirven, un autre protestant condamné par contumace le 20 mars 1764 à être pendu, avec sa femme, pour le meurtre de leur fille que l’on savait folle et qu’on trouva noyée dans un puits. On accusait son père et sa mère de l’avoir assassinée pour l’empêcher de se convertir. Les deux parents vont solliciter Voltaire qui obtient leur acquittement après un long procès. L’affaire La Barre surpasse en horreur celles de Calas et de Sirven. À Abbeville, le 9 août 1765, on découvre en pleine ville, sur le Pont-Neuf, un crucifix de bois mutilé. Une enquête est ouverte. Les soupçons se portent sur un groupe de jeunes gens qui se sont fait remarquer en ne se découvrant pas devant la procession du Saint-Sacrement, en chantant des chansons obscènes et en affectant de lire le Dictionnaire philosophique de Voltaire. Deux s’enfuient. Le chevalier de La Barre, âgé de 19 ans, est condamné à avoir la langue coupée, puis à être décapité et brulé. Le Parlement de Paris confirme la sentence. L’exécution a lieu le 1er juillet 1766. Le Dictionnaire philosophique est brulé en même temps que le corps et la tête du condamné. Voltaire rédige l’exposé détaillé de l’affaire, fait ressortir le scandale, provoque un revirement de l’opinion. Le juge d’Abbeville est révoqué, les coïnculpés acquittés. « Ce sang innocent crie, et moi je crierai aussi ; et je crierai jusqu’à ma mort » écrit Voltaire à d’Argental. Son engagement pour combattre l’injustice va durer jusqu’à sa mort (réhabilitation posthume de Lally-Tollendal, affaires Morangiés, Monbailli, serfs du Mont-Jura). « Il faut dans cette vie combattre jusqu’au dernier moment », déclare-t-il en 1775. Le Dictionnaire portatif (1764-1768) À Ferney, Voltaire va s’affirmer comme le champion de la « philosophie », cette pensée des Lumières portée par de très nombreux individus—mais dispersés et constamment engagés entre eux en d’âpres discussions. Sa production imprimée pendant ces années va être considérable. « J’écris pour agir », affirme-t-il. Il veut gagner ses lecteurs à la cause des Lumières. Il choisit pour sa propagande des œuvres « utiles et courtes ». Contrairement à L’Encyclopédie, avec ses gros volumes facilement bloqués chez l’éditeur, il privilégie les brochures de quelques pages qui se dissimulent aisément, échappent aux perquisitions de la douane et de la police et se vendent pour quelques sous. À Paris, il peut compter sur une équipe de fidèles, en premier lieu d’Alembert, futur secrétaire de l’Académie française, dont les relations mondaines et littéraires lui sont de précieux atouts, et qui n’hésite pas à le mettre en garde ou à corriger ses erreurs, mais aussi Grimm, Mme d’Épinay, Helvétius, Marmontel, Mme du Deffand, et aussi sur des appuis politiques comme Richelieu ou Choiseul (qui ne sont ni philosophes, ni libéraux, mais à qui Voltaire plaît). Quand il s’installe à Ferney, la diffusion clandestine de Candide, son chef-d’œuvre, a commencé. « Jamais Voltaire n’a aussi bien exprimé le monde tel que le voit son humeur: vision désolée et gaie, décapante mais tonique » écrit René Pomeau, qui calcule qu’il a dû se vendre en 1759 environ 20 000 Candide, chiffre énorme à l’époque où L’Encyclopédie même ne dépasse pas 4 000 exemplaires. En France, le pouvoir et les milieux conservateurs ont lancé une campagne contre les idées nouvelles: interdiction de L’Encyclopédie, discours de Le Franc de Pompignan à l’Académie, comédie de Palissot contre les philosophes au Théâtre-Français, attaques de Fréron, grand journaliste et polémiste redoutable. De Ferney, Voltaire organise la contre-offensive: articles, brochures, petits vers (l’épigramme contre Fréron est restée célèbre: L’autre jour au fond d’un vallon, /Un serpent piqua Jean Fréron ;/Que croyez-vous qu’il arriva ?/Ce fut le serpent qui creva.), comédies, pièces, tout est bon pour faire taire les ennemis des philosophes. En 1764, le Dictionnaire philosophique portatif, bilan de la réflexion philosophique de Voltaire, en même temps qu’outil pédagogique destiné au public cultivé, se répand, toujours clandestinement, en Europe. Considéré comme impie, il est condamné en France par le Parlement le 19 mars 1765 (Louis XV, après avoir pris connaissance du livre aurait demandé: « Est-ce qu’on ne peut pas faire taire cet homme-là ? »), mais aussi à Genève et à Berne où il est brûlé. Manifeste des Lumières (Voltaire en donne quatre nouvelles éditions de 1764 à 1769 chaque fois enrichies d’articles nouveaux), le Dictionnaire est composé de textes brefs et vifs, rangés dans l’ordre alphabétique. « Ce livre n’exige pas une lecture suivie », écrit Voltaire en tête de volume, « mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir ». De 1770 à 1774, le Dictionnaire... est prolongé et considérablement enrichi sous le titre Questions sur l’Encyclopédie. Dernières années (1768-1778) Le déiste toujours en lutte (1768-1769) « J’ai été pendant 14 ans l’aubergiste de l’Europe », écrit-il à Madame du Deffand. Ferney se trouve sur l’axe de communication de l’Europe du Nord vers l’Italie, itinéraire du Grand Tour de l’aristocratie européenne au XVIIIe siècle. Les visiteurs affluent pour le voir et l’entendre. Les plus nombreux sont les Anglais qui savent que le philosophe aime l’Angleterre (trois ou quatre cents affirme Voltaire), mais il y a aussi des Français, des Allemands, des Italiens, des Russes. Leurs témoignages permettent de connaître la vie quotidienne à Ferney. À Ferney, l’artiste genevois Jean Huber, devenu un familier de la maison, a fait d’innombrables croquis et aquarelles de Voltaire, à la fois comique et familier, dans l’ordinaire de sa vie quotidienne. En 1768, l’impératrice Catherine II lui commande un cycle de peintures voltairiennes dont neuf toiles sont conservées au musée de l’Ermitage. Les capitaux que Voltaire investit tirent Ferney de la misère. Dès son arrivée, il améliore la production agricole, draine les marécages, plante des arbres, achète une nouveauté dont il est fier, la charrue à semoir et donne l’exemple en labourant lui-même chaque année un de ses champs. Il fait construire des maisons pour accueillir de nouveaux habitants, développe des activités économiques, soieries, horlogerie surtout. « Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1 200 personnes utiles », peut-il écrire en 1777. À la fin des années 1990, l’État français a acheté le château de Ferney-Voltaire qui est administré par le Centre des monuments nationaux. En cours de restauration, seuls le parc et l’orangerie sont ouverts à la visite durant les travaux. La réouverture du château est prévue au printemps 2018. Dans l’expectative (1769-1773) Bien avant la mort de Louis XV, Voltaire souhaite revenir à Paris après une absence de près de 28 ans. Le dernier combat (1773-1776) Depuis le début de février 1773, Voltaire souffre d’un cancer de la prostate (diagnostic rétrospectif établi de nos jours grâce au rapport de l’autopsie pratiquée le lendemain de son décès). La dysurie est majeure, les accès de fièvre fréquents ainsi que les pertes de connaissance. Les jambes gonflées font parler d’hydropisie (affection dont son probable père biologique serait mort en 1719). Le 8 mai, il informe d’Alembert: « Je vois la mort au bout de mon nez ». Les mictions sont difficiles. L’été 1773, des forces reviennent, mais la crise de rétention aiguë d’urines de février 1773, le reprend en mars 1774. En mai 1774, il perd sa plus jeune nièce de tuberculose, Élisabeth, marquise de Florian (ex Mme de Fontaine, née Mignot). Suit, moins triste pour Voltaire, la mort de Louis XV de petite vérole le 10 mai 1774. Le dernier acte (1776-1778) Les nouvelles autorités font comprendre à ses amis qu’on fermerait les yeux s’il se rendait aux répétitions parisiennes de sa dernière tragédie. Après beaucoup d’hésitations, il décide de rallier la capitale en février 1778 à l’occasion de la création d’Irène à la Comédie-Française. Il arrive le 10 février et s’installe dans un bel appartement de l’hôtel du marquis de Villette (qui a épousé en 1777 sa fille adoptive, Mlle de Varicourt surnommée « Belle et Bonne ») au coin de la rue de Beaune et du quai des Théatins (aujourd’hui quai Voltaire). Dès le lendemain de son arrivée, Voltaire a la surprise de voir des dizaines de visiteurs envahir la demeure du marquis de Villette qui va devenir pendant tout son séjour le lieu de rendez-vous du Tout-Paris « philosophe ». Le 30 mars 1778 est le jour de son triomphe à l’Académie, à la Comédie-Française et dans les rues de Paris. Sur son parcours, une foule énorme l’entoure et l’applaudit. L’Académie en corps vient l’accueillir dans la première salle. Il assiste à la séance, assis à la place du directeur. À la sortie, la même foule immense l’attend et suit le carrosse. On monte sur la voiture, on veut le voir, le toucher. À la Comédie-Française, l’enthousiasme redouble. Le public est venu pour l’auteur, non pour la pièce. La représentation d’Irène est constamment interrompue par des cris. À la fin, on lui apporte une couronne de laurier dans sa loge et son buste est placé sur un piédestal au milieu de la scène. À la sortie, il est retenu longtemps à la porte par la foule qui réclame des flambeaux pour mieux le voir. On s’exclame: « Vive le défenseur des Calas! ». Voltaire peut mesurer ce soir-là l’indéniable portée de son action, même si la cour, le clergé et l’opinion antiphilosophique lui restent hostiles et se déchaînent contre lui et ses amis philosophes, ennemis de la religion, des « bonnes » mœurs et de la monarchie. La maladie (mars-mai 1778) Voltaire a 83 ans. Atteint d’un mal qui progresse insidieusement pour entrer dans sa phase finale le 10 mai 1778, Voltaire se comporte comme s’il était indestructible. Son état de santé et son humeur changent pourtant d’un jour à l’autre. Il envisage son retour à Ferney pour Pâques, mais il se sent si bien à Paris qu’il pense sérieusement à s’y fixer. Madame Denis, ravie, part à la recherche d’une maison. Il veut se prémunir contre un refus de sépulture. Dès le 2 mars, il fait venir un obscur prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice, l’abbé Gaultier, à qui il remet une confession de foi minimale (qui sera rendue publique dès le 11 mars) en échange de son absolution. Le 28 mars, il écrit à son secrétaire Wagnière les deux lignes célèbres: « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, et en détestant la superstition ». À partir du 10 mai 1778, malgré l’assistance du docteur Théodore Tronchin, ses souffrances deviennent intolérables. Pour calmer ses douleurs, il prend de fortes doses d’opium qui le font sombrer dans une somnolence entrecoupée de phases de délire. Mais une fois passée l’action de l’opium, le mal se réveille pire que jamais. La conversion de Voltaire, au sommet de sa gloire, aurait constitué une grande victoire de l’Église sur la « secte philosophique ». Le curé de Saint-Sulpice et l’archevêque de Paris, désavouant l’abbé Gaultier, font savoir que le mourant doit signer une rétractation franche s’il veut obtenir une inhumation en terre chrétienne. Mais Voltaire refuse de se renier. Des tractations commencent entre la famille et les autorités soucieuses d’éviter un scandale. Un arrangement est trouvé. Dès la mort de Voltaire on le transportera « comme malade » à Ferney. S’il décède pendant le voyage, son corps sera conduit à destination. Voltaire meurt le 30 mai dans l’hôtel de son ami le marquis de Villette, « dans de grandes douleurs, excepté les quatre derniers jours, où il a fini comme une chandelle », écrit Mme Denis. Le 31 mai, selon sa volonté, M. Try, chirurgien, assisté d’un M. Burard, procède à l’autopsie. Le corps est ensuite embaumé par M. Mitouart, l’apothicaire voisin qui obtient de garder le cerveau, le cœur revenant à Villèle (voir en Informations complémentaires l’histoire de ces deux organes). Le neveu de Voltaire, l’abbé Mignot, ne veut pas courir le risque d’un transport à Ferney. Il a l’idée de l’enterrer provisoirement dans la petite abbaye de Sellières près de Romilly-sur-Seine, dont il est abbé commendataire. Le 31 mai, le corps de Voltaire embaumé est installé assis, tout habillé et bien ficelé, avec un serviteur, dans un carrosse qui arrive à Scellières le lendemain après-midi. Grâce au billet de confession signé de l’abbé Gaultier, il est inhumé religieusement dans un caveau de l’église avant que l’évêque de Troyes, averti par l’archevêque de Paris Christophe de Beaumont, n’ait eu le temps d’ordonner au prieur de Scellières de surseoir à l’enterrement. Le Panthéon Après la mort de Voltaire, Mme Denis, légataire universelle, vend Ferney à Villette (la bibliothèque, acquise par Catherine II, est convoyée jusqu’à Saint-Pétersbourg par Wagnière). Villette, s’apercevant que le domaine est lourdement déficitaire, le revend en 1785. Le transfert de la sépulture à Ferney devient impossible. L’abbé Mignot veut commander un mausolée pour orner la dalle anonyme sous laquelle repose Voltaire, mais les autorités s’y opposent. En 1789, l’Assemblée constituante vote la nationalisation des biens du clergé. L’abbaye de Sellières va être mise en vente. Il faut trouver une solution. Villette fait campagne pour le transfert à Paris des restes du grand homme (il a déjà débaptisé de sa propre autorité le quai des Théatins en y apposant une plaque: « Quai Voltaire »). C’est lui qui lance le nom de Panthéon et désigne le lieu, la basilique de Sainte-Geneviève. Le 30 mai 1791, jour anniversaire de sa mort, l’Assemblée, malgré de fortes oppositions (les membres du clergé constituent le quart des députés) décide le transfert. Le 4 avril, après la mort de Mirabeau survenue le 2, l’Assemblée décrète que « le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes ». Mirabeau est le premier « panthéonisé ». Voltaire le suit le 11 juillet. Comme le corps de Mirabeau fut retiré de ce monument des suites de la découverte de l’armoire de fer, Voltaire est devenu le plus ancien hôte du Panthéon. Le cortège comprend des formations militaires, puis des délégations d’enfants. Derrière une statue de Voltaire d’après Houdon, portée par des élèves des beaux-arts costumés à l’antique, viennent les académiciens et gens de lettres, accompagnés des 70 volumes de l’édition de Kehl, offerts par Beaumarchais. Sur le sarcophage se lit une inscription: « Il vengea Calas, La Barre, Sirven et Monbailli. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l’esprit humain, et nous a préparés à être libres ». L’œuvre de Voltaire Œuvres complètes de Voltaire, Paris, édition Garnier, 50 volumes, 1877 (Wikisource) La production littéraire de Voltaire inclut le théâtre, l’histoire, la philosophie, la poésie, des contes, de nombreux textes polémiques, et une grande correspondance. De son vivant, ses Œuvres complètes comptent 40 volumes in-8° (édition de Genève de 1775). Après sa mort, l’édition de Kehl commanditée par Beaumarchais et éditée entre 1784 et 1789, inclut sa correspondance qui rajoute 30 volumes in-8° (malgré le fait que de nombreux détenteurs de lettres ont refusé de les communiquer). L’édition en cours de publication à Oxford en comptera près de 200[réf. nécessaire]. Les contes philosophiques Voltaire n’attribuait à ses contes qu’une faible importance, mais c’est sans doute aujourd’hui la partie de son œuvre la plus éditée et la plus lue. « C’est là que l’on retrouve, aussi libre que dans sa correspondance, l’esprit de Voltaire » écrit René Pomeau. Ils font partie des textes incontournables du XVIIIe siècle et occupent une place de choix au sein de la culture française. Ce sont, entre autres, le Songe de Platon, Micromégas, Le Monde comme il va, Zadig, Les Deux Consolés, Candide, l’Histoire d’un bon bramin, Jeannot et Colin, L’Ingénu, L’Homme aux quarante écus, Le Taureau blanc, Les Dialogues d’Evhémère. La correspondance Exilé à Ferney, Voltaire correspond avec tout ce qui compte en Europe. L’abondance de sa correspondance (de l’ordre de 23 000 lettres retrouvées, 13 tomes dans la bibliothèque de la Pléiade) rend nécessaire la publication de lettres choisies. Citons, entre autres, la correspondance suivie avec Madame du Deffand, âgée et aveugle, sceptique désabusée et lucide qui réunit dans son salon tout le grand monde parisien (« avec Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette époque » selon Sainte-Beuve). « Le pessimisme de Mme du Deffand est tellement absolu », écrit Benedetta Craveri, « qu’il oblige son correspondant à se prononcer sur le destin de l’homme, avec une précision qu’on ne retrouve pas dans le reste de son œuvre ». « C’est dans ses lettres qu’il faut chercher l’expression la plus intime de la philosophie de Voltaire ; sa manière d’accepter la vie et d’affronter la mort, ses idées métaphysiques et son scepticisme, ses luttes passionnées au nom de l’humanité et ses accès de résignation mystiques ». Les écrits philosophiques Voltaire n’apporte pas de réponses rassurantes, mais enseigne à douter, parce que c’est par le doute que l’on apprend à penser. La partie philosophique de son œuvre est toujours actuelle: Les Lettres philosophiques, le Traité sur la tolérance, le Dictionnaire philosophique portatif, les Questions sur l’Encyclopédie. Le théâtre Le théâtre de Voltaire, qui a fait sa gloire et passionné ses contemporains, est aujourd’hui largement oublié. Voltaire a cependant été le plus grand auteur dramatique du XVIIIe siècle et a régné sur la scène de la Comédie-Française de 1718 à sa mort. Il a écrit une cinquantaine de tragédies qui, selon l’estimation de René Pomeau, ont été applaudies, rarement sifflées, par environ deux millions de spectateurs. À Paris, ses plus grands succès sont, dans l’ordre, Zaïre (1732), Alzire, (1736), Mérope (1743), Sémiramis (1748), Œdipe (1718), Tancrède (1760), L’Orphelin de la Chine (1755) et Mahomet (1741). L’œuvre poétique La versification, pratiquée dès l’enfance, était devenue pour Voltaire un mode d’écrire naturel. Sa production poétique a été évaluée à 250 000 vers. Il n’avait pas son pareil pour manier l’alexandrin. Longtemps il sera pour ses contemporains l’auteur de La Henriade que Beaumarchais place au même niveau que l’Iliade et qui connaitra encore 67 éditions entre 1789 et 1830 avant d’être rejetée dans l’oubli par le Romantisme. Cette œuvre versifiée (La Pucelle d’Orléans, Le Mondain, le Poème sur le désastre de Lisbonne) est moins lisible pour nous aujourd’hui, mais il existe, en particulier à travers ses épitres, un Voltaire poète de la gaîté et du sourire, à la verve inventive, inspiré souvent par l’esprit satirique. L’œuvre historique Elle ne survit (Le Siècle de Louis XIV, Histoire de Charles XII, Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand), comme celle de Michelet, que parce qu’elle est l’œuvre d’un écrivain, même si sa perspective de l’histoire « philosophique » (Essai sur les mœurs et l’esprit des nations), consistant à suivre les efforts des hommes en société pour sortir de l’état primitif, reste valable. L’œuvre scientifique Elle est périmée même si Voltaire fut l’un des pionniers du newtonisme avec ses Éléments de la philosophie de Newton (1738). La morale de Voltaire Le libéralisme Dans la pensée du philosophe anglais John Locke, Voltaire trouve une doctrine qui s’adapte parfaitement à son idéal positif et utilitaire. John Locke apparaît comme le défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social ne supprime pas les droits naturels des individus. En outre, c’est l’expérience seule qui nous instruit ; tout ce qui la dépasse n’est qu’hypothèse ; le champ du certain coïncide avec celui de l’utile et du vérifiable. Voltaire tire de cette doctrine la ligne directrice de sa morale: la tâche de l’homme est de prendre en main sa destinée, d’améliorer sa condition, d’assurer, d’embellir sa vie par la science, l’industrie, les arts et par une bonne « police » des sociétés. Ainsi, la vie en commun ne serait pas possible sans une convention où chacun trouve son compte. Bien que s’exprimant par des lois particulières à chaque pays, la justice, qui assure cette convention, est universelle. Tous les hommes sont capables d’en concevoir l’idée, d’abord parce que tous sont des êtres plus ou moins raisonnables, ensuite parce qu’ils sont tous capables de comprendre que ce qui est utile à la société est utile à chacun. La vertu, « commerce de bienfaits, leur est dictée à la fois par le sentiment et par l’intérêt. Le rôle de la morale, selon Voltaire, est de nous enseigner les principes de cette « police » et de nous accoutumer à les respecter. Cependant, la conception oligarchique et hiérarchisée de la société de Voltaire ne nous permet pas de le situer clairement parmi les philosophes du libéralisme démocratique: il affirme également dans Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations: « Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace ; elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains: l’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne. Certainement cet esprit de la nation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit sur la terre ». Le déisme Étranger à tout dogmatisme religieux, Voltaire se refuse toutefois à l’athéisme d’un Diderot ou d’un d’Holbach. Il ne cessa de répéter son fameux distique: Ainsi, selon Voltaire, l’ordre de l’univers peut-il nous amener à constater l’existence d’un « éternel géomètre ». C’est pour lui une évidence rationnelle: un effet ne peut exister sans qu’il y ait aussi une cause préalable, de même que la lumière naturelle ne peut exister sans tirer son origine du soleil – ou qu’une bougie ne peut être allumée sans qu’un « athée » ait auparavant décidé d’enflammer sa mèche ; ce que Voltaire nomme « Dieu », c’est la Cause ultime, absolue qui ordonne éternellement et présentement tous les desseins cosmiques: le soleil est ainsi « fait pour éclairer notre portion d’univers ». Sa vision de Dieu correspond à un panthéisme, proche de Giordano Bruno et de Baruch Spinoza ; dans Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche, Voltaire écrit: « Une cause sans effet est une chimère, une absurdité, aussi bien qu’un effet sans cause. Il y a donc éternellement, et il y aura toujours des effets de cette cause universelle. Ces effets ne peuvent venir de rien ; ils sont donc des émanations éternelles de cette cause éternelle. La matière de l’univers appartient donc à Dieu tout autant que les idées, et les idées tout autant que la matière. Dire que quelque chose est hors de lui, ce serait dire qu’il y a quelque chose hors de l’infini. Dieu étant le principe universel de toutes les choses, toutes existent en lui et par lui.(...) On ne fait point Dieu l’universalité des choses: nous disons que l’universalité des choses émane de lui ; et pour nous servir (...) de l’indigne comparaison du soleil et de ses rayons, nous disons qu’un trait de lumière lancé du globe du soleil, et absorbé dans le plus infect des cloaques, ne peut laisser aucune souillure dans cet astre. Ce cloaque n’empêche pas que le soleil ne vivifie toute la nature dans notre globe.(...) Nous pourrions dire encore qu’un trait de lumière, pénétrant dans la fange, ne se mêle point avec elle, et qu’elle y conserve son essence invisible ; mais il vaut mieux avouer que la lumière la plus pure ne peut représenter Dieu. La lumière émane du soleil, et tout émane de Dieu. Nous ne savons pas comment ; mais nous pouvons (...) concevoir Dieu comme l’Être nécessaire de qui tout émane. [Note: « nécessaire » signifie philosophiquement: « qui ne peut pas ne pas être – ni être autrement »]. » Mais, au-delà, il ne voit qu’incertitudes: « J’ai contemplé le divin ouvrage, et je n’ai point vu l’ouvrier ; j’ai interrogé la nature, elle est demeurée muette ». Il conclut: « Il m’est impossible de nier l’existence de ce Dieu », ajoutant qu’il est « impossible de le connaître ». Il rejette toute incarnation, « tous ces prétendus fils de Dieu ». Ce sont « des contes de sorciers ». « Un Dieu se joindre à la nature humaine! J’aimerais autant dire que les éléphants ont fait l’amour à des puces, et en ont eu de la race: ce serait bien moins impertinent ». S’il reste attaché au déisme, qui correspond à un théisme philosophique, il dénonce comme dérisoire le providentialisme (dans Candide par exemple) et repose cette question formulée dès saint Augustin dont la réponse est inaccessible à la logique humaine parfaitement limitée: « Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon ? ». Voltaire n’apporte à ce sujet que cette précision: « La terre est couverte de crimes (...) ; cela empêche-t-il qu’il y ait une cause universelle ? (...) Il y a une suite infinie de vérités, et l’Être infini peut seul comprendre cette suite. (...) Demander pourquoi il y a du mal sur terre, c’est demander pourquoi nous ne vivons pas autant que les chênes. (...) Le grand Être est fort ; mais les émanations sont nécessairement faibles. Servons-nous (...) de la comparaison du soleil. Ses rayons réunis fondent les métaux ; mais quand vous réunissez ceux qu’il a dardés sur le disque de la lune, ils n’excitent pas la plus légère chaleur. Nous sommes aussi nécessairement bornés que le grand Être est nécessairement immense. » —Voltaire, Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche. Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique, affirme que l’authentique miracle est l’ordre du monde, que l’apparition divine en ce monde est la nature des choses et non ce qui semble « surnaturel »: « Un miracle, selon l’énergie du mot, est une chose admirable. En ce cas, tout est miracle. L’ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d’un million de soleils, l’activité de la lumière, la vie des animaux sont des miracles perpétuels. Selon les idées reçues, nous appelons miracle la violation de ces lois divines et éternelles. (…) Plusieurs physiciens soutiennent qu’en ce sens il n’y a point de miracles ; (…) un miracle est la violation des lois mathématiques divines, immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une contradiction dans les termes. Une loi ne peut être à la fois immuable et violée. Mais, une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue par son auteur ? Ils ont la hardiesse de répondre que non. » Enfin, pour Voltaire, la croyance en un Dieu est utile sur le plan moral et social. Il est l’auteur du célèbre alexandrin: On lui attribue aussi cette phrase: « Nous pouvons, si vous le désirez, parler de l’existence de Dieu, mais comme je n’ai pas envie d’être volé ni égorgé dans mon sommeil, souffrez que je donne au préalable congé à mes domestiques ». L’humanisme Dès La Henriade en 1723, toute l’œuvre de Voltaire est un combat contre le fanatisme et l’intolérance: « On entend aujourd’hui par fanatisme une folie religieuse, sombre et cruelle. C’est une maladie qui se gagne comme la petite vérole. » Dictionnaire philosophique, 1764, article « Fanatisme ». Il a en tout cas lutté contre le fanatisme, celui de l’Église catholique romaine comme celui du protestantisme, symboles à ses yeux d’intolérance et d’injustice. Tracts, pamphlets, tout fut bon pour mobiliser l’opinion publique européenne. Il a aussi misé sur le rire pour susciter l’indignation: l’humour, l’ironie deviennent des armes contre la folie meurtrière qui rend les hommes malheureux. Les ennemis de Voltaire avaient d’ailleurs tout à craindre de son persiflage, mais parfois les idées nouvelles aussi. Quand en 1755, il reçoit le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, qui désapprouve l’ouvrage, répond en une lettre aussi habile qu’ironique: « J’ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. […] On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. […] » (Lettre à Rousseau, 30 août 1755) Le « patriarche de Ferney » représente éminemment l’humanisme militant du XVIIIe siècle. Selon Sainte-Beuve, « […] tant qu’un souffle de vie l’anima, il eut en lui ce que j’appelle le bon démon: l’indignation et l’ardeur. Apôtre de la raison jusqu’au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant ». Sa correspondance compte plus de 23 000 lettres connues ainsi qu’un gigantesque Dictionnaire philosophique qui reprend les axes principaux de son œuvre, une trentaine de contes philosophiques et des articles publiés dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Cependant, son théâtre, qui l’avait propulsé au premier rang de la scène littéraire (Mérope, Zaïre et d’autres), ainsi que sa poésie (La Henriade, considérée comme la seule épopée française au XVIIIe siècle) sont oubliés. C’est à Voltaire, avant tout autre, que s’applique ce que Condorcet disait des philosophes du XVIIIe siècle, qu’ils avaient « pour cri de guerre: raison, tolérance, humanité ». La justice Voltaire s’est passionné pour plusieurs affaires et s’est démené afin que justice soit rendue. L’affaire Calas (1762) L’affaire Sirven (1764) L’affaire du chevalier de La Barre (1766) L’affaire Lally-Tollendal (1776) La liberté d’expression L’attachement de Voltaire à la liberté d’expression serait illustré par la très célèbre citation qu’on lui attribue à tort: « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Certains commentateurs (Norbert Guterman, A Book of French Quotations, 1963), prétendent que cette citation est extraite d’une lettre du 6 février 1770 à un abbé Le Riche où Voltaire écrirait: « Monsieur l’abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire ». En fait, cette lettre existe, mais la phrase n’y figure pas, ni même l’idée. (Voir le texte complet de cette lettre à l’article Tolérance). Le Traité de la tolérance auquel est parfois rattachée la citation ne la contient pas non plus. De fait, la citation est absolument apocryphe (elle n’apparaît nulle part dans son œuvre publiée) et trouve sa source en 1906, non dans une citation erronée, mais dans un commentaire de l’auteure britannique Evelyn Hall, dans son ouvrage The Friends of Voltaire, où, pensant résumer la posture de Voltaire à propos de l’auteur d’un ouvrage publié en 1758 condamné par les autorités religieuses et civiles, elle écrivait « “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” was his attitude now » (« “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire” était désormais son attitude »). Les guillemets maladroitement utilisés par Evelyn Hall ont été interprétés comme permettant d’attribuer la déclaration à Voltaire. En 1935, elle déclara « I did not intend to imply that Voltaire used these words verbatim, and should be much surprised if they are found in any of his works » (« Je n’ai pas eu l’intention de suggérer que Voltaire avait utilisé exactement ces mots, et serais extrêmement surprise s’ils se trouvaient dans ses œuvres »),. L’affaire à propos de laquelle Evelyn Hall écrivait concernait la publication par Helvétius en 1758 de De l’Esprit, livre condamné par les autorités civiles et religieuses et brulé. Voici ce que Voltaire écrivait dans l’article « Homme » des Questions sur l’Encyclopédie: « J’aimais l’auteur du livre De l’Esprit. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n’ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu’il débite avec emphase. J’ai pris son parti hautement, quand des hommes absurdes l’ont condamné pour ces vérités mêmes. » Autre passage pertinent: « En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n’en connais point qui aient fait de mal réel. […] Mais paraît-il parmi vous quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous ayez des idées), ou dont l’auteur soit d’un parti contraire à votre faction, ou, qui pis est, dont l’auteur ne soit d’aucun parti: alors vous criez au feu ; c’est un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà un homme abominable, qui a imprimé que si nous n’avions point de mains, nous ne pourrions faire des bas ni des souliers [Helvétius, De l’Esprit, I, 1]: quel blasphème! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s’assemblent, les alarmes se multiplient de collège en collège, de maison en maison ; des corps entiers sont en mouvement et pourquoi ? Pour cinq ou six pages dont il n’est plus question au bout de trois mois. Un livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez pas ». Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, article « Liberté d’imprimer ». La laïcité Même s’il n’utilise pas le mot « laïcité » en tant que tel, Voltaire est, néanmoins, non seulement par ses écrits mais aussi par ses démarches visant à rétablir une justice impartiale dénuée d’intérêt communautaire, un des instigateurs d’un civisme équidistant envers toutes les attitudes religieuses et opinions métaphysiques (athéisme compris), civisme qui allait de pair avec son combat pour la liberté d’expression. À l’époque de Voltaire, en France, critiquer la religion, spécialement le christianisme, reste encore un exercice risqué, car la séparation entre l’Église et de l’État n’existe pas – et que l’Église demeure très puissante. Face à l’idéalisme aveugle et fanatique, Voltaire oppose la figure de l’homme laïc, nommé « Citoyen », vu comme l’ami de tous et du bien public, policé et ne manquant jamais d’humour pour faire valoir le droit commun à s’entre-tolérer au sein d’un État qui défend la culture philosophique et poétique – tout en refusant de promouvoir telle ou telle profession de foi: « Je suis citoyen et par conséquent l’ami de tous ces messieurs [de différentes confessions]. Je ne disputerai avec aucun d’eux ; je souhaite seulement qu’ils soient tous unis dans le dessein de s’aider mutuellement, de s’aimer et de se rendre heureux les uns les autres, autant que des hommes d’opinions si diverses peuvent s’aimer, et autant qu’ils peuvent contribuer à leur bonheur ; ce qui est aussi difficile que nécessaire. Pour cet effet, je leur conseille d’abord de jeter dans le feu (...) la Gazette ecclésiastique, et tous autres libelles qui ne sont que l’aliment de la guerre civile des sots. Ensuite chacun de nos frères, soit théiste, soit turc, soit païen, soit chrétien grec, ou chrétien latin, ou anglican, ou scandinave, soit juif, soit athée, lira attentivement quelques pages des Offices de Cicéron, ou de Montaigne, et quelques fables de La Fontaine. Cette lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde (...). On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission de courir dans le kaaba autour de la pierre noire, ni l’agrément de s’endurcir les genoux devant la Notre-Dame de Lorette, qui est plus noire encore. Dans toutes les disputes qui surviendront, il est interdit de se traiter de chien, quelque colère qu’on soit ; à moins qu’on ne traite d’hommes les chiens, quand ils nous emporteront notre dîner et qu’ils nous morderont, etc., etc., etc. » —Voltaire, Il faut prendre un parti, XXV Discours d’un Citoyen. Voltaire est par conséquent convaincu que les hommes (non parce que formant un groupe homogène, mais parce que liés entre eux par le civisme) peuvent s’allier un minimum pour œuvrer ensemble à la constitution d’une société équilibrée et équitable, même s’ils sont différents, de tous les bords culturels ; Voltaire conçoit donc une morale « civique » ou éthique « citoyenne », universelle et respectant la Liberté. Au doute de Blaise Pascal considérant, dans ses Pensées, qu’il est impossible que les hommes puissent se respecter entre eux hors de la sphère du christianisme (« Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau ; mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? »), Voltaire répond très simplement: « Dans cette seule maxime reçue de toutes les nations: « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. » » (Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, XLII) Théiste, Voltaire n’en condamne pas moins fermement – toujours dans le cadre de sa philosophie laïque – les idéalismes dogmatiques dévalorisant (pour le profit d’une quelconque abstraction ou « Dieu » illusoire) les existences, la vie, la nature et les relations sociales et familiales: « Pensées de Blaise Pascal: « S’il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures. » [Réponse de Voltaire:] Il faut aimer, et très tendrement, les créatures ; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants ; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu’à faire de barbares raisonneurs. » —Voltaire, Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, X. Le végétarisme Voltaire refusait de voir les êtres humains comme supérieurs, de par leur essence, aux autres espèces animales ; cela correspond à son rejet des religions abrahamiques (où l’animal est le plus souvent considéré comme inférieur à l’homme) et de la doctrine des « animaux-machines » du Discours de la méthode de René Descartes – qu’il déteste, et considère comme étant la « vaine excuse de la barbarie » permettant de dédouaner l’homme de tout sentiment de compassion face à la détresse animale. Voltaire commence à s’intéresser avec constance au végétarisme, et à sa défense, vers 1761-1762 environ ; diverses lectures sont en lien avec cette affirmation « pythagoricienne » de la part du philosophe (le terme de « végétarisme » n’existait pas à l’époque): le testament de Jean Meslier, l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, le Traité de Porphyre, touchant l’abstinence de la chair des animaux, ainsi que de nombreux ouvrages sur l’hindouisme (œuvres brahmaniques qui commencent à être traduites en français et étudiées dans les milieux intellectuels européens). Dans ses lettres, Voltaire déclare qu’il « ne mange plus de viande » « ni poisson », se définissant encore plus « pythagoricien » que Philippe de Sainte-Aldegonde, un végétarien qu’il reçut à Ferney, à côté de Genève. Chez Voltaire, le végétarisme n’est jamais justifié selon une logique liée à la santé, mais toujours pour des raisons éthiques: le végétarisme est une « doctrine humaine » et une « admirable loi par laquelle il est défendu de manger les animaux nos semblables ». Prenant comme exemple Isaac Newton, la compassion pour les animaux se révèle pour lui une solide base pour une « vraie charité » envers les hommes, et Voltaire affirme qu’on ne mérite « guère le nom de philosophe » si on ne possède point cette « humanité, vertu qui comprend toutes les vertus ». Dans Le Dialogue du chapon et de la poularde, Voltaire fait dire aux animaux que les hommes qui les mangent sont des « monstres », « monstres » humains qui, d’ailleurs, s’entretuent cruellement, aussi ; le chapon y fait l’éloge de l’Inde où « les hommes ont une loi sainte qui depuis des milliers de siècles leur défend de nous manger » ainsi que des philosophes antiques européens: « Les plus grands philosophes de l’Antiquité ne nous mettaient jamais à la broche. Ils tâchaient d’apprendre notre langage, et de découvrir nos propriétés si supérieures à celle de l’espèce humaine. Nous étions en sûreté comme à l’âge d’or. Les sages ne tuent point les animaux, dit Porphyre ; il n’y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. » —Voltaire, Le Dialogue du chapon et de la poularde. Dans La Princesse de Babylone, Voltaire fait dire à un oiseau que les animaux ont « une âme », tout comme les hommes. Et dans le Traité sur la tolérance (note du chapitre XII), Voltaire rappelle que la consommation de chair animale et de traiter les animaux comme de stricts objets ne sont point des pratiques universelles et qu’« il y a une contradiction manifeste à convenir que Dieu a donné aux bêtes tous les organes du sentiment, et à soutenir qu’il ne leur a point donné de sentiment. Il me paraît encore qu’il faut n’avoir jamais observé les animaux pour ne pas distinguer chez eux les différentes voix du besoin, de la souffrance, de la joie, de la crainte, de l’amour, de la colère, et de toutes les affections ». Dans l’Article « Viande » du Dictionnaire philosophique, Voltaire montre que Porphyre regardait « les animaux comme nos frères, parce qu’ils sont animés comme nous, qu’ils ont les mêmes principes de vie, qu’ils ont ainsi que nous des idées, du sentiment, de la mémoire, de l’industrie. » Le végétarisme de Voltaire s’affirme donc comme une posture philosophique opposée à toute attitude anthropocentrique. Le philosophe ne croit pas que l’humanité soit le centre de la création ou le sommet de la chaîne alimentaire – et que les animaux soient en dessous des nations humaines et comme uniquement « prédestinés » à servir de nourriture aux hommes: « Les moutons n’ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits et mangés, puisque plusieurs nations s’abstiennent de cette horreur ». Dans La Philosophie de l’histoire (chapitre XVII, « de l’Inde »), Voltaire défend la doctrine de la réincarnation des âmes (« métempsychose ») qui prévaut chez les Indiens (ou « Hindous »), dans les terres « vers le Gange », et qui est selon lui un « système de philosophie qui tient aux mœurs » inspirant « une horreur pour le meurtre et pour toute violence ». Cette considération voltairienne se retrouve aussi dans Les Lettres d’Amabed (« Seconde lettre d’Amabed à Shastadid »), où un jeune hindou de Bénarès, élève d’un missionnaire chrétien jésuite qui veut l’évangéliser et lui faire abjurer la foi de ses ancêtres, se désole de voir les Européens, colonisant l’Inde et commettant « des cruautés épouvantables pour du poivre », tuer des petits poulets. Cette posture morale végétarienne est pour Voltaire une occasion de relativiser les certitudes occidentales issues du christianisme, par une universalisation des références niant tout ethnocentrisme et tout anthropocentrisme. C’est aussi une occasion de louer les « Païens » et leur philosophie antique (grecque ou indienne) et de se moquer ouvertement du clergé chrétien et des institutions ecclésiastiques – convaincus de leur exemplarité –, qui font grand cas de détails dogmatiques infimes concernant les croyances à reconnaître ou à condamner (rappel de la haine entre Catholiques, Juifs et Protestants), mais qui refusent d’éduquer les masses à la clémence envers les animaux, sont incapables de promouvoir le végétarisme: « Je ne vois aucun moraliste parmi nous, aucun de nos loquaces prédicateurs, aucun même de nos tartufes, qui ait fait la moindre réflexion sur cette habitude affreuse [« se nourrir continuellement de cadavres » selon Voltaire]. Il faut remonter jusqu’au pieux Porphyre, et aux compatissants pythagoriciens pour trouver quelqu’un qui nous fasse honte de notre sanglante gloutonnerie, ou bien il faut voyager chez les brahmanes ; car, (...) ni parmi les moines, ni dans le concile de Trente, ni dans nos assemblées du clergé, ni dans nos académies, on ne s’est encore avisé de donner le nom de mal à cette boucherie universelle. » —Voltaire, Il faut prendre un parti (Du mal, et en premier lieu de la destruction des bêtes). Opposition à la vivisection Voltaire s’insurgea contre les pratiques de vivisection de son temps (l’expérimentation sur des animaux se généralisant avec le dogme des « animaux-machines » de Descartes, ainsi que dans les séminaires jansénistes): « Des barbares saisissent ce chien, qui l’emporte prodigieusement sur l’homme en amitié ; ils le clouent sur une table, et ils le dissèquent vivant pour te montrer les veines mézaraïques. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste ; la nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu’il ne sente pas ? A-t-il des nerfs pour être impassible ? Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature. » À propos de Voltaire et Rousseau « Le public a toujours pris plaisir à faire aller de pair ces deux hommes à jamais célèbres. Tous les deux, avec de si grands moyens, se sont proposé le même but, le bonheur du genre humain », écrit dès 1818 Bernardin de Saint-Pierre, l’ami de Rousseau, dans son Parallèle de Voltaire et de J.-J. Rousseau, premier d’une suite innombrable. Tout oppose les deux grandes figures des Lumières que la Révolution française a installé l’un à côté de l’autre au Panthéon, Voltaire en 1791, Rousseau en 1794. Voltaire est un fils de bourgeois parisien, sujet d’une monarchie absolue. Il reçoit une éducation classique dans le meilleur collège de la capitale. Son esprit se forme dans la fréquentation de la société du Temple et de la cour de Sceaux. Il aime l’argent, le luxe, le monde, le théâtre. Il fréquente les princes et les rois. Persuadé que la liberté d’esprit est inséparable de l’aisance matérielle, il devient riche et mène à Ferney une vie de seigneur. Il se pense en chef de parti, en responsable du clan philosophique. Son objectif est de faire pénétrer peu à peu les Lumières au sommet de l’État. C’est un écrivain engagé. Il est pessimiste mais d’humeur gaie. Déiste, il hait la religion chrétienne. Extraverti, il a horreur de l’introspection et parle peu de lui dans ses Mémoires. Esprit précis et positif, son arme est l’ironie et c’est à l’esprit qu’il s’adresse. Rousseau est un fils d’horloger genevois, citoyen d’une république. Il est autodidacte et campagnard. Il aime la vie simple, le travail humble, la solitude, la nature. S’il bénéficie, comme beaucoup de gens de lettres, de la protection des grands (prince de Conti, maréchal de Luxembourg), il ne veut pas des bienfaits dont la société est prête à l’accabler. Il reste pauvre, persuadé qu’il se met moralement du bon côté et gagne son pain en copiant de la musique. Chez lui, tout est adhésion individuelle à une doctrine élaborée par un individu unique. Ce n’est pas un écrivain engagé. Il est foncièrement optimiste mais d’humeur ombrageuse. Protestant de Genève, il reste toujours chrétien par le cœur, sinon par le dogme et la conduite. Égotiste, il se livre intimement dans ses Confessions. Il a l’âme poétique, rêveuse, aisément émue. Son arme, c’est l’éloquence, et c’est au sentiment qu’il parle. Les deux hommes ont entretenu longtemps des relations courtoises avant leur rupture en 1760. Rousseau, qui admire Voltaire, lui envoie en 1755 son Discours sur l’inégalité qui fait suite à son Discours sur les sciences et les arts de 1750. Il lui rend « l’hommage que nous vous devons tous comme à notre chef ». La critique de la civilisation, la dénonciation du « luxe », de l’inégalité sociale et de la propriété, l’exaltation du primitivisme de Rousseau ne peuvent que rencontrer l’incompréhension de Voltaire. Mais Rousseau participe au combat philosophique, c’est un ami de Diderot et d’Alembert, un collaborateur de l’Encyclopédie. Voltaire lui répond ironiquement: « J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie (…) On n’a jamais tant employé d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre ». Rousseau répond sans acrimonie. Leur échange de lettres est publié dans le Mercure de 1755. En 1756, lorsque Voltaire envoie à Rousseau son Poème sur le désastre de Lisbonne, l’incompréhension est cette fois du côté de ce dernier. Il répond: « Rassasié de gloire et désabusé des vaines grandeurs, vous vivez libre au sein de l’abondance: vous ne trouvez pourtant que mal sur terre ; et moi, homme obscur, pauvre, tourmenté d’un mal sans remède, je médite avec plaisir dans ma retraite et trouve que tout est bien. D’où viennent ces contradictions apparentes ? Vous l’avez-vous-même expliqué: vous jouissez, moi j’espère, et l’espérance adoucit tout ». Voltaire ne répond pas sur le fond. Dans les Confessions, Rousseau dit que la véritable réponse lui fut donnée avec Candide (1759). En 1758, à la suite de la parution de l’article de D’Alembert, « Genève », dans l’Encyclopédie, Rousseau publie sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Il rompt à cette occasion avec Diderot, l’ami de ses débuts et avec les Encyclopédistes. Visant Voltaire qui milite pour faire autoriser la comédie à Genève (elle le sera en 1783), il reprend la thèse de son premier Discours: le théâtre à Genève favoriserait le luxe, accroîtrait l’inégalité, altérerait la liberté et affaiblirait le civisme. Pour Voltaire, nier la valeur morale et humaine du théâtre, c’est nier l’évidence. Mais il ne veut pas répondre. « Moi », écrit-il à d’Alembert, « je fais comme celui qui pour toute réponse à des arguments contre le mouvement se mit à marcher. Jean-Jacques démontre qu’un théâtre ne peut convenir à Genève, et moi j’en bâtis un (Il s’agit de l’ouverture d’une salle de spectacle dans son château de Tourney en 1760) ». L’affrontement est cependant resté courtois jusqu’à la véritable déclaration de guerre (publiée plus tard dans les Confessions, livre X) que Rousseau adresse à Voltaire le 17 juin 1760: « Je ne vous aime point, Monsieur ; vous m’avez fait tous les maux qui pouvaient m’être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève, pour le prix de l’asile que vous y avez reçu ; vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux ; c’est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable ; c’est vous qui me ferez mourir en terre étrangère (…) Je vous hais, enfin, puisque vous l’avez voulu ; mais je vous hais en homme plus digne de vous aimer si vous l’aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous il n’y reste que l’admiration qu’on ne peut refuser à votre beau génie, et l’amour de vos écrits ». Cette fois, Voltaire est ulcéré: « Une telle lettre de la part d’un homme avec qui je ne suis pas en commerce me paraît merveilleusement folle, absurde et offensante », écrit-il à Mme du Deffand, « Comment un homme qui a fait des comédies peut-il me reprocher d’avoir fait des spectacles chez moi en France ? Pourquoi me fait-il l’outrage de me dire que Genève m’a donné un asile ? Je n’ai pas assurément besoin d’asile, et j’en donne quelquefois (…) il imprime que je suis le plus adroit et le plus violent de ses persécuteurs. Je ne crois pas qu’on puisse faire à un homme injure plus atroce que de l’appeler persécuteur ». À la parution en 1761 du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloise (l’un des grands succès d’édition du siècle), il se venge dans un pamphlet, trouvant « sot, bourgeois, impudent, ennuyeux » ce récit en six tomes qui ne contient que « trois à quatre pages de faits et environ mille de discours moraux ». Les choses sérieuses commencent en 1762, lorsque, Rousseau décrété de prise de corps après la publication de ses grands ouvrages, le Contrat social et l’Émile, doit s’enfuir de France. À Genève, l’auteur est menacé d’arrestation s’il vient dans la ville et ses livres sont brulés. Pour Rousseau, malade, déprimé, ces persécutions sont le résultat, direct ou indirect, de l’influence dont jouit Voltaire à Genève comme à Paris. Dans les Lettres sur la Montagne, il accuse Voltaire d’être l’auteur du Sermon des cinquante, libelle anonyme profondément antichrétien paru en 1762, d’être complice de ses persécuteurs, de préférer au raisonnement la plaisanterie, de publier des ouvrages abominables et de ne pas croire en Dieu. Voltaire répond par un libelle anonyme (Rousseau n’a jamais su qu’il en était l’auteur), le Sentiment des Citoyens où il suggère l’exécution de Rousseau, révélant que l’auteur de l’Émile a fait porter et déposer ses cinq enfants (qu’il a eus avec Thérèse Levasseur) aux Enfants-trouvés: « si on châtie légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vil séditieux ». Il tient Rousseau pour un « déguisé en saltimbanque » misérable et estime justifiées les plus basses attaques (les problèmes urinaires de Rousseau sont le fruit de ses « débauches »), au point de perdre tout sens de la mesure (ainsi dans le poème burlesque La Guerre civile de Genève où il s’acharne particulièrement contre Rousseau et sa compagne). Animé par la rage, il le poursuit jusque dans son exil en Angleterre, faisant paraître anonymement dans les journaux de Londres la Lettre au Docteur Jean-Jacques Pansophe (1760) pour le brouiller avec ses hôtes. Désormais, Voltaire va mener contre Rousseau une campagne d’insultes et de railleries, même s’il écrit en 1767: « Pour moi, je ne le regarde pas comme un fou. Je le crois malheureux à proportion de son orgueil: c’est-à-dire qu’il est l’homme du monde le plus à plaindre ». Voltaire et les femmes La vie et l’œuvre de Voltaire dévoilent une place intéressante accordée aux femmes. Plusieurs de ses pièces sont entièrement dédiées aux vies exceptionnelles de femmes de pouvoir de civilisations orientales. Cette vision des femmes au pouvoir peut éclairer l’attachement de Voltaire à une femme savante comme Émilie du Châtelet. En 1713, jeune secrétaire d’ambassade à La Haye, Voltaire s’éprend d’Olympe Dunoyer (ou du Noyer), alias Pimpette. C’est très vite le grand amour. La mère de cette jeune fille, une huguenote française exilée en Hollande, haïssant la monarchie française, va porter plainte à l’ambassadeur. Furieux, craignant un scandale, celui-ci renvoie Voltaire en France. C’est largement grâce aux femmes que Voltaire se faufile dans la haute société de la Régence. Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine réunissait dans son château de Sceaux une coterie littéraire qui complotait contre le duc Philippe d’Orléans (1674-1723). On y poussa Voltaire à exercer sa verve railleuse contre le Régent, ce qui valut à l’auteur un début de notoriété, et onze mois de Bastille. Les fréquentations féminines de Voltaire ne sont pas toutes de nature littéraire: c’est surtout pour favoriser ses affaires qu’il séduit l’épouse d’un président à mortier au parlement de Rouen, le marquis de Bernières, qu’il associe à ses spéculations, et aux ruses coûteuses déployées pour éditer La Henriade en dépit de la censure royale. Grâce au succès de sa première tragédie Œdipe, Voltaire fait la connaissance de la duchesse de Villars, dont il s’éprend, mais sans que la réciproque soit vraie ; reste, là aussi, l’introduction dans le cercle aristocratique éclairé gravitant autour de Charles Louis Hector, maréchal de Villars, qui recevait en son château de Vaux (Vaux-le-Vicomte). Quant à l’amour, Voltaire s’en dit « guéri », au profit de l’amitié, qu’il cultivera effectivement toute sa vie. Voltaire a des liaisons éphémères avec quelques actrices, notamment Suzanne de Livry et Adrienne Lecouvreur, mais de santé précaire, il s’est toujours préservé des excès, y compris amoureux. La relation avec Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet-Lomont est en revanche plus sérieuse. La traductrice de Newton est très douée pour les lettres autant que pour les sciences ou la philosophie. Elle est mariée, mais le marquis du Châtelet est un éternel absent, et Émilie, que tout passionne, tombe amoureuse sans mesure du prestigieux poète, qui lui est présenté en 1733, et qu’elle aimera jusqu’à sa mort, seize ans plus tard. Cirey (Cirey-sur-Blaise), le château de famille des Châtelet abrite leurs amours ; Voltaire en entreprend la restauration et l’agrandissement à ses frais. Leur vie est quasi maritale, mais des plus mouvementée ; les échanges intellectuels intenses: Voltaire qui, jusque-là s’était consacré au « grand genre », la tragédie et le poème épique, opte résolument pour ce qui fera la particularité de son œuvre: le combat politique et philosophique contre l’intolérance. Une relation fusionnelle, donc, autant que studieuse et féconde. C’est par une tromperie philosophique que s’engagera la fin d’une l’idylle de dix ans: la marquise renonce au matérialisme newtonien pour lui préférer le déterminisme optimiste de Leibniz, ce à quoi Voltaire ne saurait consentir. Moins sentimentale désormais, l’alliance persiste malgré tout. La marquise sauve plusieurs fois Voltaire des conséquences de ses insolences, et Voltaire éponge parfois les colossales dettes de jeu d’Émilie. La situation se complique singulièrement lorsque Mme du Châtelet s’éprend du marquis de Saint-Lambert (Jean-François de Saint-Lambert). Émilie est enceinte, et Voltaire concocte un stratagème pour que le mari de la marquise se croie le père de l’enfant. Émilie meurt peu après l’accouchement, laissant Voltaire désespéré: il devait à Émilie du Châtelet ses années les plus heureuses. En 1745, Voltaire devient, à cinquante ans, l’amant de sa nièce (l’une des deux filles de sa sœur aînée) Marie-Louise Denis. Voltaire a soigneusement dissimulé cette passion incestueuse et « adultère » (il est toujours l’amant en titre de la très jalouse Mme du Châtelet). Mme Denis n’est du reste pas des plus fidèles, et ne dédaigne pas de profiter de la fortune (considérable) du poète. Le couple ne cohabite vraiment qu’à la mort de Mme du Châtelet en 1749. Sauf pendant l’épisode prussien, Voltaire et sa nièce ne se sépareront plus. Marie-Louise Denis va régner sur le ménage de Voltaire jusqu’à sa mort. Bourgeoise, elle sait conduire une maisonnée, ce dont ne se souciait pas Mme du Châtelet. Mais elle ne sera jamais, comme elle, la confidente et la conseillère de ses travaux. Mme d’Épinay a fait de Mme Denis un portrait caricatural lors de sa visite aux Délices en novembre 1757: « La nièce de M. de Voltaire est à mourir de rire, c’est une petite grosse femme, toute ronde, d’environ cinquante ans, femme comme on ne l’est point, laide et bonne, menteuse sans le vouloir et sans méchanceté ; n’ayant pas d’esprit et en paraissant avoir ; criant, décidant, politiquant, versifiant, déraisonnant, et tout cela sans trop de prétention et surtout sans choquer personne, ayant par-dessus tout un petit vernis d’amour masculin qui perce à travers la retenue qu’elle s’est imposée. Elle adore son oncle, en tant qu’oncle et en tant qu’homme. Voltaire la chérit, s’en moque, la révère: en un mot cette maison est le refuge de l’assemblage des contraires et un spectacle charmant pour les spectateurs ». Mais le portrait qu’a laissé d’elle Van Loo montre un visage bien dessiné, un regard agréable et une certaine sensualité. « Prenez soin de maman… » aurait été l’une des dernières paroles de Voltaire mourant. Voltaire et l’homosexualité Dans le Dictionnaire Philosophique, Voltaire qualifie l’homosexualité d’« attentat infâme contre la nature » (encore faut-il lire la phrase entière, « Comment s’est-il pu faire qu’un vice, destructeur du genre humain s’il était général ; qu’un attentat infâme contre la nature, soit pourtant si naturel ? »), d’« abomination dégoûtante », ou encore de « turpitude ». Il écrit notamment: « Sextus Empiricus & d’autres, ont beau dire que la pédérastie était recommandée par les loix de la Perse ; qu’ils citent le texte de la loi, qu’ils montrent le Code des Persans ; & s’ils le montrent, je ne le croirai pas encor, je dirai que la chose n’est pas vraye, par la raison qu’elle est impossible ; non, il n’est pas dans la nature humaine de faire une loi qui contredit, & qui outrage la nature, une loi qui anéantirait le genre humain si elle était observée à la lettre ». Voltaire refuse donc que l’homosexualité (ou plus précisément: la « pédérastie ») soit une norme sociale « observée à la lettre » et généralisée: on ne peut pas en faire une loi naturelle – puisqu’elle n’est pas universellement partagée entre les êtres humains – et que l’hétérosexualité est de toute évidence majoritaire et nécessaire au renouvellement de l’espèce. À noter cependant dans le Traité de Métaphysique, 1735, chapitre IX, cette phrase: « L’adultère et l’amour des garçons seront permis chez beaucoup de nations: mais vous n’en trouverez aucune dans laquelle il soit permis de manquer à sa parole ; parce que la société peut bien subsister entre des adultères et des garçons qui s’aiment, mais non pas entre des gens qui se feraient une gloire de se tromper les uns les autres ». Daniel Borrillo et Dominique Colas, dans leur ouvrage L’Homosexualité de Platon à Foucault, estiment que « Voltaire aborde la question dans son dictionnaire philosophique sous le chapitre Amour nommé socratique d’une manière si légère et si violente qu’il semble avoir été écrit par un théologien du Moyen Âge plutôt que par un philosophe de la Raison ». Voltaire ne fait toutefois aucune référence à la Bible, à la différence de l’article « Sodomie » de l’Encyclopédie paru en 1765 et lui, très « théologique ». Par ailleurs, l’article du Dictionnaire philosophique a été très développé dans les Questions sur l’Encyclopédie (à partir de 1770). Selon Roger-Pol Droit, « Pareil acharnement est d’autant plus curieux qu’il est difficile de l’imputer au climat de l’époque (…). La plupart des philosophes des Lumières sont d’ailleurs plus que tolérants envers les partenaires de même sexe. Au contraire, Voltaire n’a cessé de juger ces mœurs contre nature, dangereuses, infâmes ». Mais c’est surtout l’homosexualité – conçue comme « pédérastie » qui est vivement condamnée par Voltaire, le philosophe craignant des abus sexuels sur mineurs – si les références à l’Antiquité gréco-romaine viennent à justifier, à tort et à travers, des « amours socratiques » où un pédagogue a des relations sexuelles avec les jeunes adolescents qui sont ses élèves ; en effet: « Je ne peux souffrir qu’on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. On cite le législateur Solon, parce qu’il a dit en deux mauvais vers, Tu chériras un beau garçon,/ Tant qu’il n’aura barbe au menton. (...) Sextus Empiricus qui doutait de tout, devait bien douter de cette jurisprudence. S’il vivait de nos jours, & qu’il vît deux ou trois jeunes Jésuites abuser de quelques écoliers, aurait-il droit de dire que ce jeu leur est permis par les constitutions d’Ignace de Loyola ? » —Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, Amour nommé socratique. Voltaire et l’esclavagisme Voltaire était fondamentalement opposé à l’image du « bon sauvage » des pays équatoriaux ou que l’homme est « bon » à l’état de nature, image promue par Jean-Jacques Rousseau ou Denis Diderot – avec, par exemple, son Supplément au voyage de Bougainville (« innocence » du « primitif » rappelant d’ailleurs l’image biblique du Jardin d’Eden, lorsqu’Adam et Eve n’ont point encore goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal). Voltaire considère que les hommes noirs, des pays équatoriaux, sont des « animaux humains » comme le sont aussi les hommes blancs, et que, si les Africains sont victimes de l’Européen, ce n’est pas parce que l’Européen est corrompu par la société – tandis que les Africains ne le sont point, comme vierges de toute culpabilité, mais bien parce que les chefs nègres collaborent activement avec les marchands européens pour leur vendre des esclaves africains ; ainsi, Voltaire ne cherche pas à dédouaner de leur responsabilité les peuples africains dans la traite négrière (en les infantilisant ou en clamant qu’ils sont trop naïfs pour ne pas savoir ce qu’ils font, comme incapables de distinguer le bien et le mal), et écrit, dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations: « Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l’acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » Ce refus de faire des Africains un peuple essentiellement « irresponsable », démontre que Voltaire s’écarte de tout discours justifiant une essence humaine, discours permettant de soutenir qu’il y a des hommes qui, par leur seule naissance, sont destinés à être dominés et oppressés, et d’autres – à dominer et à oppresser: pour Voltaire, c’est parce que les Africains noirs n’ont pas pitié des leurs – et ne les protègent pas des abus, que les Européens peuvent les asservir sans problème par l’esclavage, et non parce que les hommes noirs sont par leur nature même « naïfs » – abusés malgré eux, comme le prétendent les Européens croyant au « bon sauvage ». Voltaire a fermement condamné l’esclavagisme. Le texte le plus célèbre est la dénonciation des mutilations de l’esclave de Surinam dans Candide mais son corpus comporte plusieurs autres passages intéressants. Dans le « Commentaire sur l’Esprit des lois » (1777), il félicite Montesquieu d’avoir jeté l’opprobre sur cette odieuse pratique. Il s’est également enthousiasmé pour la libération de leurs esclaves par les quakers de Pennsylvanie en 1769. De la même manière le fait qu’il considère en 1771 que « de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste », guerre que des esclaves ont menée contre leurs oppresseurs, plaide assurément en faveur de la thèse d’un Voltaire antiesclavagiste. Lors des dernières années de sa vie, en compagnie de son avocat et ami Christin, il a lutté pour la libération des « esclaves » du Jura qui constituaient les derniers serfs présents en France et qui, en vertu du privilège de la main-morte, étaient soumis aux moines du chapitre de Saint-Claude (Jura). C’est un des rares combats politiques qu’il ait perdu ; les serfs ne furent affranchis que lors de la Révolution française, dont Voltaire inspira certains des principes. À tort, on a souvent prétendu que Voltaire s’était enrichi en ayant participé à la traite des Noirs. On invoque à l’appui de cette thèse une lettre qu’il aurait écrite à un négrier de Nantes pour le remercier de lui avoir fait gagner 600 000 livres par ce biais. En fait, cette prétendue lettre est un faux. Voltaire, le racisme et l’antisémitisme Pour Christian Delacampagne, « Voltaire, il faut s’y résoudre, est à la fois polygéniste, raciste et antisémite », car, animé par ce qu’il considère comme l’obscurantisme religieux, « il poursuit d’une même haine le christianisme et le judaïsme. Et comme il lui faut à tout prix se démarquer des doctrines défendues par ces deux religions, il se croit obligé d’attaquer avec vigueur le monogénisme » (selon quoi Adam et Ève sont le couple humain unique et originel). Ainsi, dans l’introduction de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, Voltaire écrit: « Il n’est permis qu’à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Hottentots, les Chinois, les Américains, soient des races entièrement différentes… Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent point cette différence à leur climat, c’est que les nègres et les négresses, transplantés dans des pays les plus froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce… » [non neutre]Cet extrait doit être lu avec les références du XVIIIe siècle: le mot « race » à cette époque n’a pas du tout le sens que lui a donné le XIXe siècle – et n’a aucune connotation péjorative (du fait que l’eugénisme scientifique n’est pas encore présent au XVIIIe siècle), ainsi que le terme « intelligence ». « Race » désigne davantage un ca-RAC-tère, un genre, un type, et « intelligence » les qualités intellectuelles propres. [non neutre]Bien avant Darwin et sa théorie de l’évolution, Voltaire remet donc totalement en question le dogme abrahamique consistant à affirmer que l’espèce humaine, en son intégralité, vient d’un seul couple originel (Adam et Ève) créé par Jéhovah, mais considère, au contraire, que l’humanité – à la manière de toutes les autres espèces animales –, est issue de différentes branches distinctes qui ont évolué de manière multiple, en lien étroit avec la géographie et leur hérédité physique particulière (c’est ce que défend aussi Montesquieu, qui prétend, dans son Esprit des lois, que les cultures humaines se constituent différemment selon le climat et la géographie où elles s’épanouissent). D’après la revue catholique traditionaliste, La Nef, l’attitude de Voltaire envers les Juifs, notamment dans certains passages du Dictionnaire Philosophique ou des « Essais sur les Mœurs » pose la question de son antisémitisme, exprimé à de nombreuses reprises. Dans l’article « Tolérance », il écrit: « Il est certain que la nation juive est la plus singulière qui jamais ait été dans le monde. Quoiqu’elle soit la plus méprisable aux yeux de la politique, elle est, à bien des égards, considérable aux yeux de la philosophie.. » Il écrit aussi: « Si ces Ismaélites [les Arabes, qui, selon la Bible, descendent d’Ismaël] ressemblaient aux Juifs par l’enthousiasme et la soif du pillage, ils étaient prodigieusement supérieurs par le courage, par la grandeur d’âme, par la magnanimité […] Ces traits caractérisent une nation. On ne voit au contraire, dans toutes les annales du peuple hébreu, aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l’hospitalité, ni la libéralité, ni la clémence. Leur souverain bonheur est d’exercer l’usure avec les étrangers ; et cet esprit d’usure, principe de toute lâcheté, est tellement enracinée dans leurs cœurs, que c’est l’objet continuel des figures qu’ils emploient dans l’espèce d’éloquence qui leur est propre. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages dont ils peuvent s’emparer. Ils égorgent les vieillards et les enfants ; ils ne réservent que les filles nubiles ; ils assassinent leurs maitres quand ils sont esclaves ; ils ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs: ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle science, nul art perfectionné dans aucun temps, chez cette nation atroce. » —Essais sur les Mœurs, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. 6-De l’Arabie et de Mahomet, p. 231.[réf. nécessaire]Voltaire méprise le judaïsme qu’il conçoit comme un idéalisme fanatique et dogmatique – source du christianisme et de l’islam. Mais il évacue toute idée de détestation raciale ou de haine perverse. Voltaire tolère, mais Voltaire combat par les idées. Pour Bernard Lazare (+ 1903), « si Voltaire fut un ardent judéophobe, les idées que lui et les encyclopédistes représentaient n’étaient pas hostiles aux Juifs, puisque c’étaient des idées de liberté et d’égalité universelle ». L’historien de la Shoah, Léon Poliakov fait de Voltaire, « le pire antisémite français du XVIIIe siècle ». Selon lui, ce sentiment se serait aggravé dans les quinze dernières années de la vie de Voltaire. Il paraîtrait alors lié au combat du philosophe contre l’Église. Certes, Voltaire déteste les Hébreux de l’Ancien Testament qui prétendent être le peuple élu: nul peuple n’est tel pour lui. Mais Voltaire n’appelle pas sur les juifs la persécution raciale à la différence des antisémites du XIXe siècle et du XXe siècle. Au contraire, les critiques de Voltaire envers le judaïsme (ou envers le christianisme, l’islam, le manichéisme, le polythéisme et l’athéisme) servent de point d’appui pour glorifier une éthique universelle, la tolérance et le respect au-delà des doctrines métaphysiques: « Vous [les Israélites] me paraissez les plus fous de la bande [hommes se disputant pour leurs opinions religieuses respectives, athées compris]. Les Cafres, les Hottentots, les nègres de Guinée sont des êtres beaucoup plus raisonnables et plus honnêtes que vos Juifs les ancêtres. Vous l’avez emporté sur toutes les nations en fables impertinentes, en mauvaise conduite, et en barbarie. (...) Pourquoi seriez-vous une puissance ? (...) Continuez surtout à être tolérants ; c’est le vrai moyen de plaire à l’Être des êtres, qui est également le père des Turcs et des Russes, des Chinois et des Japonais [deux couples de nations voisines souvent en conflit], des nègres, des tannés et des jaunes, et de la nature entière. » —Voltaire, Il faut prendre un parti ; XXIV Discours d’un théiste. Pour Pierre-André Taguieff, « Les admirateurs inconditionnels de la « philosophie des Lumières », s’ils prennent la peine de lire le troisième tome (De Voltaire à Wagner) de l’Histoire de l’antisémitisme, paru en 1968, ne peuvent que nuancer leurs jugements sur des penseurs comme Voltaire ou le baron d’Holbach, qui ont reformulé l’antijudaïsme dans le code culturel « progressiste » de la lutte contre les préjugés et les superstitions ». D’autres notent que l’existence de passages contradictoires dans l’œuvre de Voltaire ne permet pas de conclure péremptoirement au racisme ou à l’antisémitisme du philosophe. « L’antisémitisme n’a jamais cherché sa doctrine chez Voltaire », indique ainsi Roland Desné, qui écrit: « Il est non moins vrai que ce n’est pas d’abord chez Voltaire qu’on trouve des raisons pour combattre l’antisémitisme. Pour ce combat, il y a d’abord l’expérience et les raisons de notre temps. Ce qui ne signifie pas que Voltaire, en compagnie de quelques autres, n’ait pas sa place dans la lointaine genèse de l’histoire de ces raisons-là ». Voltaire et l’islam Déiste, Voltaire était attiré par la rationalité apparente de l’islam, religion sans clergé, sans miracle et sans mystères. Reprenant la thèse déiste de Henri de Boulainvilliers, il apercevait dans le monothéisme musulman une conception plus rationnelle que celle de la Trinité chrétienne. Dans sa tragédie Le Fanatisme ou Mahomet, Voltaire considère Mahomet comme un « imposteur », un « faux prophète », un « fanatique » et un « hypocrite »,. Toutefois selon Pierre Milza, la pièce a surtout été « un prétexte à dénoncer l’intolérance des chrétiens – catholiques de stricte observance, jansénistes, protestants – et les horreurs perpétrées au nom du Christ ». Pour Voltaire, Mahomet « n’est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main ». Voltaire écrira en 1742 dans une lettre à M. de Missy: « Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet, le prieur des Jacobins mettant le poignard à la main de Jacques Clément ». Plus tard, après avoir lu Henri de Boulainvilliers et Georges Sale, il reparle de Mahomet et de l’islam dans un article « De l’Alcoran et de Mahomet » publié en 1748 à la suite de sa tragédie. Dans cet article, Voltaire maintient que Mahomet fut un « charlatan », mais « sublime et hardi » et écrit qu’il n’était en outre pas un illettré. Puisant aussi des renseignements complémentaires dans la Bibliothèque orientale d’Herbelot, Voltaire, selon René Pomeau, porte un « jugement assez favorable sur le Coran » où il trouve, malgré « les contradictions, les absurdités, les anachronismes », une « bonne morale » et « une idée juste de la puissance divine » et y « admire surtout la définition de Dieu ». Ainsi, il « concède désormais » que « si son livre est mauvais pour notre temps et pour nous, il était fort bon pour ses contemporains, et sa religion encore meilleure. Il faut avouer qu’il retira presque toute l’Asie de l’idolâtrie » et qu’« il était bien difficile qu’une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre ». Il considère que « ses lois civiles sont bonnes ; son dogme est admirable en ce qu’il a de conforme avec le nôtre » mais que « les moyens sont affreux ; c’est la fourberie et le meurtre ». Après avoir estimé plus tard qu’il avait fait dans sa pièce Mahomet « un peu plus méchant qu’il n’était », c’est dans la biographie de Mahomet rédigée par Henri de Boulainvilliers que Voltaire puise et emprunte, selon René Pomeau, « les traits qui révèlent en Mahomet le grand homme ». Dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des Nations dans lequel il consacre, en historien cette fois, plusieurs chapitres à l’islam,, Voltaire « porte un jugement presque entièrement favorable » sur Mahomet qu’il qualifie de « poète », de « grand homme » qui a « changé la face d’une partie du monde », tout en nuançant la sincérité de Mahomet qui imposa sa foi par « des fourberies nécessaires ». Il considère que si « le législateur des musulmans, homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses armes », sa religion devint cependant « indulgente et tolérante ». Cependant, Voltaire est fondamentalement déiste et dénonce clairement l’Islam et les religions abrahamiques en général. Profitant de la définition du théisme dans son Dictionnaire philosophique, il jette dos à dos Islam et Christianisme: « [le théiste] croit que la religion ne consiste ni dans les opinions d’une métaphysique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans l’adoration et dans la justice. Faire le bien, voilà son culte ; être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le mahométan lui crie: « Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage à La Mecque! » « Malheur à toi, lui dit un récollet, si tu ne fais pas un voyage à Notre-Dame de Lorette! » Il rit de Lorette et de La Mecque ; mais il secourt l’indigent et il défend l’opprimé. » Néanmoins, dans un contexte français marqué par l’emprise liberticide du catholicisme sur la société française, Voltaire nuance parfois son jugement sur l’Islam, comprenant qu’il peut s’agir d’une arme redoutable contre le clergé catholique. Ses propos sur Mahomet lui valent d’ailleurs les foudres des jésuites et notamment de l’abbé Claude-Adrien Nonnotte,. Dans l’Essai sur les mœurs, Voltaire se montre également « plein d’éloges pour la civilisation musulmane et pour l’islam en tant que règle de vie ». Il compare ainsi le « génie du peuple arabe » au « génie des anciens Romains » et écrit que « dans nos siècles de barbarie et d’ignorance, qui suivirent la décadence et le déchirement de l’Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes: astronomie, chimie, médecine », et que « dès le second siècle de Mahomet, il fallut que les chrétiens d’Occident s’instruisissent chez les musulmans ». Il y a donc deux représentations de Mahomet chez Voltaire, l’une religieuse selon laquelle Mahomet est un prophète comme les autres qui exploite la naïveté des gens et répand la superstition et le fanatisme, mais qui prêche l’unicité de Dieu et l’autre, politique, selon laquelle Mahomet est un grand homme d’État comme Alexandre le Grand et un grand législateur qui a fait sortir ses contemporains de l’idolâtrie. Ainsi selon Diego Venturino la figure de Mahomet est ambivalente chez Voltaire, qui admire le législateur, mais déteste le conquérant et le pontife, qui a établi sa religion par la violence. Pour Dirk van der Cruysse l’image plus nuancée de Mahomet dans l’Essai sur les mœurs est nourrie en partie par « l’antipathie que Voltaire éprouvait à l’égard du peuple juif ». Selon lui, les « inefficacités de la révélation judéo-chrétienne » comparées au « dynamisme de l’islam » soulève chez Voltaire une « admiration sincère mais suspecte ». Van der Cruysse considère le discours voltairien sur Mahomet comme un « tissu d’admiration et de mauvaise foi mal dissimulé » qui vise moins le prophète lui-même que les spectres combattus par Voltaire à savoir le « fanatisme et l’intolérance du christianisme et du judaïsme ». Ce qu’il ne faut donc pas perdre de vue, c’est que Voltaire admire le Mahomet conquérant, réformateur et législateur, qu’il apprécie des caractéristiques du dogme mais seulement quand il les compare à d’autres, et qu’enfin il exècre l’Islam en tant que religion, et, dans les textes qui montrent l’éloge à Mahomet, on lit aussi une dénonciation virulente de la barbarie, du fanatisme, et de l’obscurantisme. Voltaire et le christianisme Le christianisme, dont il souhaite la disparition, n’est pour Voltaire que superstition et fanatisme. C’est dans ses lettres qu’il est le plus explicite: en 1767, il écrit à Frédéric II: « Tant qu’il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde, et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde »; et au Marquis d’Argence: le christianisme est "la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre",. Toute sa vie, Voltaire a répandu des écrits anti-chrétiens, tout en affirmant qu’il était étranger à ces publications (ce qui en général ne trompait personne, mais lui évitait des poursuites personnelles) et en feignant à Ferney la pratique religieuse, par exemple en faisant ses pâques en 1768 (ses bons paysans seraient « effrayés », explique-t-il dans ses lettres, s’ils le voyaient agir autrement qu’eux, s’ils pouvaient imaginer qu’il pense différemment). Ses attaques contre la croyance et les pratiques du christianisme, ses railleries sur la Bible, surtout l’Ancien Testament (dont il est un lecteur assidu), sont le propre de ce qu’on a appelé « l’esprit voltairien » et ont suscité contre lui des haines profondes. Elles se font en effet toujours sous une forme particulièrement moqueuse envers les croyants, ainsi dans Le Dîner du comte de Boulainvilliers (1767), son réquisitoire contre la messe et la communion: « Un gueux qu’on aura fait prêtre, un moine sortant des bras d’une prostituée, vient pour douze sous, revêtu d’un habit de comédien, me marmotter dans une langue étrangère ce que vous appelez une messe, fendre l’air en quatre avec trois doigts, se courber, se redresser, tourner à droite et à gauche, par devant et par derrière, et faire autant de dieux qu’il lui plaît, les boire et les manger, et les rendre ensuite à son pot de chambre! » Mais Voltaire peut être plus clément dans sa critique du christianisme, en écrivant par exemple dans sa Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, que « le christianisme n’enseigne que la simplicité, l’humanité, la charité ; vouloir le réduire à la métaphysique, c’est en faire une source d’erreurs ». La condamnation du christianisme chez Voltaire porte donc davantage sur l’idéalisme exclusif et l’aspect rituel (ou superstitieux) qui peut s’en emparer (et le desservir) – que sur les enseignements de Jésus-Christ en eux-mêmes. Voltaire préfère prendre le parti des opprimés et cultiver une philosophie à contre-courant de toutes idées et comportements préconçus – pour permettre à la Raison sensible de s’épanouir librement, plutôt que défendre et établir des systèmes de pensées abstraits sans lien avec la réalité vécue: un philosophe ne doit pas devenir un « chef de parti » enfermant son intellect dans une doctrine, même s’il prend parti. C’est surtout l’absurdité conceptualisée et érigée en dogme – et l’absence d’empathie des hommes, qui pousse Voltaire à dénoncer le christianisme et à se moquer des chrétiens et à tout ce qui leur apparaît « normal » ; dans son Dialogue du chapon et de la poularde, Voltaire en vient ainsi à faire dire au chapon, s’adressant à la poularde, que l’abstinence de viande, deux jours par semaine, dans le christianisme, est une loi « très barbare [qui] ordonne que ces jours-là on mangera les habitants des eaux. Ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils dévorent des créatures dont une seule coûte souvent plus de la valeur de cent chapons: ils appellent cela jeûner, se mortifier. Enfin je ne crois pas qu’il soit possible d’imaginer une espèce plus ridicule à la fois plus abominable, plus extravagante et plus sanguinaire ». Globalement, le lien fait entre le fanatisme sanguinaire et les références abrahamiques est chez Voltaire une constante, qui participe beaucoup à son rejet du christianisme. Dans La Bible enfin expliquée, Voltaire écrit: « C’est le propre des fanatiques qui lisent les Ecritures saintes, de se dire à eux-mêmes: Dieu a tué, donc il faut que je tue ; Abraham a menti, Jacob a trompé, Rachel a volé, donc je dois voler, tromper, mentir. Mais, malheureux! tu n’es ni Rachel, ni Jacob, ni Abraham, ni Dieu: tu n’es qu’un fou furieux, & les Papes qui défendirent la lecture de la Bible furent très sages. » Voltaire et le protestantisme L’engagement de Voltaire pour la liberté religieuse est célèbre, et un des épisodes les plus connus en est l’affaire Calas. Ce protestant, injustement accusé d’avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme est mort roué en 1762. En 1763, Voltaire publie son Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas qui bien qu’interdit aura un retentissement extraordinaire et amènera à la réhabilitation de Calas deux ans plus tard. Au départ, il n’éprouvait pas pour lui de sympathies particulières, au point d’écrire le 22 mars 1762, dans une lettre privée au conseiller Le Bault: « Nous ne valons pas grand’chose, mais les huguenots sont pires que nous, et de plus ils déclament contre la comédie ». Il venait alors d’apprendre l’exécution de Calas et, encore mal informé, il croyait à sa culpabilité. Mais des renseignements lui parviennent et, le 4 avril, il écrit à Damilaville: « Il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Presque tout le Languedoc en gémit avec horreur. Les nations étrangères, qui nous haïssent et qui nous battent, sont saisies d’indignation. Jamais, depuis le jour de la Saint-Barthélemy, rien n’a tant déshonoré la nature humaine. Criez, et qu’on crie ». Et il se lance dans le combat pour la réhabilitation. En 1765, Voltaire prend fait et cause pour la famille Sirven, dans une affaire très similaire ; cette fois-ci il réussira à éviter la mort aux parents. Cependant, bien qu’impressionné par la théologie des Quakers, et révolté par le massacre de la Saint-Barthélemy (Voltaire était pris de malaises tous les 24 août), Voltaire n’a pas de sympathie particulière pour le protestantisme établi. Dans sa lettre du 26 juillet 1769 à la duchesse de Choiseul, il dit bien crûment: « Il y a dans le royaume des Francs environ trois cent mille fous qui sont cruellement traités par d’autres fous depuis longtemps ». Voltaire et l’hindouisme Très critique envers les religions abrahamiques, Voltaire avait en revanche une vision positive de l’hindouisme (mais rejetant toute forme de superstition qui aurait dégradé l’origine première des enseignements brahmaniques) ; l’autorité sacrée des brahmanes, le Véda, a ainsi été commenté par le philosophe en ces termes: « Le Véda est le plus précieux don de l’Orient, et l’Occident lui en sera à jamais redevable. » Et dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (chapitre 4): « Si l’Inde, de qui toute la terre a besoin, et qui seule n’a besoin de personne, doit être par cela même la contrée la plus anciennement policée, elle doit conséquemment avoir eu la plus ancienne forme de religion. » Dans ce même chapitre, Voltaire voit le peuple hindou comme étant « un peuple simple et paisible » – « étonné » de voir des « hommes ardents », venus « des extrémités occidentales de la terre », s’entretuer mutuellement sur le sous-continent indien – pour le piller et le convertir à leur religion respective et ennemie: l’islam ou les différentes branches du christianisme. Voltaire se sert aussi des histoires et textes antiques de l’hindouisme pour ridiculiser et renier les revendications et affirmations bibliques (temps linéaire très court de la Bible, face au temps cyclique et infiniment long dans l’hindouisme, etc.), et considère que la bienveillance hindoue envers les animaux est un choix qui rend complètement honteux la malveillance générale soutenue par l’impérialisme européen, colonial et esclavagiste. Informations complémentaires À la mort de Voltaire, son corps avait été, selon sa volonté, autopsié. Le marquis de Villette s’était approprié le cœur, l’apothicaire ayant procédé à l’embaumement, M. Mitouard, avait obtenu de garder le cerveau. Villette, ayant fait l’acquisition de Ferney, décida de faire de la chambre de l’écrivain un sanctuaire. Il y dressa un petit mausolée abritant un coffret de vermeil contenant la relique. Une plaque indiquait en lettres d’or: « Son esprit est partout et son cœur est ici ». Quand il dut vendre Ferney en 1785, le marquis rapporta le cœur rue de Beaune à Paris. Il échut à son héritier, qui était devenu sous la Restauration un royaliste ultra et qui légua, à sa mort en 1859, tous ses biens au « comte de Chambord ». D’autres héritiers des Villette, en pleine querelle testamentaire, tentèrent alors de s’opposer à ce que le cœur du philosophe devint la propriété du prétendant légitimiste au trône de France. Ils perdirent leur procès en première instance et en appel, mais l’emportèrent en cassation. Ils décidèrent d’en faire don en 1864 à l’empereur Napoléon III. Le cœur de Voltaire fut déposé à la Bibliothèque nationale dans le socle du plâtre original du « Voltaire assis » de Jean-Antoine Houdon où l’on peut lire l’inscription: « Cœur de Voltaire donné par les héritiers du marquis de Villette ». Cette cérémonie de remise du 16 décembre 1864 se fit en présence de Victor Duruy, ministre de l’Instruction, qui déclara le cœur de Voltaire bien national. Le cerveau de Voltaire fut exposé dans l’officine de Mitouart pendant plusieurs années. Son fils voulut en faire don en 1799 à la Bibliothèque nationale. Le Directoire refusa. De nouvelles propositions furent faites en 1830 et 1858, suivies de nouveaux refus. Il échoua en 1924 à la Comédie française (il aurait été cédé par une descendante des Mitouart contre deux fauteuils d’orchestre) et fut placé dans le socle d’une autre statue de Houdon où il se trouve encore. On qualifia Voltaire de « franc-maçon sans tablier », car il s’était tenu à l’écart de cette confrérie, bien qu’il eût des conceptions voisines. En 1778, il accepta pourtant d’entrer dans la loge des Neuf Sœurs (que fréquentait aussi Benjamin Franklin). On le dispensa vu son âge des habituelles épreuves ainsi que du rite du bandeau sur les yeux, celui-ci semblant déplacé sur un homme qui avait été considéré par beaucoup comme l’un des plus clairvoyants de son époque. Il revêtit à cette unique occasion le tablier de Claude-Adrien Helvétius, qu’il embrassa avec respect. Les honneurs funèbres lui furent rendus en loge le 28 novembre de cette même année,. Il est courant d’entendre que Voltaire disait à propos de Marivaux et d’autres: « Grands compositeurs de rien, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toiles d’araignées ». Or, s’il est exact que cette expression se rencontre effectivement chez Voltaire, elle ne vise nullement Marivaux. On la trouve dans sa lettre du 27 avril 1761 à l’abbé Trublet où il écrit: « Je me souviens que mes rivaux et moi, quand j’étais à Paris, nous étions tous fort peu de chose, de pauvres écoliers du siècle de Louis XIV, les uns en vers, les autres en prose, quelques-uns moitié prose, moitié vers, du nombre desquels j’avais l’honneur d’être ; infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toile d’araignée ». Quant au nom de l’auteur du Jeu de l’amour et du hasard, il ne se trouve pas une seule fois dans la lettre. Voltaire a la réputation d’avoir été un grand amateur de café, et il fréquentait souvent le Procope. Il aurait eu l’habitude de consommer entre 40 et 72 tasses par jour,. Le billet de banque 10 francs Voltaire a été émis en janvier 1964. Le romancier Frédéric Lenormand fait de Voltaire le héros de sa série de livres Voltaire mène l’enquête. En mai 2016, six livres dans cette collection sont sortis. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire


Poeta oriundo del Estado de México (1995). Lic. en Ciencias de la Comunicación con posgrado en Literatura Mexicana del Siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha colaborado en las revistas Letralia, Trinchera Literaria, Monolito, El Cisne, Raíces, De Sur a Sur, entre otras, en la sección de poesía. En 2019 obtuvo el tercer lugar en el certamen de poesía del CEECIIL de la UAM-I, por el poemario "Otro sendero". Cuenta con dos e-books publicados: "Voces de ausencia" (2020) y "Fragmentos de flor y canto" (2021). Recientemente, fue incluido en la "I Antología: Voces Emergentes de la Literatura" de Ediciones Alborismos.

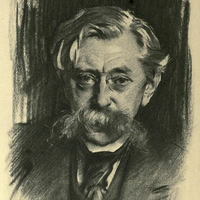
Émile Adolphe Gustave Verhaeren, né à Saint-Amand dans la province d’Anvers (Belgique), le 21 mai 1855 et mort (accidentellement) à Rouen le 27 novembre 1916, est un poète belge flamand, d’expression française. Dans ses poèmes influencés par le symbolisme, où il pratique le vers libre, sa conscience sociale proche de l’anarchisme lui fait évoquer les grandes villes dont il parle avec lyrisme sur un ton d’une grande musicalité. Il a su traduire dans son œuvre la beauté de l’effort humain. Biographie Verhaeren est né à Saint-Amand (en néerlandais: Sint-Amands) en Belgique, au bord de l’Escaut, dans une famille aisée où l’on parlait le français, tandis qu’au village et à l’école régnait le flamand. Il fréquenta d’abord l’internat francophone Sainte-Barbe, tenu par des jésuites à Gand, puis il étudia le droit à l’université catholique de Louvain. C’est là qu’il rencontra le cercle des écrivains qui animaient La Jeune Belgique et il publia en 1879 les premiers articles de son cru dans des revues d’étudiants. Chaque semaine, l’écrivain socialiste Edmond Picard tenait à Bruxelles un salon où le jeune Verhaeren put rencontrer des écrivains et des artistes d’avant-garde. C’est alors qu’il décida de renoncer à une carrière juridique et de devenir écrivain. Il publiait des poèmes et des articles critiques dans les revues belges et étrangères, entre autres L’Art moderne et La Jeune Belgique. Comme critique d’art, il soutint de jeunes artistes tels que James Ensor. En 1883, il publia son premier recueil de poèmes réalistes-naturalistes, Les Flamandes, consacré à son pays natal. Accueilli avec enthousiasme par l’avant-garde, l’ouvrage fit scandale au pays natal. Ses parents essayèrent même avec l’aide du curé du village d’acheter la totalité du tirage et de le détruire. Le scandale avait été un but inavoué du poète, afin de devenir connu plus rapidement. Il n’en continua pas moins par la suite à publier d’autres livres de poésies. Des poèmes symbolistes au ton lugubre caractérisent ces recueils, Les Moines, Les Soirs, Les Débâcles et Les Flambeaux noirs. En 1891, il épousa Marthe Massin, peintre connue pour ses aquarelles, dont il avait fait la connaissance deux ans plus tôt, et s’installa à Bruxelles. Son amour pour elle s’exprime dans trois recueils de poèmes d’amour: Les Heures claires, Les Heures d’après-midi et Les Heures du soir. Dans les années 1890, Verhaeren s’intéressa aux questions sociales et se lança dans la « révolte anarchiste ». Son implication sociale apparaît clairement dans des articles et des poèmes parus dans la presse libertaire (L’En-dehors, Le Libertaire, La Revue blanche, etc.) et surtout dans des manuscrits inachevés et demeurés inédits, comme la pièce La Grand-Route et le roman Désiré Menuiset et son cousin Oxyde Placard,. Il travailla à rendre dans ses poèmes l’atmosphère de la grande ville et son opposé, la vie à la campagne. Il exprima ses visions d’un temps nouveau dans des recueils comme Les Campagnes hallucinées, Les Villes tentaculaires, Les Villages illusoires et dans sa pièce de théâtre Les Aubes. Ces poèmes le rendirent célèbre, et son œuvre fut traduite et commentée dans le monde entier. Il voyagea pour faire des lectures et des conférences dans une grande partie de l’Europe. Beaucoup d’artistes, de poètes et d’écrivains comme Antonio de La Gandara, Georges Seurat, Paul Signac, Auguste Rodin, Edgar Degas, August Vermeylen, Léon Bazalgette, Henry van de Velde, Max Elskamp, Maurice Maeterlinck, Stéphane Mallarmé, André Gide, Rainer Maria Rilke, Gostan Zarian et Stefan Zweig l’admiraient, correspondaient avec lui, cherchaient à le fréquenter et le traduisaient. Les artistes liés au futurisme subissaient son influence. Émile Verhaeren était aussi un ami personnel du roi Albert et de la reine Élisabeth ; il fréquentait régulièrement toutes les demeures de la famille royale. En 1914 la Première Guerre mondiale éclata et, malgré sa neutralité, la Belgique fut occupée presque entièrement par les troupes allemandes. Verhaeren se réfugia en Angleterre. Il écrivit des poèmes pacifistes et lutta contre la folie de la guerre dans les anthologies lyriques: La Belgique sanglante, Parmi les Cendres et Les Ailes rouges de la Guerre. Sa foi en un avenir meilleur se teinta pendant le conflit d’une résignation croissante. Il n’en publia pas moins dans des revues de propagande anti-allemandes et tenta dans ses conférences de renforcer l’amitié entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni. Le 27 novembre 1916, il alla visiter les ruines de l’abbaye de Jumièges. Le soir, après avoir donné une nouvelle conférence à Rouen, il mourut accidentellement, ayant été poussé par la foule, nombreuse, sous les roues d’un train qui partait. Le gouvernement français voulut l’honorer en l’ensevelissant au Panthéon, mais la famille refusa et le fit enterrer au cimetière militaire d’Adinkerque. En raison du danger que représentait l’avancée des troupes, ses restes furent encore transférés pendant la guerre à Wulveringem avant d’être en 1927 définitivement enterrés dans son village natal de Saint-Amand où depuis 1955 un musée, le musée provincial Émile Verhaeren, rappelle son souvenir. Divers En 2015-2016, à l’approche du centenaire de sa mort, le musée des Avelines de Saint-Cloud, en région parisienne, lui consacre une exposition hommage intitulée Émile Verhaeren (1855-1916), poète et passeur d’Art.Un buste de Verhaeren en bronze signé et dédicacé par Charles van der Stappen (1843-1910) figure dans une vente publique à Lille le 26 juin 2017 (reprod. coul. dans La Gazette Drouot du 16 juin 2017 reprod. coul. p. 232). Dans un champ d’orge Poème autographe paru dans La Plume en février 1904. Œuvres Principaux recueils * Les Flamandes, 1883 * Les Moines, 1886 * Les Soirs, 1887 * Les Débâcles, 1888 * Les Flambeaux noirs, 1891 * Les Apparus dans mes chemins, 1892 * Les Campagnes hallucinées, 1893 * Les Bords de la route, 1895 * Les Villes tentaculaires, 1895 * Les Villages illusoires, 1895 * Les Heures claires, 1896 * Les Visages de la vie, 1899 * Petites Légendes, 1900 * Les Forces tumultueuses, 1902 * Toute la Flandre, 1904-1911 * Les Heures d’après-midi, 1905 * La Multiple Splendeur, 1906 * Les Rythmes souverains, 1910 * Les Heures du soir, 1911 * Les Blés mouvants, 1912 * Les Ailes rouges de la guerre, 1916 * Les Flammes hautes, 1917 * À la vie qui s’éloigne, 1923 * Quelques chansons de village, (posthume), 1924 Œuvre critique * James Ensor * Rembrandt * Monet * Impressions (3 volumes) recueils de textes et d’articles critiques sur des écrivains. * Pages belges 1926, recueils de textes sur des écrivains belges. Théâtre * Le cloître (drame en quatre actes). * Philippe II * Hélène de Sparte * Les Aubes Prose * Le travailleur étrange, recueil de nouvelles * Villes meurtries de Belgique. Anvers, Malines et Lierre * Impessions d’Espagne Ed. Casimiro, (ISBN 9788416868858) Éditions bibliophiliques posthumes * Belle chair, poèmes d’Émile Verhaeren, lithographies originales de Philippe Cara Costea, Éditions Les Francs Bibliophiles, 1967. * Belle Chair, poèmes suivi de chants dialogués ; petites légendes ; feuilles éparses, Mercure de France, 3° edition (1939) (ASIN B003X1CO6G) * Les villes à pignons, le texte du poète s’accompagne de 35 eaux-fortes originales du peintre et aquafortiste Julien Célos, Éditions Victor Dancette, 1946. * Le Vent, livre d’artiste sur le poème d’Émile Verhaeren, conçu sous forme d’une œuvre d’art au sein du Laboratoire du livre d’artiste, en 2014. Correspondance * Émile Verhaeren– Stefan Zweig 1996 * À Marthe Verhaeren Mercure de France 1937 * Verhaeren-Rilke / Verhaeren-Dehmel Correspondance. (Archives et Musée de la littérature– AML) Reconnaissance, honneurs * Le roi Albert Ier de Belgique a donné le titre honorifique de Poète national à Émile Verhaeren en 1899. Représentations * Portrait d’Émile Verhaeren par Pierre Hodé, a été reproduit dans La Revue du foyer, novembre 1916. * Buste en bronze du poète dû à Henri Lagriffoul dans les jardins de l’hôtel de ville de Rouen (1948). * Buste par Louis Mascré au parc Josaphat à Bruxelles. * Buste du poète à Roisin au lieu dit “Le caillou qui bique” où il a séjourné, ce petit domaine dans le Bois d’Angre parcouru par la Grande Honnelle est un lieu de détente agréable et bien connu. * Des pierres sculptées où sont gravés certains de ces poèmes sont placés tout au long du parcours “Circuit des pierres Verhaeren”. * Buste de Verhaeren à Paris, square André-Lefèbvre, jouxtant l’église Saint-Séverin à Paris. * * * Exposition * Émile Verhaeren. Poète et Passeur d’art. Saint-Cloud, Musée des Avelines, du 15 octobre 2015 au 6 mars 2016. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Verhaeren


James Thomson (23 November 1834– 3 June 1882), who wrote under the pseudonym Bysshe Vanolis, was a Scottish Victorian-era poet famous primarily for the long poem The City of Dreadful Night (1874), an expression of bleak pessimism in a dehumanized, uncaring urban environment. Life Thomson was born in Port Glasgow, Scotland, and, after his father suffered a stroke, he was sent to London where he was raised in an orphanage, the Royal Caledonian Asylum on Chalk (later Caledonian after the asylum) Road near Holloway. He spoke with a London accent. He received his education at the Caledonian Asylum and the Royal Military Academy and served in Ireland, where in 1851, at the age of 17, he made the acquaintance of the 18-year-old Charles Bradlaugh, who was already notorious as a freethinker, having published his first atheist pamphlet a year earlier. More than a decade later, Thomson left the military and moved to London, where he worked as a clerk. He remained in contact with Bradlaugh, who was by now issuing his own weekly National Reformer, a “publication for the working man”. For the remaining 19 years of his life, starting in 1863, Thomson submitted stories, essays and poems to various publications, including the National Reformer, which published the sombre poem which remains his most famous work. The City of Dreadful Night came about from the struggle with insomnia, alcoholism and chronic depression which plagued Thomson’s final decade. Increasingly isolated from friends and society in general, he even became hostile towards Bradlaugh. In 1880, nineteen months before his death, the publication of his volume of poetry, The City of Dreadful Night and Other Poems elicited encouraging and complimentary reviews from a number of critics, but came too late to prevent Thomson’s downward slide. Thomson’s remaining poems rarely appear in modern anthologies, although the autobiographical Insomnia and Mater Tenebrarum are well-regarded and contain some striking passages. He admired and translated the works of the pessimistic Italian poet Giacomo Leopardi (1798–1837), but his own lack of hope was darker than that of Leopardi. He is considered by some students of the Victorian age as the bleakest of that era’s poets. He died in London at the age of 47. In 1889, seven years after Thomson’s death, Henry Stephens Salt wrote his first major biography, The Life of James Thomson (B.V.). Thomson’s pseudonym, Bysshe Vanolis, derives from the names of the poets Percy Bysshe Shelley and Novalis. He is often distinguished from the earlier Scottish poet James Thomson by the letters B.V. after the name. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/James_Thomson_(poet,_born_1834)


Jones Very (August 28, 1813– May 8, 1880) was an American poet, essayist, clergyman, and mystic associated with the American Transcendentalism movement. He was known as a scholar of William Shakespeare and many of his poems were Shakespearean sonnets. He was well-known and respected amongst the Transcendentalists, though he had a mental breakdown early in his career. Born in Salem, Massachusetts to two unwed first cousins, Jones Very became associated with Harvard University, first as an undergraduate, then as a student in the Harvard Divinity School and as a tutor of Greek. He heavily studied epic poetry and was invited to lecture on the topic in his home town, which drew the attention of Ralph Waldo Emerson. Soon after, Very asserted that he was the Second Coming of Christ, which resulted in his dismissal from Harvard and his eventual institutionalization in an insane asylum. When he was released, Emerson helped him issue a collection called Essays and Poems in 1839. Very lived the majority of his life as a recluse from then on, issuing poetry only sparingly. He died in 1880. Biography Very was born on August 28, 1813, in Salem, Massachusetts and spent much of his childhood at sea. He was the oldest of six children, born out of wedlock to two first cousins. His mother, Lydia Very, was known for being an aggressive freethinker who made her atheistic beliefs known to all. She believed that marriage was only a moral arrangement and not a legal one. His father, also named Jones Very, was a captain during the War of 1812 and was held in Nova Scotia for a time by the British as a prisoner of war. When the younger Jones Very was ten, his father, by then a shipmaster, took him on a sailing voyage to Russia. A year later, his father had Very serve as a cabin boy on a trip to New Orleans, Louisiana. His father died on the return trip, apparently due to a lung disease he contracted while in Nova Scotia. As a boy, Very was studious, well-behaved, and solitary. By 1827, he left school when his mother told him he must take the place of his father and care for the family. After working at an auction house, Very became a paid assistant to the principal of a private school in Salem as a teenager. The principal, Henry Kemble Oliver, exposed his young assistant to philosophers and writers, including James Mackintosh, to influence his religious beliefs and counteract his mother’s atheism. He composed a poem for the dedication of a new Unitarian church in Salem: “O God; On this, our temple, rest thy smile, Till bent with days its tower shall nod”. Harvard years Very enrolled at Harvard College in 1834. During his college years, he was shy, studious, and ambitious of literary fame. He had become interested in the works of Lord Byron, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Johann Wolfgang von Goethe and Friedrich Schiller. His first few poems were published in his hometown newspaper, the Salem Observer, while he completed his studies. He graduated from Harvard in 1836, ranked number two in his class. He was chosen to speak at his commencement; his address was titled “Individuality”. After graduating, Very served as a tutor in Greek before entering Harvard Divinity School, thanks to the financial assistance of an uncle. Though Very never completed his divinity degree, he held temporary pastorates in Maine, Massachusetts, and Rhode Island. Very became known for his ability to draw people into literature, and was asked to speak at a lyceum in his hometown of Salem in 1837. There he was befriended by Elizabeth Peabody, who wrote to Emerson suggesting Very lecture in Concord. In 1838, Ralph Waldo Emerson arranged a talk by Very at the Concord Lyceum. Very lectured on epic poetry on April 4 of that year, after he had walked twenty miles from Salem to Concord to deliver it. Emerson made up for the meager $10 payment by inviting Very to his home for dinner. Emerson signed Very’s personal copy of Nature with the words: "Har[mony] of Man with Nature Must Be Reconciled With God". For a time, Very tried to recruit Nathaniel Hawthorne as a brother figure in his life. Though Hawthorne treated him kindly, he was not impressed by Very. Unlike Hawthorne, Emerson found him “remarkable” and, when Very showed up at his home unannounced along with Cornelius Conway Felton in 1838, Emerson invited several other friends, including Henry David Thoreau, to meet him. Emerson, however, was surprised at Very’s behavior in larger groups. “When he is in the room with other persons, speech stops, as if there were a corpse in the apartment”, he wrote. Even so, in May 1838, the same month Very published his “Epic Poetry” lecture in the Christian Examiner, Emerson brought Very to a meeting of the Transcendental Club, where the topic of discussion was “the question of mysticism”. At the meeting, held at the home of Caleb Stetson in Medford, Massachusetts, Very was actively engaged in the discussion, building his reputation as a mystic within that circle. Mental health Very was known as an eccentric, prone to odd behavior and may have suffered from bipolar disorder. The first signs of a breakdown came shortly after meeting Emerson, as Very was completing an essay on William Shakespeare. As Very later explained, “I felt within me a new will... it was not a feeling of my own but a sensible will that was not my own... These two consciousnesses, as I may call them, continued with me”. In August 1837, while traveling by train, he was suddenly overcome with terror at its speed until he realized he was being “borne along by a divine engine and undertaking his life-journey”. As he told Henry Ware, Jr., professor of pulpit eloquence and pastoral care at Harvard Divinity School, divine inspiration helped him suddenly understand the twenty-fourth chapter of the Gospel of Matthew and that Christ was having his Second Coming within him. When Ware did not believe him, Very said, “I had thought you did the will of the Father, and that I should receive some sympathy from you—But I now find that you are doing your own will, and not the will of your father”. Very also claimed that he was under the influence of the Holy Spirit and composed verse while in this state. Emerson did not believe Very’s claim and, noting the poor writing, he asked, "cannot the spirit parse & spell?" Very said he was also tormented by strong sexual desires which he believed were only held in check by the will of God. To help control himself, he avoided speaking with or even looking at women—he called it his “sacrifice of Beauty”. One of Very’s students, a fellow native of Salem named Samuel Johnson, Jr., said that people ridiculed Very behind his back since he had “gained the fame of being cracked (or crazy, if you are not acquainted with Harvard technicalities)”. During one of his tutoring sessions, Very declared that he was “infallible: that he was a man of heaven, and superior to all the world around him”. He then cried out to his students, “Flee to the mountains, for the end of all things is at hand”. Harvard president Josiah Quincy III relieved Very of his duties, referring to a “nervous collapse” that required him to be left in the care of his younger brother Washington Very, himself a freshman at Harvard. After returning to Salem, he visited Elizabeth Peabody on September 16, 1838, apparently having given up his rule “not to speak or look at women”. As she recalled, He looked much flushed and his eyes very brilliant and unwinking. It struck me at once that there was something unnatural—and dangerous in his air—As soon as we were within the parlor door he laid his hand on my head—and said “I come to baptize you with the Holy Ghost and with Fire”—and then he prayed. After this, Very told her she would soon feel different, explaining, “I am the Second Coming”. He performed similar “baptisms” to other people throughout Salem, including ministers. It was finally Reverend Charles Wentworth Upham who had him committed. Very was institutionalized for a month at a hospital near Boston, the McLean Asylum, as he wrote, “contrary to my will”. While there, he finished an essay on Hamlet, arguing that the play is about “the great reality of a soul unsatisfied in its longings after immortality” and that “Hamlet has been called mad, but as we think, Shakespeare thought more of his madness than he did of the wisdom of the rest of the play”. During his stay at the hospital, Very lectured his fellow patients on Shakespeare and on poetry in general. He was released on October 17, 1838, though he refused to renounce his beliefs. His fellow patients reportedly thanked him as he left. McLean’s superintendent Luther Bell took credit for saving him “from the delusion of being a prophet extraordinaire”, which Luther thought was caused by Very’s digestive system being “entirely out of order”. The same month he was released, Very stayed with Emerson at his home in Concord for a week. While he was visiting, Emerson wrote in his journal on October 29, “J. Very charmed us all by telling us he hated us all.” Amos Bronson Alcott wrote of Very in December 1838: I received a letter on Monday of this week from Jones Very of Salem, formerly Tutor in Greek at Harvard College—which institution he left, a few weeks since, being deemed insane by the Faculty. A few weeks ago he visited me....He is a remarkable man. His influence at Cambridge on the best young men was very fine. His talents are of a high order....Is he insane? If so, there yet linger glimpses of wisdom in his memory. He is insane with God—diswitted in the contemplation of the holiness of Divinity. He distrusts intellect... Living, not thinking, he regards as the worship meet for the soul. This is mysticism in its highest form. Poetry Emerson saw a kindred spirit in Very and defended his sanity. As he wrote to Margaret Fuller, “Such a mind cannot be lost”. Emerson was sympathetic with Very’s plight because he himself had recently been ostracized after his controversial lecture, the “Divinity School Address”. He helped Very publish a small volume, Essays and Poems in 1839. The poems collected in this volume were chiefly Shakespearean sonnets. Very also published several poems in the Western Messenger between 1838 and 1840 as well as in The Dial, the journal of the Transcendentalists. He was disappointed, however, that Emerson, serving as editor of the journal, altered his poems. Very wrote to Emerson in July 1842, “Perhaps they were all improvements but I preferred my own lines. I do not know but I ought to submit to such changes as done by the rightful authority of an Editor but I felt a little sad at the aspect of the piece.” He was never widely read, and was largely forgotten by the end of the nineteenth century, but in the 1830s and 1840s the Transcendentalists, including Emerson, as well as William Cullen Bryant, praised his work. Very continued writing throughout his life, though sparingly. Many of his later poems were never collected but only distributed in manuscript form among the Transcendentalists. In January 1843, his work was included in the first issue of The Pioneer, a journal edited by James Russell Lowell which also included the first publication of Edgar Allan Poe’s “The Tell-Tale Heart”. Final years and death Jones Very believed his role as a prophet would last only twelve months. By September 1839, his role was complete. Emerson suggested that Very’s temporary mental instability was worth the message he had delivered. In his essay “Friendship”, Emerson referred to Very: I knew a man who under a certain religious frenzy cast off this drapery, and spoke to the conscience of every person he encountered, and that with great insight and beauty. At first, all men agreed he was mad. But persisting, he attained to the advantage of bringing every man of his acquaintance into true relations with him... To stand in true relations with men in a false age is worth a fit of insanity, is it not? The last decades of Very’s life were spent in Salem as a recluse under the care of his sister. It was during these years that he held roles as a visiting minister in Eastport, Maine and North Beverly, Massachusetts, though these roles were temporary because he had become too shy. By age 45, he had retired. In his last forty years, Very did very little. As biographer Edwin Gittleman wrote, "Although he lived until 1880, Very’s effective life was over by the end of 1840." He died on May 8, 1880 and, upon hearing of Very’s death, Alcott wrote a brief remembrance on May 16, 1880: The newspapers record the death of Jones Very of Salem, Mass. It was my fortune to have known the man while he was tutor in Harvard College and writing his Sonnets and Essays on Shakespeare, which were edited by Emerson, and published in 1839. Very was then the dreamy mystic of our circle of Transcendentalists, and a subject of speculation by us. He professed to be taught by the Spirit and to write under its inspiration. When his papers were submitted to Emerson for criticism the spelling was found faulty and on Emerson’s pointing out the defect, he was told that this was by dictation of the Spirit also. Whether Emerson’s witty reply, “that the Spirit should be a better speller,” qualified the mystic’s vision does not appear otherwise than that the printed volume shows no traces of illiteracy in the text. Very often came to see me. His shadowy aspect at times gave him a ghostly air. While walking by his side, I remember, he seemed spectral,—and somehow using my feet instead of his own, keeping as near me as he could, and jostling me frequently. His voice had a certain hollowness, as if echoing mine. His whole bearing made an impression as if himself were detached from his thought and his body were another’s. He ventured, withal, to warn me of falling into idolatries, while he brought a sonnet or two (since printed) for my benefit. His temperament was delicate and nervous, disposed to visionariness and a dreamy idealism, stimulated by over-studies and the school of thought then in the ascendant. His sonnets and Shakespearean essays surpass any that have since appeared in subtlety and simplicity of execution. Critical assessment The first critical review of Very’s book was written by Margaret Fuller and published in Orestes Brownson’s Boston Quarterly Review; it said Very’s poems had “an elasticity of spirit, a genuine flow of thought, and unsought nobleness and purity”, though she admitted she preferred the prose in the collection over the poetry. She mocked the “sing song” style of the poems and questioned his religious mission. She concluded: “I am... greatly interested in Mr Very. He seems worthy to be well known.” James Freeman Clarke admired Very’s poetry enough to have several published in his journal, the Western Messenger, between 1838 and 1840. William Ellery Channing admired Very’s poetry as well, writing that his insanity “is only superficial”. Richard Henry Dana, Sr. also commented positively on Very’s poetry: “The thought is deeply spiritual; and while there is a certain character of peculiarity which we so often find in like things from our old writers, there is a freedom from quaintness... Indeed, I know not where you would... find any thing in this country to compare with these Sonnets.” Editor and critic Rufus Wilmot Griswold was impressed enough by Very’s poetry to include him in the first edition of his anthology The Poets and Poetry of America in 1842. He wrote to Emerson asking for more information about him and expressing his opinion of his poetry: “Though comparatively unknown, he seems to be a true poet.” The modern reassessment of Jones Very as an author of literary importance can be dated to a 1936 essay by Yvor Winters who wrote of the poet, “In the past two decades two major American writers have been rediscovered and established securely in their rightful places in literary history. I refer to Emily Dickinson and Herman Melville. I am proposing the establishment of a third.” Winters, in speaking of Very’s relations with Emerson and his circle, concluded, “The attitude of the Transcendentalists toward Very is instructive and amusing, and it proves beyond cavil how remote he was from them. In respect to the doctrine of the submission of the will, he agreed with them in principle; but whereas they recommended the surrender, he practised it, and they regarded him with amazement.” Subsequently, William Irving Bartlett, in 1942, outlined the basic biographical facts of Very’s life in Jones Very, Emerson’s “Brave Saint.” A complete scholarly edition of Very’s poetic works belatedly appeared, over a century after the poet’s death, in 1993. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Jones_Very
Luis Felipe Vivanco (San Lorenzo de El Escorial, 22 de agosto de 1907 - Madrid, 21 de noviembre de 1975) fue un arquitecto y poeta español. Hijo de un juez, los diferentes destinos de su padre le llevan durante su infancia a diversas ciudades de España. En 1915 la familia se establece en Madrid, ciudad en la que Vivanco pasará la mayor parte de su vida. Estudió Primaria y Bachillerato en el Colegio El Pilar y más adelante en la escuela de Arquitectura de Madrid. En estos años universitarios compone una serie de poemas vanguardistas que publicará en 1958 en Memoria de la plata. De esa época también data su amistad con Rafael Alberti y Xavier Zubiri. Tras terminar Arquitectura en 1932 siguió también cursos de Filosofía y Letras. En esta Facultad, de la que también son alumnos Germán Bleiberg y Juan Panero, conocerá a Luis Rosales. Pasó una larga temporada reponiéndose de tifus en la Sierra de Guadarrama. Publicó sus primeros trabajos en la revista Cruz y Raya de su tío José Bergamín, a la vez que trabajaba como arquitecto con otro de sus tíos, Rafael Bergamín (realizando parte de las casas de la Colonia de El Viso). Conoce también a Pablo Neruda. Al estallar la guerra civil, diversas circunstancias familiares hacen que, a pesar de su declarado republicanismo, se decante a favor de Franco y realice poesía propagandista. Fue colaborador de la revista Escorial (1940), junto a Luis Rosales, Leopoldo Panero, a quien visitaba regularmente en su casa de Castrillo de las Piedras y Dionisio Ridruejo, todos ellos son considerados la generación del 36. En esta revista cultivó una poesía intimista, realista, de carácter mediativo y trascendente. En su obra, la naturaleza adquiere un valor trascendente que conduce a la experiencia religiosa. Además de la poesía religiosa, otros de sus temas habituales son la familia y la vida cotidiana. Tenia un caracter taciturno y mas bien triste. Obra * Cantos de primavera (1936) * Tiempo de dolor (1940) * Continuación de la vida (1949) * Introducción a la poesía española contemporánea (1957) * El descampado (1957) * Memoria de la plata (1958) * Lecciones para el hijo (1966) * Moratín y la ilustración mágica (1972) * Prosas propicias (1972) Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_Vivanco

Let me slow down collect my thoughts Racing a non existent clock But I pretend its not I believe my thoughts have purpose To whom I’m not sure but purpose nonetheless So I think & think & think & think I never sleep Never rest I day dream @ best Slide through the motions The daily stress Yes, no? That’s me Vague @ best.

Por Luis de Góngora Al conde de Villamediana, celebrando el gusto que tuvo en diamantes, pinturas y caballos Las que a otros negó piedras Oriente, Émulas brutas del mayor lucero, Te las expone en plomo su venero, Si ya al metal no atadas más luciente. Cuanto en tu camarín pincel valiente, Bien sea natural, bien extranjero, Afecta mudo voces, y parlero Silencio en sus vocales tintas miente. Miembros apenas dio al soplo más puro Del viento su fecunda madre bella, Iris, pompa del Betis, sus colores; Que fuego él espirando, humo ella, Oro te muerden en su freno duro, Oh esplendor generoso de señores. Juan de Tassis (o Tarsis) y Peralta, II Conde de Villamediana, (Lisboa, 1582 - Madrid, 21 de agosto de 1622), poeta español del Barroco, adscrito por lo general al Culteranismo, si bien siguió esta estética de modo muy personal. Fue hijo de María de Peralta Muñatones, y de Juan de Tassis y Acuña, Correo Mayor del reino que gracias a su labor como organizador del servicio de postas había recibido el título de nobleza en 1603. Villamediana vivió en el ambiente palatino desde su infancia, recibiendo una excelente educación del humanista Luis Tribaldos de Toledo y de Bartolomé Jiménez Patón, quien dedicó su Mercurius Trimegistus a su pupilo. Gracias a sus dos tutores, gozó de una excelente formación en letras y de un profundo conocimiento de los clásicos y compuso algunos poemas en excelente latín humanístico. Pasó por la universidad, pero no realizó ninguna carrera. Cuando Felipe III fue al Reino de Valencia para celebrar su matrimonio con Doña Margarita de Austria, Don Juan le acompañó y se distinguió tanto que el Rey le nombró Gentilhombre de su casa. En Palacio conoció a la noble doña Magdalena de Guzmán y Mendoza, de gran influencia en la Corte como viuda de Martín Cortés de Monroy, II Marqués del Valle de Guajaca (Oaxaca), y como futura aya del hijo que iba a tener la reina; pese a la diferencia de edad sostuvo una relación con ella que terminó mal; un soneto anónimo que circuló por Madrid decía que no se portó muy bien con ella e incluso la llegó a abofetear en mitad de la representación de una comedia, delante de todo el mundo, por lo que se dice que Doña Magdalena siempre le amó y le odió al mismo tiempo. Trasladada la Corte a Valladolid, donde permaneció cinco años, contrajo matrimonio en 1601 con Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, descendiente del famoso Marqués de Santillana, de la que tuvo varios hijos, todos malogrados. Al morir su padre en 1607 asumió el título y el cargo de correo mayor del reino. Pero por su talante agresivo, temerario y mujeriego adquirió pronto una reputación de libertino, dandy, amante del lujo, de las piedras preciosas, los naipes y los caballos, y llevó una vida desordenada de jugador, alcanzando una reputación de adversario temible sobre el tapete por su gran inteligencia. Sin embargo estos excesos le valieron dos destierros, fuera de por haber arruinado a varios caballeros importantes, también por sus fortísimas sátiras, en las que zahería sin piedad alguna las miserias de casi todos los Grandes de España, ya que como perteneciente al mismo estamento que ellos conocía bien sus defectos y flaquezas, y sabía por dónde atacarlos y hacer daño. El primero de sus destierros le llevó a Italia, donde estuvo entre 1611 y 1617 con el Conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles. Ya vuelto a España, atacó en varias sátiras la corrupción alcanzada bajo el validato del Duque de Lerma y don Rodrigo Calderón durante los últimos años del reinado de Felipe III, de forma que estos lograron del rey que le desterrara otra vez de la Corte en 1618, aunque esta vez a Andalucía, de donde regresó al poco al fallecer el Rey, favorecido como fue por el nuevo valido, el Conde Duque de Olivares. Tuvo numerosas amantes, con las cuales llegó a veces a las manos públicamente, como en una ocasión durante el estreno de una comedia, y no se paró ante amoríos peligrosos como con una de las cortesanas del rey, una tal Marfisa, quizá doña Francisca de Tavara, bellísima joven portuguesa, dama de la reina y amante del rey. La leyenda afirma también que incendió premeditadamente el coliseo de Aranjuez mientras, durante las fiestas de celebración del aniversario del rey Felipe IV, se estrenaba ante la reina, el 8 de abril de 1622, una obra suya, La gloria de Niquea, inspirada en un episodio del Amadís de Grecia, para poder salvarla en brazos, ya que estaba enamorado de ella y aun tocarla siquiera estaba penado con la muerte. Existe también la leyenda de que se presentó a un baile con una capa cubierta de reales de oro, con lo que aludía a su suerte en el juego, y con la leyenda "Son mis amores reales", lo que era un triple sentido con la palabra reales muy peligroso para la época; con este título y sobre este episodio escribirá en el siglo XX un drama Joaquín Dicenta. Otra leyenda es la del origen de la expresión "Picar muy alto", que se cree se debió a las habilidades como picador del Conde, que al ser alabadas por la reina, el rey respondió: "Pica bien, pero pica muy alto" (con evidente doble sentido, debido a sus escarceos con la reina). Luis Rosales ha descubierto, además, que la Inquisición le abrió un proceso secreto por sodomía con algunos esclavos negros y conjetura que el rey Felipe IV ordenó su asesinato para evitar el escándalo, aunque muchos tenían sobrados motivos para desear su muerte, no ya por las sátiras o por haberles ocasionado la ruina, sino por problemas también de faldas, incluido el mismo monarca. Consciente de su carácter temerario y atrevido, un sombrío pesimismo aparece en la mayoría de las composiciones del Conde, quien escribió aquellos versos celebérrimos: Sépase, pues ya no puedo levantarme ni caer que al menos puedo tener perdido a Fortuna el miedo Fue asesinado por Alonso Mateo o Ignacio Méndez, ballesteros reales que quedaron impunes a causa de la alta protección de que gozaban y se le sepultó en la bóveda de la capilla mayor del Convento de San Agustín, en Valladolid. Los promotores o autores intelectuales del crimen fueron Felipe IV o más probablemente el Conde-Duque de Olivares; el momento escogido fue cuando iba en un coche con el Conde de Haro por la Calle Mayor de Madrid; el móvil fue, quizá, evitar el escándalo del proceso secreto que la Inquisición levantó contra él; por eso el crimen quedó impune y se mandó guardar silencio sobre él. Pero el hecho causó sensación, y todos los poetas famosos se aprestaron a escribir epicedios en verso sobre el Conde, empezando por su amigo Luis de Góngora, quien atribuyó al rey la orden, continuando por Juan Ruiz de Alarcón, que lo acusó de maldiciente, y terminando por Francisco de Quevedo, quien, pese a ser enemigo suyo, escribió "que pide venganza cierta / una salvación en duda". Fueron inculpadas por sodomía y pecado nefando muchas personas, desde criados y bufones de varias casas aristocráticas hasta sus mismos amos, entre ellos el primogénito del conde de Lemos, quien logró poner mar por medio marchando a Italia para sobrevivir al castigo, si bien sus sirvientes pagaron con la vida la culpabilidad del amo, sucumbiendo en la hoguera el 5 de diciembre de 1622 en la plaza Mayor de Madrid cinco personas: un bufón al que apodaban Mendocilla, un mozo de cámara del conde de Villamediana, un esclavillo mulato, otro lacayo de Villamediana y don Gaspar de Terrazas, paje del insigne duque de Alba. El poeta y dramaturgo Don Antonio Hurtado de Mendoza pintó su carácter en un romance a su muerte: a sabéis que era Don Juan dado al juego y los placeres; amábanle las mujeres por discreto y por galán. Valiente como Roldán y más mordaz que valiente... más pulido que Medoro y en el vestir sin segundo, causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro... Muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la Corte entera, que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera El asesinato inspiró en el XIX varios romances históricos del Duque de Rivas y también algún drama romántico, como También los muertos se vengan de Patricio de la Escosura (1838), la novela de Ceferino Suárez Bravo El cetro y el puñal (1851) y algunos relatos breves así como un cuadro de historia de Manuel Castellano en 1868, ahora en el Museo del Prado; en el siglo XX, el drama de Joaquín Dicenta Son mis amores reales y varias novelas: Decidnos: ¿quién mató al Conde? de Nestor Luján, Capa y espada de Fernando Fernán Gómez (2001) y El pintor de Flandes de Rosa Ribas (2006). Tras su muerte, sus cargos pasaron a su primo Don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, hijo de Pedro Vélez de Guevara y María de Tassis. Obra literaria Una primera colección de sus Obras apareció en Zaragoza en 1629. Comprende poemas de asunto mitológico (Fábula de Faetón, largo poema de hacia 1617 compuesto en octavas reales del que Vicente Mariner tradujo doscientas veintiocho al latín en hexámetros; Fábula de Apolo y Dafne, Fábula de Venus y Adonis) que reflejan una clara influencia de Góngora; la comedia La gloria de Niquea (1622), basada en el Amadís de Grecia, y más de doscientos sonetos, epigramas y redondillas de tema amoroso, satírico, religioso y patriótico, en las que cultiva un particular conceptismo, mientras que reserva su también original culteranismo para los poemas en arte mayor. Una segunda edición fueron las Obras de don Juan de Tarsis Conde de Villamediana, y correo mayor de Su Magestad. Recogidas por el licenciado Dionisio Hipólito de los Valles. Madrid, por Maria de Quiñones a costa de Pedro Coello, 1635. Villamediana se sabía condenado a morir joven y en su poesía aparece este sentimiento fatalista plasmado a través del mito ovidiano de Faetón, en que también es posible observar un cierto complejo edípico respecto a su padre. Son sus temas poéticos predilectos el silencio, el desengaño, la temeridad, el mito de Faetón y todos los relacionados con el fuego. Se muestra especialmente introspectivo en las redondillas y suele acumular los pronombres personales en señal de desequilibrado narcisismo. Su lenguaje poético, esencialmente culterano, introduce cultismos nuevos que no aparecen en las obras de Luis de Góngora, que era amigo suyo. Escribió especialmente sonetos de diversos temas morales, amorosos y especialmente satíricos; algunos de los mejores son los dedicados a su destierro, como "Silencio, en tu sepulcro deposito...", que ha pasado a todas las antologías de poesía barroca: Silencio, en tu sepulcro deposito ronca voz, pluma ciega y triste mano, para que mi dolor no cante en vano al viento dado y en la arena escrito. Tumba y muerte de olvido solicito, aunque de avisos más que de años cano, donde hoy más que a la razón me allano, y al tiempo le daré cuanto me quito. Limitaré deseos y esperanzas, y en el orbe de un claro desengaño márgenes pondré breves a mi vida, para que no me venzan asechanzas de quien intenta procurar mi daño y ocasionó tan próvida huida. También dedicó algunos esfuerzos a la traducción libre o parafrástica de dos autores: el italiano Gianbattista Marino y el portugués Camoens. Del primero tradujo los 552 versos de la Fábula de Europa, que se convirtieron en 732 más 58 de la dedicatoria. Del segundo cuatro o cinco sonetos. La vida y obra de Juan de Tassis ha sido estudiada por Emilio Cotarelo, Juan Manuel Rozas, Luis Rosales y otros autores. Obras * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cancionero de Mendez Britto: poesías inéditas del Conde de Villamediana Edición, estudio y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Consejo * Superior de Investigaciones Cintíficas, 1.965. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cartas Madrid: Ediciones Escorial, 1943. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Obras Edición, introducción y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Castalia, 1969. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía impresa completa. Edición de José Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1990. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía inédita completa. Ed. Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1994. Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía, ed. Mª T. Ruestes, Barcelona, Planeta, 1992 Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Tassis_y_Peralta


Zoé Valdés (La Habana, 2 de mayo de 1959) es una escritora cubana de poesía, novela y guiones cinematográficos que adquirió la ciudadanía española en 1997. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, pero abandonó los estudios antes de terminar (hizo hasta cuarto año); después ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana, donde estudió hasta segundo año.

Guillermo Valencia Castillo (Popayán, Colombia, 20 de octubre de 1873 - ibídem, 8 de julio de 1943) fue un poeta, diplomático y político colombiano, candidato dos veces a la Presidencia de la República y senador de la misma. Maestro por antonomasia, no solo por su eminencia intelectual y por su posición pionera de corresponsal del Modernismo en Colombia sino por su formidable trayectoria política.1 Escritor, diplomático colombiano y candidato presidencial, creador de una poesía pictórica con influencias del romanticismo y del parnacianismo. Nació en Popayán, departamento del Cauca, el 20 de octubre de 1873, hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva. Quedó huérfano a los diez años de edad. Gracias a su hermano mayor consiguió estudiar en el colegio de San José De LaSalle, ubicado en Medellín, donde empezó a demostrar su inclinación a la poesía. Vida pública Tras culminar sus estudios de secundaria y convertirse en un joven intelectual muy destacado de su ciudad, se trasladó a Bogotá en 1895, donde fue elegido a la Cámara de Representantes por el partido conservador. Allí conoció a Baldomero Sanín Cano y a Alfredo Buess, con quienes entablaría una entrañable amistad, y a los bohemios de la Gruta Simbólica, grupo literario de la época en el que destacó Julio Flórez. Empezó a ser conocido como orador en el parlamento y como lírico gracias a la declamación de poemas como "Anarkos" y "Croquis" en el Teatro Colón. Inicios en las letras En 1898 deja el Congreso y viaja a París como secretario de la legación colombiana ante Alemania, Francia y Suiza, que dirigía el embajador, general Rafael Reyes. En la capital francesa conoce a Rubén Darío, con quien entabla amistad y, tras la publicación de su excepcional libro de poemas, Ritos (1899), se convierte junto al vate nicaragüense en el más notable poeta parnasiano y simbolista de la lengua española a causa de la rica imaginería personal de sus versos, que le singularizan como uno de los poetas más importantes del modernismo literario. Candidatura presidencial A su regreso al país asume un cargo de mediana responsabilidad en el Ministerio de Hacienda en 1901, pero fugazmente ya que pasa a ocupar sucesivamente las secretarías de Educación y de Gobierno del departamento de Cundinamarca, por designación del gobernador José Vicente Concha. Entre 1904 y 1908 asiste nuevamente al Congreso y se perfila como uno de los dirigentes más destacados de su partido. En 1909 ocupa la gobernación de Cauca, tras lo cual viaja a Europa y se aleja de la política nacional. A su regreso en 1914, el ahora presidente Concha lo nombra ministro de Guerra, cargo que ejerce por algo más de un año, tras lo cual empieza a preparar su candidatura para las Elecciones presidenciales de Colombia de 1918 por la Unión Republicana, en las que resulta finalmente derrotado por su copartidario Marco Fidel Suárez. En 1930 sería nuevamente derrotado como candidato a la presidencia, esta vez quedando tercero, tras el liberal Enrique Olaya Herrera y el general conservador Alfredo Vásquez Cobo. Durante sus últimos años asistió intermitentemente a la Cámara de Representantes, pero ya sin mucho protagonismo. Obra poética A partir de esta época vino la última etapa de su creación poética, con poemas como "Job", "Parábola del Pozo", "Canto a San Francisco de Asís", entre otras, y las versiones de la poesía china que aparecieron en el libro titulado Catay. El poeta y crítico literario colombiano Rogelio Echavarría describe a Valencia de la siguiente manera: "Este aristocrático -por sangre y cultura- hijo epónimo de Popayán y su blasón más deslumbrante, es sin embargo uno de los más discutidos poetas hispanoamericanos, desde sus primeros Ritos (nombre de su entera obra poética personal) hasta las páginas de su madurez en las cuales se destacan sus formidables discursos y sus afamadas traducciones de Goethe, Víctor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Oscar Wilde, D'Anunzio, Verlaine, Maeterlinck, Flaubert, Stefan George, entre otros. Su obra poética fue originalmente publicada así: Poesías, Bogotá, 1898; Ritos, Bogotá, 1899; Londres, 1940; Sus mejores poemas, Madrid, 1926; Catay, poemas orientales, Bogotá, 1929; Obra poética completa, Madrid, 1948; Antología, compilación de Germán Espinosa, 1989, y muchas -incontables- ediciones. La polémica sobre la vigencia de su obra no se cierra; sin embargo, hay críticos que consideran su supervivencia parecida a la de la fría eternidad del mármol, mientras otros tratan de reivindicarla con calor tardío". Vida familiar Contrajo matrimonio con Josefina Muñoz Muñoz, también payanesa, con quien tuvo cinco hijos, entre los que destacaron Guillermo León, que llegó a ser Presidente de Colombia, y Josefina, primera mujer en ocupar un ministerio y una gobernación en la historia del país. Falleció en Popayán el 8 de julio de 1943. La ley 80 de 1943 declaró monumento nacional la amplia casona donde vivió y murió, hoy denominada Museo Nacional Guillermo Valencia, y en cuyo panteón reposan los restos mortales del Maestro junto con los de varios otros miembros de la familia Valencia. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Valencia